
« Naître chaque matin à la naissance du jour. Joie »
En hommage à Michel Serres
Pourquoi cinq ans après le premier confinement (mars-mai 2020) y revenir ? le Covid-19 n’est-il pas définitivement derrière nous ? sans laisser de traces, n’aurait-il eu pour effet que de retarder des évènements – de politiques interne ou internationale – qui auraient de toutes façons eu lieu ? Rien n’est moins sûr. Mais en quoi, alors, notre perception du monde et l’empreinte de nos actions sur lui auraient-elles modifié le cours de l’évolution ? Il s’agit, en effet, de rien de moins que de la Raison et de la résistance des sens à l’épreuve du Covid, dont dépend notre devenir ensemble. Sauf que, pour aborder la chose, ce sera plus en amateur fasciné par les idées, peut-être plus que de raison, qu’en savant éloigné de ce que je suis. Sans prétention, donc, pour une entreprise bien ambitieuse, en praticien de l’aménagement et de l’urbanisme sensible, mon métier avant d’entrer en retraite. « N’étant pas spécialiste, écrivait Lewis Mumford, j’ai profité d’une liberté que se refusent trop souvent les chercheurs spécialisés : celle de mettre en relation des données provenant de domaines très variés afin de faire apparaitre une configuration générale qui échapperait sinon à l’observation1. » Loin de moi, évidemment, de me comparer à Mumford.
On ne compte plus le nombre d’ouvrages traitant des questions de société, de politique nationale ou de relations internationales. À quoi bon en rajouter, si ce n’est là qu’affaire de diversité dont on ne peut que se louer pour échapper à la polarisation stérile des débats, à côté de laquelle l’embarras du choix auquel nous expose un excès de diversité n’est qu’un impédimenta. Si ce n’est aussi – considérant d’expérience que l’aménagement des villes est indissociable de celui des campagnes, se refusant à dissocier la pensée de l’action, l’espace du temps, la structure de la fonction, l’individu de la société, la personne de la communauté, l’urbanisme et l’aménagement rural de la politique – qu’un retour critique sur une carrière d’aménageur, riche de projets aboutis ou avortés y incitait2. L’aménagement, marqueterie technique autant qu’esthétique de territoires, miroir des politiques sociales. Exercice opportun que de prendre la plume – la retraite venue étant inespérée pour s’appuyer sur des auteurs dont la lecture tient plus du hasard que d’une démarche logique – afin de porter à maturation ce qui, dans le feu de l’action, avait échappé à une conscience professionnelle. Conscience d’autant plus tentée de douter qu’il n’était pas rare que les évolutions viennent infirmer ce que l’on tenait pour certitude. Plus que toute autre discipline, peut-être, l’urbanisme se prête à la contestation, en tous cas à la polémique. Emblématique est, à cet égard, le Mouvement moderne, dont le chef de fil fut en France Le Corbusier. D’où, aussi, une exigence de pluridisciplinarité, soucieuse d’accorder exercice du métier, recherche et expertise, à fin d’efficacité pratique. Reste qu’il y a loin de la rigueur de la théorie, uniforme, d’une nudité crue, frigide, à l’approximation de la pratique, sang mêlé, d’une impureté originelle, polychrome. Mais le monde est ainsi, pluriel et métissé. C’est pourquoi il est important de dégager dans le flou qui nous environne ce que la théorie, faite de raison, et la pratique, toute d’intuition et de sensations, ont en partage : le « sens commun » ou le « bon sens », c’est selon. D’autant qu’il y a 20 ans, les banlieues, dites sensibles, explosaient (octobre 2005), qu’il y a 10 ans étaient commis les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan ainsi que la prise d’otage de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes (2015). Magie des dizaines et demi-dizaines : répétition d’anniversaires tragiques, dramatiques même, ayant précédé l’épidémie de Covid, propice à un retour critique. Les années qui suivirent n’en furent pas moins chargées avec l’incursion de l’armée russe en l’Ukraine en 2022, l’attaque terroriste du Hamas contre des Israéliens du Néguev en 2023 ; sans compter, en France, avec la perte de la majorité à l’Assemblée nationale élue en 2022 dans la foulée de la réélection d’Emmanuel Macron, puis, aux États-Unis, l’inauguration de la seconde présidence Trump en 2025 – après la tentative de putsch de janvier 2021 précédant l’investiture de Joe Biden – avec les perturbations qui se sont ensuivies tant sur le plan intérieur qu’international. Un avant et un après Covid que rien ne laissait soupçonner, traversé par la crise climatique, qui perdure avec ses conséquences ravageuses sur nos vies à défaut de réaction à la mesure de l’enjeu. Avant, c’était aussi le mouvement des Gilets jaunes, entravé par l’épidémie, qui avait déjà ébranlé la première présidence Macron en 2018-2019 ; après ce fut la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, suivie de son cortège de Premiers ministres mis au défi de composer avec l’éclatement de la majorité. Enchaînement d’évènements parmi d’autres qui interpelle, dont l’effondrement des twin towers en 2001 avait constitué une alerte peut-être constitutive d’une nouvelle ère ; évènements entre lesquels il serait toutefois vain d’établir une hiérarchie, coïncidences ou pas, mais qui appellent ce retour critique, sans dramatisation, en toute conscience d’un cours tragique que le confinement aurait interrompu, infléchi ou non. C’est toute la question que ce court essai – essai, non d’érudition, mais au sens étymologique du terme – cherche à cerner à défaut de prétendre y répondre, vu l’extrême complexité de l’enchevêtrement des évènements en cause. Aussi est-ce en fureteur curieux, les pieds sur terre mais la tête dans les livres, retraite aidant, que je me hasarde à écrire en prenant le risque d’enfoncer des portes ouvertes, avec cependant l’excuse que si elles le sont, c’est dans le brouillard. Et si j’invite le lecteur à me suivre, ce sera donc, aussi, en curieux, dans une errance toute de découvertes impromptues dont les citations portent le témoignage de voleurs de grands chemins (Walter Benjamin), de pêcheurs de perles (Hannah Arendt), de collectionneurs plus attachés à ce qui spécifie, purifié de tout contexte, qu’à ce qui différencie. Consécration d’une vision kaléidoscopique du monde et de l’originalité de chacun de ses éléments constitutifs, dont la ville, en tant qu’agglomération de matériel et de spirituel, serait la métaphore. Transposition du Livre de sable ou de La bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges, qui exprime bien à sa façon la vastitude du monde, gros de sa diversité, mais au sein de laquelle l’homme risque de perdre la mesure :
« Si l’espace est infini, nous sommes dans n’importe quel point de l’espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n’importe quel point du temps3. »
D’où, transposée à la bibliothèque, il tire la loi fondamentale suivante (susceptible d’être à son tour transposée à la ville) :
« Il n’y a pas, dans la vaste Bibliothèque, deux livres identiques4. »
Et de conclure, résigné, mais néanmoins optimiste :
« L’écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes […] mais je soupçonne que l’espèce humaine – la seule qui soit – est près de s’éteindre, tandis que la Bibliothèque se perpétuera : éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutile, incorruptible, secrète5. »
Aurait-on pu mieux rendre l’imbrication de l’écriture et de la vie face à la précarité humaine à laquelle le Covid nous a brutalement confrontés, évènement sans précédent ayant motivé ce bien gauche essai auquel je me suis livré, non sans réticence (pour un bref tour d’horizon de ma carrière d’aménageur, voir la note 2 de bas de page).
Mais, avant de pénétrer dans le vif du sujet qui me tient à cœur, un détour par Kafka s’impose.
Entrée en matière de La Métamorphose :
« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Gregor Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une carapace, et, en levant un peu la tête, il s’aperçut qu’il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par des rainures arquées […].
« Que m’est-il arrivé ? » pensa-t-il. Ce n’était pourtant pas un rêve […].
Le regard de Gregor se tourna ensuite vers la fenêtre ; on entendait des gouttes de pluie sur le zinc ; ce temps brouillé le rendit tout mélancolique […]. »

Photo : Picas Joe (Pexels)
L’assoupissement des sens dans le confinement
En nous réveillant le 17 mars 2020 au matin, premier jour du premier confinement, ne nous sommes-nous pas retrouvés, comme Gregor Samsa, dans une situation certes pas aussi lugubre, mais néanmoins étrange : face à la fenêtre, confrontés au vide et au silence de la rue, pour la première fois d’une vie pourtant pas avare de surprises alarmantes. Or, Gregor ne se sentait que mélancolique sous un temps maussade – son premier réflexe fut de se tourner vers la fenêtre – ce qui était bien le moindre des états d’âme compte tenu de sa « transformation ». En comparaison, c’est l’angoisse, ou peut sen faut, qui nous étreignit à l’aube de ce jour mémorable, comme si le réveil avait mutilé nos sens en tant qu’ils nous reliaient au monde, et que l’espace du dehors avec ses rues bordées d’immeubles, certaines d’arbres, avaient perdu ce sens de l’humain dont elles se revêtaient peu à peu chaque petit matin, à mesure qu’elles se remplissaient de monde ! Que pèse l’angoisse de se retrouver par un petit matin prisonnier entre quatre murs avec vue sur des rues désertes, réduites à défaut de plantations à leur minéralité, à côté de la mélancolie de Gregor métamorphosé en cancrelat ? L’âme de Gregor demeurait, mais prisonnière d’un corps qui, lui, s’était désolidarisé pour sombrer dans la pire des animalités que l’on puisse concevoir. La monstruosité s’était emparée du corps, renvoyant l’esprit à une solitude dont il ne pourrait plus se relever. Ce qui le réunissait au corps ne pouvait désormais que l’en séparer, jusqu’à l’issue fatale, ignominieuse, mais salutaire pour sa famille confrontée à une souffrance intolérable. Certes, la métamorphose de Gregor l’affectait physiquement, il se retrouvait comme dissocié de lui-même, alors que celle à laquelle nous étions confrontés ne concernait que la relation au dehors, mais elle retentissait sur l’âme, amputée de cette sensibilité qui nous reliait aux autres. L’angoisse qui nous étreignait était l’expression d’un écart vertigineux entre soi et le monde : face à un monde réduit à sa matérialité, privé d’humanité, l’intégrité du « soi » semblait, par ce fait même, remise en cause. Non que le fil soit complètement rompu ; sens émoussés, assoupis faute d’exercice dans la plénitude de leurs fonctions, bien qu’en rien lésés organiquement. Mais, la réclusion, même partielle, même intermittente, nous a coupé la chique, comme on dit trivialement. La claustration, la solitude, la déshumanisation du dehors, ont entamé, à des degrés, certes, divers, notre sensibilité : lorsque la vue est exposée au vide de la rue, l’ouïe au silence de la ville endormie, l’odorat privé des fragrances mêlées de la circulation et des foules, le toucher empêché par la mise à distance, c’est le goût d’une manière générale qui est atteint, goût des choses, goût des autres, goût de vivre. À quoi bon tous ces sens qui n’ont plus guère à s’exercer en dehors de l’intimité familiale. Ils nous invitaient au partage, le confinement contribua à la perte de leur acuité : à force de tourner en rond dans l’espace exiguë de nos chambres, de nos studios, de nos appartements, de nos maisonnées, l’atonie, l’apathie, l’abattement, le désintérêt… devaient nous guetter irrémédiablement. Du moins est-ce, alors, ce que nous ressentions, si brutale et inédite fut l’interdiction d’accès à l’espace public, l’obligation de repliement dans l’exiguïté de son « chez-soi », même avec les écrans à portée de mains.
À la sidération première devait, ainsi, succéder cette angoisse mêlée d’étrangeté. Et comme il fallait bien s’y faire – force de l’habitude – l’angoisse devait bientôt retomber pour faire place à ce sentiment de déréliction, sentiment de solitude morale nous dit le dictionnaire, plus métaphysique que psychologique. C’est aussi que le chant des oiseaux, qui devait aller en s’amplifiant à mesure que la déshumanisation du décor se prolongeait, nous signalait que toute vie n’était pas abolie, nous laissant cet espoir de nous en sortir quelque jour. Mais quel espoir : de renouveau ? de résurrection ? de révolution ? Quand les portes se referment pour ne laisser que les fenêtres ouvertes, quand toute échappée est prohibée, sauf pour quelques instants et pour de courtes distances aux fins de ravitaillement (vivre malgré tout !), le découragement face à l’imprévisibilité du lendemain nous guette. Aussi bien, la référence à une autre nouvelle – L’image dans le tapis d’Henry James – s’imposa-t-elle au lever lorsque, nous prenant la tête à deux mains nous avons fixé des yeux le motif de la descente de lit, qui nous avait toujours paru, sinon étrange, indéchiffrable, motif abstrait sans signification apparente, énigme tapie dans des arabesques aux couleurs vives mais dépourvues de figures reconnaissables par le sens de la vue, lequel nous met à distance des choses qui nous entourent, à la différence de l’ouïe qui les enveloppe et nous avec ; motif oriental, création de l’art islamique inspirée de la prohibition de la figuration humaine.

Metropolitan Museum of Art (NY)
Dans La République, Platon avait imaginé les hommes confinés dans la caverne, tournant le dos au soleil, réduits à ne percevoir que des ombres profilées sur les parois. Les Modernes avaient pris le risque de nous en extraire en nous laissant entrevoir que le salut pourrait venir d’un éblouissement du savoir effaçant les contours des silhouettes projetées sur les parois de la caverne, nous plongeant dans l’abstraction des algorithmes de la science et de l’art conceptuel. Développé en réaction, le postmodernisme a bien tenté de renouer avec une certaine réalité sensible à coups de citations puisées dans les traditions et un passé révolu, mais ce fut éphémère, bientôt relayé par la déconstruction, jusqu’à ce que le coronavirus, sous son déguisement dantesque, nous contraigne à un confinement dans les quatre murs de nos maisons et appartements pour échapper à la maladie et à la mort. Certes, notre situation est moins angoissante que celle imaginée par Platon, dont « les hommes sont dans cette grotte depuis l’enfance, les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu’ils restent sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête à cause de leurs liens ». Mais, tourner la tête vers quoi ? Vers le soleil, source de la lumière, situé dans un au-delà inaccessible. Le confinement en nous cloîtrant nous laissait malgré tout libres de nos mouvements. Différence cruciale. En revanche, les prisonniers de la caverne, bien que pieds et poings liés, gardaient la faculté de converser entre eux. Mais de quoi ? En quoi être condamnés à cogiter sur des ombres était-il plus enviable que d’être éloignés de ses semblables et privés de leur conversation par le confinement ? Le renfermement imposé était suffisant pour que soit reléguée dans un avenir incertain rien de moins qu’une certaine sensibilité aux choses du dehors et, par leur intermédiaire, le contact avec les autres. Le coronavirus nous privait même des ombres que la caverne de Platon nous laissait encore entrevoir ! Sauf que la situation était inversée par rapport à celle du dialogue de laRépublique puisque si l’accès à la réalité des idées était interdit aux prisonniers de la caverne, réduits à appréhender avec leur sensibilité le monde des apparences se profilant sur les parois de la caverne, c’est d’une sensibilité mutilée du fait de leur isolement que les confinés du Covid étaient victimes, la réalité extérieure qui leur était réservée étant réduite à une abstraction matérielle. Dans une opposition dogmatique, quand l’apparence est du côté de la sensibilité la réalité est le privilège de la Raison, et inversement.
Puis, à la faveur d’un premier déconfinement, la « multiple splendeur » de l’animation du dehors, qui nous avait échappé par la force de l’habitude, nous a été révélée à nouveau, progressivement dévoilée par les sens recouvrés. Hélas ! confrontés à l’émergence d’incessants variants,il nous aura fallu bientôt déchanter avant de trouver la parade à force de vaccinations, tests antigéniques et autres, pass sanitaires, etc. Aurions-nous, alors, assisté au final du sabbat des sorcières, pour voir définitivement se dresser, sur fond de révolution numérique persistante, nos corps « sensibles » – antithèses du corps « glorieux » de nos catéchismes – ressuscités du désert des abstractions dans lequel la science, la philosophie et les arts les avaient laissés : accomplissement, dans leur plénitude, des corps mêlés entre eux et aux choses ; témoignage irréfutable de l’unité charnelle des sens et de l’esprit que la science promue par les Modernes avait abusivement dissociés ? Rien n’est moins sûr !
L’épreuve avait pourtant été rude pour le citadin, tenté de fuir la ville, menacée et menaçante, nouvelle Babylone, afin d’échapper au confinement et, dans le même temps, renouer avec une nature idéalisée pour la circonstance. L’écart s’était creusé entre la ville et nous, entre la malédiction qu’elle incarnait et la campagne idyllique où renaître. Fallait-il en passer par là pour faire prendre conscience de ce qu’elle pouvait nous manquer et de combien elle le pouvait ? Qu’il n’y avait pas d’un côté le monde inférieur, celui du « bruit et de la fureur » et de l’autre un monde édénique des béatitudes, mais que les deux coexistaient à proportion de leurs mérites respectifs. Retour, donc, à la « société urbaine » telle que la concevait Henri Lefebvre ? Peut-être, mais à un demi-siècle de distance. C’est, en effet, en 1970, qu’il affirmait, dans La Révolution urbaine, que « l’urbain rassemble des différences et fait différer ce qu’il rassemble ».
Le coronavirus a bien failli sonner la fin de la récréation, nous contraignant, provisoirement, à nous replier sur nos identités, à rentrer dans nos très sophistiquées et trop confortables cavernes afin de se soustraire à la contamination et permettre de persévérer, chacun pour soi, dans son être ? Non, certes, sans la compagnie du portable, maigre compensation. Bien triste destin auquel Platon invitait à échapper par la grâce du roi-philosophe qu’il appelait à la tête de la Cité, composée selon ses vues. La tentation n’en était pas moins grande pour le quidam, prisonnier de la caverne, ayant réussi à se libérer de ses chaînes et entrevu laRéalité sous l’éclat du Bien-Soleil, de se perdre en cette contemplation ? Après, il est vrai, avoir pris le temps de s’accommoder à tant de clarté. Mais Platon, si dualiste soit-il, c’est-à-dire insatisfait de ce bas monde jusqu’à imaginer un au-delà lumineux dont il serait l’obscur reflet, n’avait pas de ressentiment au point d’abandonner ses congénères du royaume des ombres. Comment, en effet, l’heureux philosophe n’aurait-il pas eu pitié d’eux et, sensible à leur sort, ne se serait-il pas fait un devoir de redescendre dans la caverne pour leur faire partager sa vision du Bien, du Beau, du Vrai, du Juste ; et ce, à ses risques et périls, tant il devait redouter leur jalousie. S’adressant dans le dialogue du VIIe Livre de La République aux philosophes ayant vocation à devenir gardiens de la Cité, il fait dire à Socrate, interlocuteur de Glaucon, son disciple en compagnie duquel il avait l’habitude d’accomplir ses devoirs de piété :
« Il vous faut donc redescendre, chacun à votre tour, vers l’habitation commune des autres, et vous habituer à voir les choses qui sont dans l’obscurité. Quand vous y serez habitués, en effet, vous verrez dix mille fois mieux que ceux de là-bas, et vous aurez identifié chacune des figures : ce qu’elles sont, de quoi elles sont les figures, parce que vous aurez vu le vrai concernant les choses belles, justes et bonnes. De cette manière, la Cité sera administrée en état de vigilance par vous et par nous, et non en rêve, comme à présent, alors que la plupart sont administrées par des gens qui se combattent les uns les autres pour des ombres et qui deviennent factieux afin de prendre le pouvoir, comme s’il y avait là un bien de quelque importance. »
N’était-ce pas, malgré tout, reconnaître par là une certaine communication entre les deux mondes, celui de la lumière et celui des ombres, celui de l’intellect et celui du sensible, leur interpénétration subtile – toutefois encore loin de leur osmose avec laquelle joue Michel Serres dans Les Cinq sens. Entrebâillement, dont les détenteurs du savoir pourraient tirer profit pour le plus grand bien de la multitude, tenue dans la servitude ? Le confinement non plus n’était pas si hermétique : par médias interposés il maintenait une communication avec ce monde des vivants qui nous était interdit d’accès direct, médias à travers lesquels les pseudo-philosophes-rois qui nous gouvernent pouvaient intervenir pour tenter de lever le voile sur la réalité du fléau qui nous éprouvait et nous prodiguer des conseils de prudence non dépourvus de relents de collapsologie ou de transhumanisme bien éloignés des préceptes de la sagesse antique.
Si la verticale conduit au monde inaccessible des idées, unilatéralement, dans une relation de cause à effet, ce n’est pas sans que, par analogie, nous puissions établir des rapports entre les choses de ce monde et les idées de l’autre, transcendant. La philosophie de Platon n’est pas un « platonisme », vulgarisé à la Renaissance par Marsile Ficin ; dans les termes du Banquet, l’amour y est conçu dans la variété de ses dimensions culminant dans le sens suprême, celui de la Beauté accessible à l’homme sensible. De même, Thomas d’Aquin, à côté de l’analogie d’attribution, verticale, recourra à l’analogie de proportionnalité (entre éléments différents mis en rapport deux à deux) pour signifier que la transcendance ne saurait fermer hermétiquement l’accès des habitants de la planète Terre au Divin. L’univocité de la raison hégémonique, s’oppose à l’équivocité des sens, des cinq sens ; entre les deux l’analogie établit des correspondances. Outre que la raison n’est pas unique, sa verticale croise les sens pour en dompter l’exubérance. Comme quoi, rien ne saurait être définitivement tranché : si la raison ramène le désordre des sens au « bon sens », ceux-là, toujours, tendent à échapper à l’emprise totalitaire de celui-ci. Les ordres que Pascal distinguait sont, comme les corps de Michel Serres, plus ou moins mêlés. D’où l’ambivalence qui peut s’attacher à la perception qu’on en a généralement. Ambivalence qui peut être recherchée dans la symbolisation lorsque, insatisfait de notre condition humaine par trop terre à terre, nous recourons à cette transcendance dans l’immanence qu’est la poésie, et l’art en général.
Comment ne pas entendre aussi, dans ce passage de La République de Platon, un écho de l’imbroglio social et politique qui s’est refermé sur la France depuis la dissolution de l’Assemblée nationale (juin 2024) et sur le monde occidental depuis le retour de Donald Trump au pouvoir (janvier 2025). Imbroglio exploité par des politiciens sans scrupules, dont l’égo est d’autant plus dépourvu de conscience qu’il est surdimensionné. Que ce soit par inconscience ou perfidie, le but est le même : semer le trouble dans le débat public pour mieux conforter le pouvoir du thaumaturge et le pérenniser. Avec quel dessein : celui de promouvoir une paix favorable à l’expansion d’une économie désinhibée au service d’un État décervelé. Formellement, la symétrie serait patente avec le maître du Kremlin, engagé dans des guerres de reconquête à l’ouest, accoudé sur son flanc est à l’Empire du milieu, si la force déployée n’avait pas pour contrepartie une économie à bout de souffle. Libertarianisme pacifique d’un côté, despotisme guerrier de l’autre. Et entre les deux une Europe qui compte d’autant moins qu’elle s’enferre dans les contradictions d’une démocratie déclinante. Europe prise en tenaille entre deux violences : celle de la force (Poutine), celle de l’affairisme (Trump) ; violence sanguinaire d’un côté (à l’état mythique, primitive), violence mortelle de l’autre (culturelle) pour reprendre une formulation de Walter Benjamin6. Europe exsangue, sauf sursaut encore imprévisible à ce jour, susceptible de retourner le cours de l’histoire en son contraire : boucle rétroactive du faible sur le fort, de l’influence sur la puissance. Tout dépendant de la teneur du ressort censé l’emporter, car si la géopolitique est de retour, l’asymétrie entre puissances tendrait à démontrer qu’elle serait autant géométrique que géographique, selon qu’elle se fonde sur la force (géographie7) ou sur la raison (géométrie).
Les cinq sens, ouvrage de Michel Serres, revisité
Mort en juin 2019, Michel Serres n’aura pas connu les ravages de la pandémie qui a déferlé sur la planète à l’aube de la décennie 20. Notre intention n’est pas de se substituer à lui pour dire ce qu’ils auraient pu lui inspirer. Mais un retour sur Les Cinq sens (première édition en 1985, magie du chiffre 5 encore) – essai inaugurant une série portant sur « Les corps mêlés », ouvrage peut-être le plus représentatif de la philosophie et de la manière de l’auteur – peut nous aider à comprendre, cinq ans après, de quoi la pandémie nous a privé et à en évaluer les retombées. D’autant que précédée par les attentats terroristes de 2015 (Charlie Hebdo et Bataclan), le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, elle fut suivie sur le plan international par l’invasion russe de l’Ukraine en 2022 et l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en 2023 avec la réaction hors de proportion du gouvernement israélien et surtout l’absence de plan de paix durable. En 2024, on assistait en France à la célébration des jeux Olympiques parallèlement à la déconfiture du jeu de la démocratie avec la dissolution de l’Assemblée nationale et à de nouvelles élections. S’ensuivit une valse de Premiers ministres entre 2024 et 2025. Enfin en 2025, aux États-Unis, Donald Trump rempilait. Troublante accumulation d’évènements, entremêlant religion (menace djihadiste), idéologie (vogue du wokisme), politique (tentation de l’illibéralisme) et relations internationales (guerres), sans liens de causes à effets, du moins en apparence. Faut-il alors croire au hasard ? Pas sûr. L’enchainement de ces évènements sur un double plan : national et mondial, relève d’une autre complexité – produit d’un déterminisme de faits et de liberté humaine mêlés – qu’en l’état notre intelligence, tentée de se désolidariser des cinq sens, eux-mêmes dissociés, peine à saisir dans toute son étendue et ses multiples replis. Et ce, même en s’adossant à l’intelligence artificielle (IA). En nous isolant de nos semblables, le confinement nous aura rendu schizophrène, à la psyché clivée, affectant notre rapport au monde, provisoirement ou à long terme, voire à jamais : l’expérience du Covid-19 n’aura-t-elle été qu’une parenthèse sans lendemain ou aura-t-elle infléchi durablement notre façon d’habiter le monde ?
Revenons, donc, à ces Cinq sens, véritable poème philosophique, aussi flamboyant par le style que profond par l’esprit qui l’anime, prouvant que la profondeur de la pensée a tout à gagner du style qui lui imprime sa marque. Magie du chiffre cinq toujours, nombre des doigts de la main, moitié de la décimale, dynamisme de l’impair. L’ouvrage se décompose en cinq parties : Voiles, pour le toucher ; Boîtes,pour l’ouïe ; Tables, pour le goût et l’odorat ; Visite,pour la vue ; Joie, enfin, pour une synthèse aussi réjouissante que consensuelle. Si les parties du sommaire ne correspondent, donc, pas aux cinq sens comme on aurait pu s’y attendre, puisque la troisième partie (Tables) traite ensemble et du goût et de l’odorat – ce dernier sens que beaucoup de patients se sont plaints d’avoir perdu, au moins provisoirement, après avoir contracté le virus – c’est pour consacrer la cinquième et dernière partie (Joie) à une sorte d’apothéose des cinq sens laissant entrevoir ce sixième sens rêvé par certains pour célébrer les noces de la chair et de l’intellect dans une délectation sensuelle autant que spirituelle. Il n’est que de relire Flore et Pomone de Colette pour s’en persuader. Dans ses jardins, elle exulte : « L’angoisse et le plaisir de sentir vivre le végétal, ce n’est pas au cinéma que je les ai le mieux éprouvés, c’est par mes sens faibles mais complets, étayés l’un par l’autre, non en comblant, en renforçant follement ma vue. » Aux émotions fortes que peut procurer le cinéma, elle oppose la douceur des jardins que même des sens faibles peuvent éprouver pourvu qu’ils ne se laissent pas dominer par la seule vision, mais conviennent de s’associer dans une commune exploration.
Chez Michel Serres la hiérarchie classique des cinq sens en est bouleversée jusqu’à en être inversée, la priorité accordée par Georg Simmel à la vision et à l’ouïe étant reléguée au second plan pour laisser la place d’honneur au toucher. C’est ainsi qu’il développe son poème philosophique autour de cinq thèmes que viennent illustrer divers mythes antiques : les « voiles » dont on se pare, qui font obstacle au toucher pour mieux le célébrer ; les « boites » de résonances de l’amphithéâtre et du prétoire, entre autres caisses de répercussion du son ; les « tables » du festin, qui font ensemble honneur au goût et à l’odorat ; la « visite », enfin, empreinte de mobilité – plutôt que la vision, statique et globale – qui nous introduit au sein des variations du paysage (cf. supra l’infinie diversité des jardins de Colette).
Premier thème, introductif : « Voiles », premier mythe autour des toiles de Pierre Bonnard, dont les femmes s’exposent dans leurs drapés chatoyants, moirés, diaprés. Telle est, parmi d’autres, la femme au peignoir, peinte vers la fin du XIXe siècle, étalée nonchalamment au milieu de feuilles d’automne, dans les tons jaunes-orangers. « L’âme et le corps ne se séparent point mais se mélangent, inextricablement, même sur la peau » commente Michel Serres. Et de faire le parallèle avec les jardins quand la végétation domestiquée, soigneusement entretenue, recouvre la terre nue. Puis viennent les six tapisseries de la Dame à la Licorne, allégorie des cinq sens comme ouverture sur le monde : le Toucher, celui de la corne de l’animal fabuleux ; le Gout, avec la représentation du drageoir ; l’Odorat, qui s’exerce sur les fleurs cueillies par la suivante de la Dame ; l’Ouïe, figurée par le petit orgue à clavier positif ; la Vue, exprimée par le miroir tendu à la Licorne. Mais ce serait sans compter avec un sixième sens qui constitue un mystérieux retournement du corps sur son intimité, symbolisé par la tente entrouverte d’une tapisserie supplémentaire, au fronton de laquelle est inscrit : « À mon seul désir ». C’est qu’« il faut bien un sixième sens, par lequel le sujet se retourne sur soi et le corps, sens commun ou sens interne […] » Particularité : dans chaque tapisserie, le « toucher » assurant « l’ouverture dans la fermeture » l’emporte sur tous les autres sens « par l’équivalence du voile, de la toile et de la peau. » Preuve, s’il en est, de la prévalence de la réalité concrète (toucher de la corne) sur la représentation abstraite (vue à travers le miroir). Or, c’est ainsi qu’intervient le sixième sens : « facteur commun à quatre sens externes, sens ouvert et fermé à lui seul, il protège le sens interne et commence à le construire. » Sixième sens, donc, illustré par cette ultime tapisserie, dédié au désir, mais un désir exclusif porté aux joyaux qui débordent de la cassette tendue par la servante. C’est aussi la seule toile où « le langage advient », remarque Michel Serres. Qu’est-ce à dire, sinon que « le sens interne parle enfin », mais au risque de tuer les sens, qui lui deviendront subordonnés.

Le peignoir
(Wikimedia Commons)

Ainsi est présentée et commentée par l’auteur des Cinq sens la série des Tapisseries de la Dame à la Licorne du Musée de Cluny, dont le style millefleurs reflète toute la diversité du monde : illustration et résumé à elles seules, de l’ouvrage, vaste synthèse de ce que le monde représente pour la personne libérée des entraves que la Raison peut dresser contre elle par pure présomption.
Dernier thème, dernier mythe avant l’épilogue : « Visite », en lieu et place de la vision, autour du paysage et du passage du Nord-Ouest. « Le paysage assemble des lieux » et « le tracé d’un jardin miniaturise les paysages ». Aussi bien, ne restera-t-il plus alors à l’architecte qu’à concevoir dans cet environnement « la synthèse unitaire », en sachant bien que « les cinq sens concourent aux contours : de l’habitat, de la localité, comme du corps lui-même. » Les contours parlons-en : la pigmentation d’abord, privilège de l’homme noir, peut bien protéger de la lumière solaire, mais la peau ne suffit pas à nous garantir contre les intempéries et le froid, il y faut ajouter force oripeaux comme si la sensibilité se superposant à la pudeur nous contraignait à nous en couvrir. Autres contours encore : si le souci de sécurité n’impose plus aux villes de s’entourer de murs d’enceinte, la préservation de notre intimité domestique ne nous a pas fait renoncer à la clôture de nos habitations : « Une maison, c’est une veste d’homme » fait dire Jean Giono à Hortense dans Hortense ou l’eau vive. Toute couturière sait cela : les parements ornent les vestes comme les maisons. Mais, aujourd’hui, Alberti ne pourrait plus écrire comme dans De re aedificatoria : « La ville est une grande maison et, inversement, la maison est comme une petite ville », puisque celle-ci est désormais ouverte à tous vents et que, loin de craindre l’intrusion des barbares, c’est elle, si petite soit-elle, qui se fait envahissante, débordant sur le paysage environnant qu’elle dénature. Mais le paysage renvoie aussi à la géographie : « passage du Nord-Ouest », entre les icebergs, vers le couchant qui est aussi un nouvel aurore où le « dur » de la géographie physique le cède au « doux » de la géographie humaine, au paysage. Ulysse triomphant sur mer des écueils versus Descartes s’assurant la maîtrise des jardins à la française, ou quand le global intègre le local et inversement. Hybridité de l’écologie qui se voudrait humaine autant que naturelle, mais peine à en assumer le défi. Confluence improbable des sciences exactes (dures) et des sciences de l’homme (douces) : parcellisation des savoirs, rançon de leur diversité que menace la tentation de leur unification sous une Raison souveraine ? Au commencement, c’est la Genèse qui nous le dit, « le paradis verdit comme un jardin paysager », florissant. C’était bien avant que le logos, à l’époque moderne, ne vienne laminer les reliefs et réduire la variété de la faune et de la flore. La fonte des glaces, qui menace par ailleurs les côtes peuplées de villes, serait-elle la condition, catastrophique, de la convergence des sciences physiques et des sciences humaines ? Dépaysement certes assuré, mais à quel prix ! En fait de « vision », globale, ce serait plutôt de « visites », fragmentées qu’il s’agirait, tout au long d’une interminable errance comme celle de l’Odyssée ! Descartes, soupçonnant les sens de nous tromper, avait rabattu l’existence sur la pensée, nous éloignant de la représentation sensible du monde. Nous, contemporains, avons quitté la voie droite qu’il nous avait tracée, pour nous aventurer dans les sinuosités d’un monde humain constitué de « corps mêlés » : défi lancé au dualisme des Modernes et aux populismes des temps présents qui en ont hérité dans une version plus que jamais manichéenne.
Entre ces deux extrêmes du parcours des cinq sens : « Boites » et « Tables », entre celui, primitif, du contact direct avec les choses par le « toucher » et celui, contemporain, de la « visite » bien encadrée, quoi qu’un peu décalée, du monde qui nous environne, il nous aura fallu passer par deux étapes intermédiaires. Celle des « boites de résonance » du sens de l’ouïe, tout d’abord : souvenirs d’Orphée séduisant les monstres des Enfers au son de sa cithare et d’Ulysse évitant, sur le retour à Ithaque par mer, de succomber aux charmes des Sirènes. Deux périples, oh ! combien périlleux, par mer et sous terre, qui préludent à ces festins auxquels nous convoquent Platon et les Évangiles autour de « tables » réunissant Socrate et ses disciples, d’une part, le Christ et ses apôtres, d’autre part, pour, respectivement, « goûter » des nourritures terrestres du Banquet et se délecter du pain et du vin de la Cène, métaphore de nourritures spirituelles. Plus que des intermèdes, ce sont là des réjouissances avant les épreuves de la passion que la ciguë, pour le premier, et la croix, pour le second, immortaliseront par une cruelle ironie.
Reste l’épilogue, cinquième partie de l’ouvrage, intitulé « Joie », lequel fait écho à la fonction intégratrice des tapisseries de la Dame à la Licorne, dont la dernière représente une tente entrouverte libérant le désir. Ayant admis qu’« il n’y a rien dans la connaissance qui n’ait été d’abord laissé libre par les sens », le sujet connaissant retrouve la chair, un corps ; certes pas aussi bigarré que celui de l’animal – raison pour laquelle il se revêtira, la femme surtout, de couleurs pouvant être chatoyantes comme celles d’un vitrail – mais tout de même… Il réintègre son habitacle naturel, corps au derme moiré, translucide à l’esprit qui ne méprisera désormais plus la peau. Cocktail auquel il avait renoncé pour la pureté de l’abstraction, désincarnation que l’on retrouve dans la promotion des robots, humanoïdes, encore plus dépourvus de sentiments et de sens que de raison puisqu’avec l’IA ils peuvent désormais raisonner ; comme quoi plus que l’esprit, le corps sensible serait le propre de l’homme. Et, Michel Serres de faire, en contrepoint, l’éloge de la conversation française entretenue dans les salons du XVIIIe siècle par les femmes, ce qui ne saurait laisser indifférent tellement cette conversation a pu charmer les plus grands intellectuels du siècle. Les attraits de leur conversation n’avaient-ils pas d’égal que ceux de leur parure, leur style ne rivalisait-il pas avec celui de leur mise, haut en couleurs ? Mais, il y a belle lurette que la conversation de salon, si fleurie soit-elle, est passée de mode au bénéfice de la promotion du langage savant dans les institutions universitaires. Désormais, « la science déracine le langage après l’avoir ébranlé », non sans bouleverser les corps ? De sorte que le langage se retrouve écrasé entre formulations à base d’algorithmes et logomachie médiatique. Comme, néanmoins, il ne faut pas désespérer le poète, qui survit malgré tout à la sécheresse des temps modernes, l’auteur, prédisant qu’« après les noces du corps et de l’entendement, nous chanterons celle de l’espace et du temps », s’écrie avec jubilation : « Naître chaque matin à la naissance du jour. Joie. »
*****
La politique a été affaire de sens au pluriel, avant de l’être au singulier, ce sens qui a pris le pouvoir au dépend des sens. Sens fondé sur la puissance surnaturelle, avant de s’incarner dans la personne du tyran en Grèce, dans la monarchie de droit divin en France, dans le duce en Italie fasciste, dans le führer en l’Allemagne nazi… La raison, détour par l’abstraction, successivement démocratisée en souveraineté populaire (Rousseau) puis nationale après la Révolution (Sieyès), n’a pas échappé à l’instrumentalisation, orientant les sens sur une ligne uniformisante à la dévotion de Léviathans absorbant tout en « Un »8. Exemplaire est à cet égard l’exaltation des sens de la foule hypnotisée du congrès de Nuremberg de 1934, mise en scène par Albert Speer et tournée, sous le titre du Triomphe de la volonté, par Leni Riefenstahl, cinéaste propagandiste du Reich, également réalisatrice des Dieux du stade, documentaire sur les Jeux olympiques de 1936. Tous les sens tendus dans les bras levés de la foule convergeant sur le Führer, d’une part, condensés dans l’image du corps glorifié, d’autre part. La sensibilité, de sens et de sentiments mêlés, n’y a pas résisté.
Historiquement, l’instrumentalisation de la raison aura été, au siècle dernier, une réaction au Romantisme et à l’Art nouveau, dont la nouveauté fut tempérée par l’Art déco qui lui a succédé. Le Mouvement moderne, « Style international » s’il en fut, a parachevé ce redressement esthétique, porté la rationalisation à son paroxysme en mettant les cinq sens au service de fonctions séparées : l’habitat, le travail, les loisirs, les déplacements9. Raidissement de l’urbanisme. La contre-offensive du Postmodernisme10 dans les années 1970 ne fut que temporaire, laissant après elle le Déconstructivisme11 céder la place à l’empire du hasard, règne du chaos, assuré de faire le lit d’une exacerbation des sens qui finira par triompher politiquement avec Trump porté par les réseaux sociaux : exacerbation des sens rimant désormais avec non-sens. Les idées – qui, pour être des « idées », n’en furent pas moins meurtrières – ont bien pu tyranniser le monde entre les deux guerres et après, jusqu’à l’aube du troisième millénaire, depuis c’est la force pure qui le domine, par l’argent ou les armes. La parenthèse du Covid, en même temps qu’elle nous aura privé de l’ouverture des sens sur le dehors, contribuant à leur assoupissement, nous a, sous le régime de la claustration imposée, replié sur ces mêmes réseaux tombés dans les excès de la confusion des sens, reléguant les idées dans l’arrière cours pour mieux libérer ce que la puissance ne pouvait plus contenir. Imbroglio insoutenable : tantôt scrutant des yeux, depuis nos fenêtres, des traces d’humanité dans une ville pétrifiée, tantôt jetant un regard rivé sur le défilé incessant des pages Internet de nos écrans. Anticipation d’un monde à jamais dédoublé à se départager : réel déserté, déshumanisé d’un côté, facticité fantasmée de l’autre, se livrant une lutte impitoyable pour la conquête d’une humanité défaite par avance ?
L’histoire des cinq sens, nous enseigne Michel Serres, c’est l’histoire d’un renoncement au profit du règne de l’intellect sur l’esprit, et ce, au détriment de la sensibilité : « Nous avons quitté le paradis pour l’arbre de la connaissance. » Prométhée, voleur du feu apporté aux hommes, a fini par doubler, avec sa science, Hermès, le dispensateur de culture, dont les élans ont été bloqués et dont la langue, véhiculée par ses messages, s’est trouvée figée dans un formalisme réducteur : algorithmes tueurs du sens, littéral, et des sens dans leur fonction sensorielle ! La langue, parlée puis écrite, ayant pris la succession de la danse, forme primitive de langage (Schopenhauer), on en a oublié que les corps avaient une densité qui, pour nous contraindre, n’en permettait pas moins de jouer avec la gravité : danse et joie liées dans la même félicité, triomphe du sujet qui « sent » par tous les pores de la peau et ses organes des sens sur le sujet connaissant. Les Modernes ont cru se libérer des contraintes du sensible en se jetant dans l’abstraction, monde uniforme et sans relief de la fuite en avant. Pourtant, « il n’y a rien dans l’intellect qui n’ai été d’abord dans les sens », autrement dit dans l’espace et le temps, cadres de leur exercice. Il n’empêche, la culture parvenue à son acmé, méprisant les sens, a érigé l’intellectualité en mode sublime : « ce qui ne reste pas des sens gracieux, gratuit, léger, passager, forme notre culture ; ce qui reste des sens s’accumule comme l’argent, la théorie de la connaissance vénale, cumule et calcule ». C’est dire que le peu qui reste de la fluidité des sens, de la sensibilité, après que la Raison a pris possession de la culture, a été stocké, mis en banque. « Sans plaisir, sans grâce » souligne Michel Serres. Et André Gide de déplorer quant à lui, souvenirs de son enfance, « cette inhabilité foncière à mêler l’esprit et les sens, qui je crois m’est assez particulière, et qui devait bientôt devenir une des répugnances cardinales de ma vie12 ». Pire, avec les sciences c’est l’esthétique, dans les deux sens du terme, appliqué aux arts et à la philosophie (Kant), qui se meurt faute pour le Verbe de se faire chair à nouveau : même le langage se trouve dépassé par le calcul, quand il n’est pas dégradé par la logorrhée des médias.
On peut désespérer de l’intellect et des sens pris séparément, mais de leur alliance que ne pouvons-nous pas attendre encore ! Si Michel Serres conclut malgré tout que « le sujet, oublieux, détaché, plonge dans l’inoubliable monde », oublieux de sa sensibilité dans un monde inoubliable par sa diversité, c’est pour en appeler à un sursaut. La tente de La Dame à la Licorne, figurée dans la sixième et dernière tapisserie, reste entrouverte. Et, c’est du moins ce que le philosophe laisse entendre, Hermès, le messager des dieux, se tient en embuscade derrière Prométhée, donateur du feu civilisationnel, pour que s’impose ce sensorium commune, « sens commun à tous les sens, faisant lien, pont, passage entre eux, plaine banale, mitoyenne, collective, partagée » ; sixième sens doublement intégrateur, qui n’ose dire son nom, à la jonction des sens externes et du sens interne, à l’articulation du langage et du corps. « Le comportement n’est pas le simple produit de représentations mentales, il est également le résultat d’un contexte, des interactions avec un environnement » souligne Jacques Deschamps13, pour qui l’intelligence n’est pas l’intellect, entendons l’activité intellectuelle située dans la tête, le cerveau, mais constitue un complexe comportemental adaptatif incluant des formes de sensibilité que l’on retrouve dans les espèces du monde animal, même les plus primitives comme celles des céphalopodes : « … l’intelligence est une fonction adaptative susceptible d’infinies variations, une propriété partagée par tous les animaux. » Intériorité indiscernable du temps mêlée à l’extériorité insurmontable de l’espace, garantie de l’adaptation de l’espèce à l’environnement et de l’intégration de l’individu à la communauté.. Intériorité indiscernable du temps mêlée à l’extériorité insurmontable de l’espace, garantie de l’intégration de l’individu à la communauté. D’où appel concomitant, rien moins que désespéré, à la renaissance spirituelle et à la résurrection de la chair dans un monde de l’hybridation assumée. Milan Kundera l’exprimera avec force dans La Plaisanterie : « Que deux corps l’un à l’autre étrangers se conjuguent, ce n’est pas rare. Même la fusion des âmes peut se produire quelquefois. Mais il est mille fois plus rare qu’un corps s’unisse avec son âme et s’entende avec elle pour partager une passion. » Salutaire synesthésie.
D’une sophistique à l’autre
Serait-ce exagéré de dire qu’avec Donald Trump aux manettes d’un pays, allié des Européens, qui domine l’Occident, nous serions tombés de Charybde en Scylla ; des risques inhérents à une économie débridée en ceux d’une politique anarchisante, d’une hégémonie de la Raison en une exacerbation folle des sens, d’une hégémonie de la Raison en une exacerbation folle des sens, du tout État ou presque (État providence dont la faiblesse et le discrédit sont manifestes depuis la fin des Trente Glorieuses) au rien que société, mais société anomique ?
Le « trumpisme » ne s’est-il pas, en effet, laissé porter par le courant ambiant, répétition du même amplifié ? Son monde est celui du fait divers, mais dont la diversité relève plutôt de l’uniformité, si pauvre qu’il est en significations. Il y a longtemps qu’en Occident le monde des médias est un monde aplati où les faits et les dires ne sont plus hiérarchisés, ou s’ils le sont, c’est pour mettre en avant ceux qui sont le plus proches de nos préoccupations quotidiennes ou les plus sensationnels. Comme si, malgré la mondialisation, on appréhendait de dépasser ce qui nous est familier ; attraction de ce qui nous touche au plus près, même à un horizon lointain. C’est un paradoxe, en apparence du moins : plus la mondialisation s’impose, plus nous nous retranchons sur ce qui nous ressemble et moins sur ce qui nous rassemble, par-delà les frontières mêmes. Narcissisme dévastateur et verbosité nocive quand les désordres du monde et les agressions naturelles et humaines dont il est victime exigeraient toujours plus de solidarité. Narcisse englouti par les eaux à la surface desquelles il se mire. Mais avec Trump, on n’a plus affaire seulement avec le reflet que nous renvoient les médias mais avec le monde réel, celui auquel nous sommes confrontés à travers la politique. L’info et le débat en continu n’en peuvent mais à courir après l’action ; répétition vocale et visuelle du même, impuissante à saisir les différences dont les faits sont empreints.
La sophistique combattue par Platon en son temps serait donc de retour, mais en pire puisque si Protagoras et Gorgias avaient eu le mérite – par leur radicalisme provoquant – de nous alerter sur les excès d’une rhétorique évidée de son contenu de vérité, leurs émules du troisième millénaire n’ont rien trouvé de mieux que de jeter le bébé avec l’eau du bain ; soit, dit autrement, moins vulgairement, plus explicitement aussi, se débarrasser de l’habillage rhétorique avec son contenu. Ce qui n’est pas rien si l’on considère avec Buffon que « l’homme, c’est le style même ». Finesse du style, transparent à la matière jusqu’à en faire ressortir le tranchant. Style qui est moins dans les contrastes, lesquels font violence, que dans la nuance. Savoir discerner sans discriminer. À défaut d’encourager leurs congénères sur la voie de la démonstration rigoureuse, les sophistes, conscients de la relativité de toutes choses, de l’inanité de l’absoluité, avaient au moins eu le mérite d’initier à la démocratie en promouvant la libre discussion14 ; souplesse requise de la parole dans un monde porté à l’affrontement, à l’hubris ; la parole, force des faibles, mais qui est loin de toujours résister au fort. Pas plus de vérité que de rhétorique qui tiennent désormais avec Trump et ses complices du Tea Party : le libertarianisme contradictoirement associé à l’illibéralisme l’emporte, triomphe du non-sens qui se résout dans la performativité de l’action à l’état pur, c’est-à-dire non seulement délestée de toute réflexion a priori qui pourrait l’entraver, mais également de toute justification a posteriori susceptible de la remettre en cause. Trump et Poutine nous assure-t-on (pour nous tranquilliser ?) font toujours ce qu’ils disent ; peut-être, sauf que c’est toujours pour contredire ce qu’ils font, le premier surtout ! En conséquence, comme « l’homme est la mesure de toutes choses » selon le Protagoras de Platon, la politique sera à la mesure de chacun : souple avec les riches, dure avec ceux qui ne le sont pas ; la nature se chargeant de faire ruisseler le trop plein de richesse vers la pauvreté, qu’elle entretiendra, ce faisant, dans la juste mesure, celle de nos intérêts en propre. Reste le recours à la violence, que la rhétorique détournait. Ainsi va le Nouveau Monde avant de contaminer l’ancien aux frais d’un monde émergent qui ne sait plus où donner de la tête – côté Occident, côté Orient ? – lors même que, l’accumulation de la dette aidant, la faillite menace avec son cortège de famines en perspective, conséquence du tarissement de l’aide humanitaire ; laquelle dépasse, bien sûr, la mesure pour les nantis ! Pourtant, fait dire Laurence Durrel à une de ses héroïnes, Justine, du Quatuor d’Alexandrie : « La pauvreté exclut et la richesse isole15. » Ce que les pauvres, le sachant, tentent de compenser par la solidarité ; ce que les riches feignent d’ignorer à leurs dépens jusqu’à ce que la révolte explose.
D’où la question qui taraude : y a-t-il un après-Covid, comme il y eu un avant ? Question quelque peu vaine au premier abord, l’important étant moins de chercher à percer l’imprévisible – cygne noir ou rhinocéros gris16 ? – qu’à cerner l’impact d’un confinement qui nous a obligé à nous recroqueviller sur nous-même deux fois plus d’un mois durant et près d’un mois une troisième fois, le tout entre 2020 et 2021. À défaut de nous laisser entrevoir l’horizon d’une utopie de mixité sociale conciliable avec l’égalité, du moins aurait-on pu espérer qu’après la fermeture et le repliement sur soi, la sortie du confinement nous aurait ouvert à la diversité, nous prémunissant contre le retour de réflexes identitaires délétères.
Nous en sommes si loin que persévérer, avant comme après, dans l’œuvre de démystification, seule à même de dessiller les yeux des contemporains, de déconstruction pour parler comme Derrida17, semblerait plus que jamais urgent. – D’une part, en faisant l’inventaire de tous ces vocables qui rivalisent d’ambiguïté, dont on use et abuse sans discernement, et qu’il serait souhaitable de resituer une fois pour toutes dans leur contexte : le vivre-ensemble, poncif des intellectuels ; la mixité sociale, tarte à la crème des aménageurs et urbanistes ; la gouvernance, dédouanée du directivisme que recouvre tout gouvernement ; l’empowerment, aussi inapplicable qu’intraduisible ; la discrimination positive, i.e. « politiquement correcte » ; la colère passée de la liste des sept péchés capitaux à la sanctification des laissés-pour-compte de la gauche ; la souffrance sociale, toujours à partager, le bonheur, la joie, jamais (exception faite, toutefois, des Jeux Olympique de 2024) ; la résilience, transférée de la physique des matériaux à la psychologie18; la diversité, portée aux nues quand elle n’est pas brocardée ; la politique dite de la ville, si mal nommée puisque, focalisée sur le social, elle met à part l’urbanisme ; l’Autre avec une majuscule, dont on tend à faire une religion ; sans compter le culte de la différence, son corolaire ; etc. – D’autre part, en se libérant des oppositions sommaires déniant au tiers-exclu tout droit à l’existence : urbain/rural, ville/campagne, centre-ville/banlieue, urbain/social, inclusion/exclusion, mobilité/sédentarité, mixité/séparatisme, égalité/équité, communautarisme/individualisme, égalitarisme/différentialisme, universalité/identité, intégration/assimilation, dissidence/irénisme, culture/civilisation, patrimoine (de droite)/création (de gauche), valeurs/intérêts, les territoires contre les gens, la société contre la nature, Paris contre la province et tutti quanti. Certes, on s’identifie en s’opposant, mais non en excluant : la crainte de perdre son identité dans un « tout » indiscriminé ne justifie pas l’apartheid, séparatisme géographique plus que discrimination sociale. Reste à savoir si les mots qui portent les idées mènent, un tant soit peu encore, le monde ?
Si on peut tenir pour un hasard qu’il y ait eu concomitance entre les premiers soubresauts de l’épidémie de coronavirus et la première présidence de Donald Trump, il ne fait plus de doute que celle-ci ait trouvé en celle-là un terrain propice où se développer et rebondir après le déni, débouchant sur la sédition, de l’élection de Joe Biden : autant de frustrations que l’épidémie aura réveillées, autant d’instincts et de pulsions qu’elle aura, en contrepartie, libérés. C’aurait été, donc, bien en vain que l’on aurait réussi le déconfinement sur le plan sanitaire pour tomber dans une situation existentielle pire qu’avant ! C’est, pourtant, ce que la première présidence de Trump nous promettait déjà, que ni la démocratie américaine n’a su prévenir et que ni l’Atlantique n’a pu empêcher de franchir jusqu’à nous. Libérées de tout carcan, les réalités économiques, sociales, de politiques intérieure et internationale, déjà affectées par le néolibéralisme extrême des dernières années du deuxième millénaire et des premières du troisième, ne pouvaient que s’en ressentir.
Retour du refoulé et résurgence de l’urbaphobie
Cinq ans après l’importation de l’épidémie de coronavirus sur le continent, l’optimisme de Michel Serres est-il encore justifié ? C’est peu dire que, depuis, les évènements se sont emballés, les antagonismes creusés. Les réalités ont été ébranlées à mesure que les idées étaient bousculées. Encore faudrait-il distinguer entre les conséquences de l’épidémie, plus manifestes, et celles du confinement, plus subtiles. En affectant nos sens, les confinements répétés n’auraient-ils pas eu un impact sur notre perception du monde au point de la faire dévier de sa trajectoire, de la biaiser : impact politique affectant la représentation parlementaire, économique avec la prise de conscience brutale d’une dette « abyssale », social face à des inégalités de plus en plus mal supportées, écologique avec une sensibilité accrue au dérèglement climatique et à la réduction de la biodiversité, diplomatique avec les menaces de guerre qui se rapprochent ?
Purs hasards, sans le moindre lien entre eux ? longue chaîne de causes et d’effets ? séquelles de la contamination ? conséquences de la claustration ? Les extrêmes n’en furent-ils pas moins confortés et les oppositions n’en furent-elles pas plus tranchées ? Le processus qui a conduit à l’anesthésie de la pensée conjointement à l’assoupissement des sens n’est-il pas toujours en cours ? L’indignation vantée en 2010 par Stéphane Hessel comme moteur de résistance n’aura donc pas suffi. Après avoir écrit dans La vie de l’esprit : « Les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules », Hannah Arendt, à la question de savoir « Qu’est-ce qui nous fait penser ? », répondait : « La meilleure, en fait la seule manière que je puisse concevoir d’empoigner la question est de se mettre en quête d’un modèle, l’exemple d’un penseur non professionnel en qui se fondent deux passions apparemment contradictoires, la pensée et l’action […] ». Leçon de démocrate s’il en est, persuadé(e) que ce n’est pas la pensée qui fait défaut mais la volonté de penser. De même, dans le chapitre de la République relatant le mythe de la caverne (allégorie, rectifieront certains pour mieux faire valoir le rapport à l’existence), Platon, s’agissant de la connaissance, faisait dire à Socrate : « Cette puissance réside dans l’âme de chacun, ainsi que l’instrument grâce auquel chacun peut apprendre […] ». Or, qu’est-ce que la politique, demande Hannah Arendt dans La condition de l’homme moderne, sinon la pensée reliée à l’action, mais une action désintéressée, n’ayant pas d’objet en propre, qui est sa propre fin : pure « mise en relation » dans le cadre d’une « pluralité humaine » inéluctable. « L’acte ne prend sens que par la parole […] ». Pas, donc, de cloison étanche entre la politique et la vie individuelle, l’existence de tout un chacun, mais interférences, sinon interpénétration, corps sensible, parlant, à tous les étages, privés comme publics. Sans les mots ou avec des mots vides de sens, il ne reste que l’action à l’état brut, impossible à anticiper, à infléchir, à rectifier même. N’étant plus ni étayée ni accompagnée de jugements, laissée à elle-même, déchainée, elle est délire, hystérie, sans bornes susceptibles d’en contenir les débordements. Autant soutenir qu’elle est tout, sauf politique, c’est-à-dire rien ; à la merci du moindre battement d’ailes annonciateur de tempêtes propices aux ingérences les plus tyranniques se présentant comme salvatrices. En disant n’importe quoi, non seulement on évite de s’engager, mais, surtout, on couvre, sans risquer le désaveu, des modalités hégémoniques de l’agir au service d’intérêts de puissance monétisables. Tel serait le destin de sociétés dont les communications électroniques assureraient désormais le lien, les relations physiques (en présentiel dirions-nous plutôt aujourd’hui) passant au second plan. Sociétés sous influence, d’autant plus influençables que les influenceurs sont influencés, de sorte que des boucles de communautés se constituent virtuellement, pour lesquelles la « raison du plus fort » sera toujours concrètement la meilleure.
Conséquences géographiques et historiques : de nos jours, l’habitant de la planète Terre semble balancer entre ville et campagne, comme entre travail et loisirs ; jeux d’allers-retours, au gré des aléas de l’évolution qu’il ne maîtrise pas. La Modernité avait refoulé la nature au profit d’un artefact, la ville, promesse d’un futur mythique, avant que les affres de la pollution, des nuisances sonores, du stress et de la promiscuité n’en viennent à la dévaluer : urbaphobie que la pandémie a porté à la dernière extrémité en rendant l’« urbanité » responsable de la contamination. Ville refoulée, à son tour, au bénéfice d’une campagne idéalisée – pourtant dénaturée depuis longtemps – Paradis perdu, nouvel Éden ressurgi à la faveur du corps social meurtri, terrassé par le virus.
Le Covid-19, diabolique, n’a peut-être fait qu’accuser des tendances sous-jacentes que le retour de Trump à la présidence a permis d’exprimer au grand jour par-delà mers et océans. La polarisation des débats qui s’est ensuivie ne pouvait manquer d’avoir des répercussions, en France même, sur la perception de l’espace et du temps : disparités sociales, plus que jamais manifestes depuis la fin des « Trente Glorieuses », confortées, sinon renforcées, par une répartition inégalitaire des richesses entre territoires ruraux et urbains et, au sein de ces derniers, entre centre et périphérie. Dans les villes la pandémie aura plus affecté les quartiers défavorisés que les autres comme l’ont démontré pour le Grand Paris, statistiques à l’appui, Guy Burgel et al.19 Quant au confinement il aura plus touché les habitants des villes que les ruraux. Ce que Georg Simmel aurait expliqué par l’exacerbation des sens, effet du phénomène urbain sur les modes de vie20. Exacerbation de tous les sens, sens du goût compris comme l’illustraient les fêtes de voisins annuelles interrompues par le confinement. Ces fêtes réunissant le voisinage autour d’une tablée pour un soir, n’étaient-elles pas l’occasion de se retrouver pour partager ce qui nous différenciaient, autrement dit nos goûts, dans tous les sens du terme ?
Désertée, la ville victime du confinement nous apparut d’autant plus comme un décor de pierre qu’on avait auparavant négligé de la verdir. D’où la tentation irrépressible d’échapper à la claustration du foyer urbain et à la densité des métropoles pour s’égailler dans la campagne et dans les villes petites ou moyennes, réputées plus accueillantes, en mettant à profit l’outil numérique pour la formation et le travail à distance. Le confinement devait ainsi accélérer une tendance des trente dernières années marquée par la défiance vis-à-vis du mode de vie urbain et une aspiration à vivre plus près de la nature : inversion de l’exode rural contribuant à consacrer l’opposition rural/urbain dans les esprits oublieux que ce qui se joue est moins une question de répartition plus égalitaire de la population entre les territoires que celle de leur équipement, des transports et des moyens de communication ; ce que le mouvement des « Gilets jaunes » avait déjà exprimé. Aussi bien, est-ce à cette aune qu’apparait problématique la croissance des périphéries urbaines où se croisent des populations à la recherche d’un habitat abordable, des migrants à l’affut de meilleures conditions de vie, quand ce ne sont pas des néo-ruraux avides de retrouver des commodités urbaines à la campagne ; périphéries urbaines, quand le logement des classes soi-disant moyennes sont prises en tenailles entre les ensembles HLM et les résidences secondaires de la bourgeoisie aisée ; périphéries urbaines, otages de l’opposition idéologique entre le rural et l’urbain et de la croyance en un retour mythique à la nature conciliable avec les aménités urbaines !
« … pour “entrer”, il faut sortir…21 » énonce, en un semblant d’oxymore, François Jullien. Sortir de chez soi pour déambuler dans les rues, délaisser la ville pour renouer avec le terroir, renoncer à l’« urbain » pour le « rural » et vice versa. Ce ne sera jamais, précise l’auteur, sans cet « écart » du foyer à la rue, de la campagne à la ville, qui tient à « distance » et, partant, génère de l’« entre » pour mieux nous ouvrir à l’« Autre ». Cet « Autre » si facilement rejeté par les temps qui courent, mais dont il ne faudrait pas par réaction, prévient Philippe Irbarne22, faire une religion ; « Autre » sacralisé, anonyme dans l’universalité de son acception, abstraction qui se retourne contre ce qu’elle objective en niant les autres pris dans leurs singularité et diversité. Quant à l’« entre », l’exemple ambivalent en est donné par ces espaces communs aux ensembles d’habitation qui nous isolent de l’espace public sans nous en séparer autrement qu’unilatéralement comme le font les « gated communities », ou encore par ces « banlieues » qui mettent les villes à distance de leur environnement autant qu’elles les y relient. Depuis Paris et le désert français de Jean-François Gravier, l’hexagone connait des vagues périodiques d’urbaphobie, mais aucune n’a pris l’ampleur d’une déferlante comme celle que le Covid-19 a provoquée ; encore faudrait-il distinguer entre la phobie des villes en général et celle des grandes villes. La première édition de cet ouvrage, qui, dit-on, inspira les technocrates de la Ve République – lesquels imagineront, sur la base du constat dressé par le géographe, les « métropoles d’équilibre » – date de l’immédiat après-guerre, soit 1947. Plus de 60 ans se seront donc écoulés avant que François Jullien, dans l’essai cité plus haut, pose la question : « … comment concevoir aujourd’hui, par exemple, ce Paris où nous sommes en “Grand Paris”, si ce n’est également en activant un tel “entre” qui fait “tenir” et cohabiter ? » Et l’auteur de répondre :
« … si l’on veut qu’un Grand Paris “tienne”, il ne suffira pas de reporter sa frontière au-delà et d’en étendre plus loin la limite, mais il faudra nécessairement activer cet “entre”, entre les anciens villages et les vieux quartiers, cet entre vague, comme on dit terrain “vague”, ne possédant rien en propre […] mais qui seul peut mettre en tension cette agglomération nouvelle et la faire tenir ensemble : l’“entre-tenir”. »
Or, pour parvenir à cette conclusion, il n’en faudra pas moins à l’auteur passer par la pensée chinoise pour échapper à l’enfermement dans lequel nous tient la logique binaire de l’Occident, quand ce n’est pas la pensée unique. À l’encontre de cette logique, la philosophie du Yin et du Yang, sans commencement ni fin, suit une autre « voie », celle du Tao, dont l’orientation est inverse de celle empruntée par la Bible avec la Création, laquelle est rupture entre un avant et un après qui prend le risque de déboucher sur la contradiction et, à terme, sur l’exclusion ; séparation et individualisation qui culmineront dans la pensée agonistique des Grecs dont l’Occident est l’héritière. Contrairement à cette conception du temps, tributaire d’un commencement, dans lequel s’inscrit l’évènement de la naissance mis en exergue par Hannah Arendt, la conception développée par le Tao relève d’un processus continu, cadre d’une tension entre les extrêmes d’une polarité, à la fois génératrice et régulatrice. Tension et non rupture, continuité et non séparation, harmonie et non antagonisme ; harmonie dont procède l’effacement des différences, de ces différences qui nous ramènent toujours à une identité héritée du dualisme platonicien, en réaction à la diversité culturelle que la mondialisation a tenté de réduire en vain par le recours à la standardisation, provoquant en retour la nostalgie d’une communauté idyllique qui traîne derrière elle son cortège de fantasmes. Aussi, se distinguant de Deleuze, – pour qui la « différence » est ce qui fonde la répétition, qui la justifie même, en tant que jaillissement de singularités toujours nouvelles – Jullien préfère invoquer l’« écart » qui institue une distance, espace de réflexivité, seul à même de nous faire sortir des normes uniformisantes du marché et de nous faire prendre la mesure de la variété inhérente à toute culture, condition d’exercice de notre liberté. « Car, à l’heure où l’on s’alarme tant de l’épuisement des ressources naturelles, ne pourrait-on pas s’inquiéter tout autant de l’effacement – écrasement – de tant de ressources culturelles sous le grand rouleau compresseur de la mondialisation et de son marché ? » Bien plus, alors que la différence discrimine, c’est par la mise à distance, écart constitutif d’une réflexion mature, que l’on peut espérer remonter à ce fonds commun d’expériences communicables qui irrigue l’humanité, sans lequel il n’y aurait pas d’entente possible. Si « toute pensée est en elle-même écart interne qui la fait travailler », ce n’est jamais sans reconnaître l’altérité refoulée sous la strate de la culture dominante. « Car toute culture est, ne l’oublions pas, un rapport de force et, comme telle, travaillée par l’hétérogène. » Voilà pourquoi « cette pensée de l’écart nous sort tant de l’universalisme facile que du relativisme paresseux ». Voilà pourquoi, la sortie du confinement aurait pu être une opportunité de redécouvrir la nature de la ville, sa chair sous le décor de pierre ; nature indissociable de ses artefacts, infrastructures et constructions entrelacées comme des fils de trame et des fils de chaine ; creuset d’une humanité pensante, responsable, solidaire ; tous épithètes qu’elle est seule à avoir dans le règne du vivant. Ce qui nous éloigne d’un organicisme et d’un matérialisme sommaires, vulgarisés aux XIXe et XXe siècles sur les traces laissées en jachère ou piétinées de Spencer et de Marx.
Le réveil des sens : la réappropriation de l’urbain
La propagation de l’infection une fois freinée, refusant de nous laisser enfermer d’un côté ou de l’autre de la barrière discriminante de la santé imposée par la norme, nous avons refermé les fenêtres ouvertes sur la contemplation d’un dehors pétrifié pour rouvrir en grand la porte qui nous tenait cloîtrés, rendant au seuil sa fonction de limite et de transition : véritable défi au dualisme du dehors et du dedans, dont, à force d’être reclus, nous avions cruellement ressenti les effets délétères sur notre santé physique et morale. Dualisme du fond, qui nous met en contact avec l’intime, et de la forme, qui nous enserre dans son carcan, en nous séparant de l’extérieur ; de la chair vivante de nos congénères et du décor de pierre dans lequel ils évoluent. À nouveau immergés dans la ville, son effervescence, frustrés d’en avoir été privé, nous n’avons eu de cesse d’en explorer les moindres replis, « dérives urbaines » célébrées dans les années 1950 par les situationnistes23. Exploration tous azimuts d’agglomérats de pierre, de béton, de bitume et de végétal pour, de surprises en surprises, s’en émerveiller comme des plis et replis d’un drapé qui n’avaient plus rien à envier à ceux de la peinture baroque24. Tous azimuts sûrement, jusqu’en ses confins peut-être, mais non pas jusqu’en ces banlieues tenues pour suspectes, pourtant d’autant plus à redécouvrir que, jadis abusivement attirés par les séductions du centre-ville, nous les avions tenus à distance. C’eût sans doute été trop demandé. C’est tout le sens des frontières qu’il nous aurait alors fallu réinterpréter, de ces frontières qui nous relient autant qu’elles nous séparent : de la nature au sein de laquelle se ressourcer, de l’allogène auprès de qui se renouveler. Et cela, sans craindre de se mesurer à cette étrangeté qui est d’autant plus redoutée qu’elle prend la forme « dure » des grands ensembles des années 1960-1970, alors même qu’elle se révèle attractive quand elle se pare des couleurs et des parfums de l’exotisme25. Mais d’un exotisme authentique, dont se réclame par ailleurs un Victor Ségalen, celui des « exotes », amoureux de la diversité ; tout le contraire de l’exotisme de pacotille de ces voyageurs impénitents, « pseudo-exotes », dont ce dernier dénonce la superficialité, simulacre de l’exotisme vrai qu’il a été cherché au loin (Polynésie, Chine…), mais qu’aussi bien, étant plus tributaire de l’altérité que de la géographie, il a pu retrouver dans la proximité ; exotisme du divers pour autant qu’il se garde du métissage dont le risque serait qu’il conduise à l’uniformité. Ainsi en arrive-t-il
« à définir, à poser la sensation d’exotisme : qui n’est autre que la notion du différent ; la perception du Divers ; la connaissance que quelque chose n’est pas soi-même ; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de concevoir autre. »
« « Exotisme » : qu’il soit bien dit que je n’entends par là qu’une chose, mais universelle : le sentiment que j’ai du divers ; et par esthétique, l’exercice de ce même sentiment ; sa poursuite, son jeu, sa plus grande liberté ; sa plus grande acuité ; enfin sa plus claire et profonde beauté26. »
C’est que, contrepoint de l’idéoréalisme totalitaire de Saint-Pol-Roux,
« c’est par la Différence, et dans le Divers, que s’exalte l’existence. »
En conséquence de quoi, il faut bien se persuader que
« Ne peuvent sentir la Différence que ceux qui possèdent une Individualité forte. »
Différence dans la diversité, certes, mais différence d’avec le folklore également, celui d’un Pierre Loti, entre autres. Pourtant, au nom de la diversité même, ne peut-on pas adhérer intellectuellement à l’exotisme de Ségalen tout en restant « sensible » au charme quelque peu folklorique de l’auteur de Pêcheurs d’Islande et d’Azyiadé ?
Précision d’importance qui démontre les limites de l’universalité dont se réclame Ségalen : la diversité exclut toute hybridité susceptible de la menacer (rejet des « voyages mécaniques » et du féminisme comme attentatoires à la diversité) ; point sur lequel son concept d’ « exotisme » se sépare de celui de « créolisation » promu par Édouard Glissant, lequel ne tarit pas néanmoins d’éloge à son égard.
Exotisme à rapprocher du décentrement préconisé par François Jullien (v. supra), si ce n’est qu’avec le Yin et le Yang, extraits de la diversité du cosmos, du monde, de l’humain, on ne sort de la polarité que pour mieux accéder à l’harmonie. Pour l’auteur – qui se garde bien de parler d’exotisme – le détour par la Chine implique un dépaysement et en même temps, insiste-t-il, un retour ; retour sur soi. Loin de se fuir, de se perdre dans la diversité d’un exotisme de surface, il s’agirait bien plutôt de se retrouver, non dans l’extériorité mais dans l’altérité. Or, s’affronter à l’altérité, n’est-ce pas aussi prendre le risque de s’oublier dans l’Autre ? Risque qui n’échappe pas à l’entreprise de Ségalen.
Enfin, l’auteur des Immémoriaux va jusqu’à opposer à sa conception de l’Exotisme :
« l’Entropie : c’est la somme de toutes les forces internes , non différenciées, toutes les forces statiques, toutes les forces basses de l’énergie. »
Et d’ajouter, selon une formule dont il dit ignorer l’origine, que « l’Entropie de l’Univers tend vers un maximum ». Aussi se la représente-t-il
« comme un plus terrible monstre que le néant. Le néant est de glace et de froid. L’Entropie est tiède. Le néant est peut-être diamantin. L’Entropie est pâteuse. Une pâte tiède. »
Sous la pression du progrès, qui tend à l’uniformisation, l’exotisme s’use, finit par se dégrader :
« Le Divers décroit. Là est le grand danger terrestre. C’est donc contre cette déchéance qu’il faut lutter, se battre, – mourir peut-être avec la beauté. »
L’exotisme, à travers le divers de la diversité, ne serait-il pas alors l’alternative à cette entropie qui nous menace, encouragée par le mouvement MAGA dont les vagues déferlent sur les rives de l’Occident. Exotisme vrai de ces « Banlieues chéries », opposé à l’exotisme falsifié du marché touristique autant qu’au style international normalisé des grands ensembles en rupture d’ « urbanité ». Il n’aurait pu en aller autrement sans que le réveil des sens ne soit accompagné par une nouvelle façon de penser, une sensibilité étayée sur une raison non plus repliée sur le « dur » de la rationalité du verbe mais ouverte au « doux » du sensible échappant à cette « entropie pâteuse » dans laquelle le trumpisme voudrait nous étouffer. C’est Michel Serres, encore, qui nous y aurait invité : « Doux du dur et dur du doux, seuil transitionnel. » On en conviendra, « l’unité retrouvée d’un même lieu exceptionnel et familier donne une grande joie : le monde se donne pour beau, nous avons besoin de la beauté pour vivre ». Alors les portes, d’abord prudemment entrouvertes de nos foyers, auraient pu s’ouvrir en grand pour nous mettre en contact avec une architecture non de formes nues qui enserrent jusqu’à l’étouffement, mais de paysages qui enveloppent, nous protègent tout en facilitant la mise en relation avec « les autres », mise en relation d’autant plus problématique que « ces autres » proviennent de loin, d’une culture dont l’extériorité nous a fait perdre le sens humain qu’elle recèle.
La sortie du confinement était une opportunité pour faire une nouvelle révolution mentale associée à une quatrième blessure narcissique venant s’ajouter à celles précédemment infligées à l’humanité par Copernic (cosmologique), Darwin (anthropologique) et Freud (psychologique)27 : révolution éthique inversant notre rapport à autrui qui, n’étant plus considéré comme devant tourner autour du « moi haïssable » de Pascal, serait amené au centre, lieu nodal autour duquel graviter. Décentrement sans doute nécessaire pour échapper à la solitude arrogante des puissants sans, pour autant, craindre de se laisser déborder par l’altérité. En se transportant, en esprit au moins, critique en plus, dans les marges de la société – entre inclus et exclus –, à la limite des agglomérations – entre centre et périphérie –, aux frontières de l’espace national où se massent aujourd’hui les migrants, n’aurait-on pas pu espérer renouer avec un idéal communautaire perdu de vue, sinon avec un universalisme dissout dans la société atomisée du troisième millénaire, afin d’y puiser les forces qui nous manquent pour rompre avec la tentation du repli identitaire, lequel nous menace toujours d’étiolement ?
Face au péril d’un retour de l’épidémie, nous sommes bien confrontés au problème de la liberté. Non celle brandie, sans conscience, par les « antivax », mais celle du choix entre repli sur soi ou ouverture aux autres, enfermement dans la pénombre de la caverne ou exposition à la pleine lumière de la raison et des sens – condition de réalisation de la fraternité. « C’est ma responsabilité en face d’un visage me regardant comme absolument étranger […] qui constitue le fait originel de la fraternité » écrit Lévinas28 pour qui « le statut même de l’humain implique la fraternité et l’idée du genre humain ». Encore aurait-il fallu recouvrer notre corporéité dans sa plénitude, non seulement en tant qu’individus, mais – avant même que d’être sociables – en tant qu’êtres sociaux. Ce n’est pas en vain que nous aurions refermer les fenêtres pour ouvrir la porte de nos maisons : pour nous transporter corps et âme au dehors. Qu’est-ce qui nous soude, en effet, les uns aux autres, si ce ne sont ces sens que nous avons en commun dans un rapport à l’espace-temps instrumentalisé pour le meilleur et pour le pire, du bas en haut de l’échelle sociale, transversalement à la stratification des statuts, de la droite à la gauche de l’échiquier politique ? D’où l’impératif de réinvestir le corps social tel qu’il se déploie sur le territoire, marquèterie mouvante, peau ou voile sur lesquels s’impriment des disparités en recomposition incessante, au gré de mouvements de fond qui, pour être contingents, n’en sont pas moins l’objet de spéculations contre lesquelles mettre en garde. « … il n’y a pas de conception différentielle de l’âme, c’est du corps et de ses fonctions qu’on peut déduire des différences entre les manières de vivre […] », écrit Jacques Deschamps29, ce qui vaut pour l’âme de la personne humaine comme pour l’esprit de la ville.
De sorte que, passé le temps des confinements à répétition, le souci de l’intégration aurait dû l’emporter sur le séparatisme géographique et social, témoignant de notre capacité à vivre ensemble, sans tenir à distance ceux dont la différence est susceptible de nous porter ombrage. C’est l’esprit de la ville, un moment discrédité derrière les murs de nos foyers, rendu responsable de la contagion, qu’il aurait été sage de retrouver pour le conforter. C’est l’esprit de la ville, un moment discrédité derrière les murs de nos foyers, rendu responsable de la contagion, qu’il eut fallu retrouver pour le conforter, en en réintégrant le corps sensible et animé. Car, nous dit Georg Simmel30 « la ville est le haut lieu de la liberté intérieure et extérieure » et « un aspect fondamental de la vie urbaine est qu’elle transforme la lutte de l’homme contre la nature pour trouver sa nourriture en une lutte pour trouver d’autres hommes, si bien que le gain obtenu à force de lutte n’est pas accordé par la nature mais par l’homme ». Non qu’il faille opposer la nature et l’humain, le rural et l’urbain, mais considérer avec Aristote que la ville – a fortiori la Cité et l’État – est « un fait de nature » en tant qu’elle regroupe des hommes en association, et ce, au moins autant sinon plus que la campagne artificialisée par nos techniques culturales31. Or, « la nature de chaque chose est précisément sa fin ; et ce qu’est chacun des êtres quand il est parvenu à son entier développement, on dit que c’est là sa nature propre […]32 ». C’est en ce sens que la ville est indissociablement matière et forme, œuvre de l’homme, agglomération matérielle animée du souffle l’esprit. « En elle nous ne pouvons distinguer le sujet de l’objet, la fin des moyens, la conception de l’exécution. Si elle résulte manifestement d’un amas de faits techniques, elle semble, prise dans son ensemble, relever bien plus d’un fait de nature.33 » Nature conçue non comme une abstraction uniformisante à laquelle une certaine philosophie idéaliste l’a réduite (naturphilosophie allemande, dont Schelling fut l’initiateur), mais comme réalité faite de diversité – culture comme seconde nature. Plutôt que gommer l’un des termes de la polarité dont la tension est constitutive de toute vie, s’efforcer donc de penser les relations de l’urbain et du rural autrement. Un tel privilégiera la ville, plus assuré d’y faire des rencontres, quitte à se laisser surprendre ; tel autre fera, au contraire, valoir que la campagne est plus propice à se retrouver avec soi-même en communiquant seul à seul avec la nature. Qui se permettra d’en juger ? Sur le constat de l’évolution des mœurs sanctionnée au XIXe siècle par l’idéologie libérale, « ce n’est plus “l’homme en général” qui fait maintenant la valeur de l’individu, écrit Georg Simmel34, mais justement l’unicité et l’originalité des qualités de chacun. L’histoire de notre temps est celle de la lutte entre ces deux manières de définir le rôle du sujet à l’intérieur de l’ensemble, celle de leurs imbrications variables. » Ainsi, « la fonction de la ville est de faire place à la querelle et aux tentatives d’unification de ces deux tendances dans la mesure où le contexte particulier qu’elle représente leur donne à toutes deux des occasions et des raisons de se développer. »
S’il y a un « esprit de la ville », si cet esprit a été ébranlé par la pandémie, sa réassurance passe donc par le réinvestissement du corps de la ville, corps sensible ; non pas en opposition à la campagne mais en solidarité avec elle – pas de ville sans hinterland. Il ne faudrait pas, en effet, qu’ayant risqué la contagion nous en imputions la cause à la ville, laissant accroire qu’en la fuyant nous renouerions avec une nature dont la vocation pourrait être purgative. « La nature, écrit Jacques Deschamps35, peut nous aider à guérir de certains de nos maux, physiques ou psychiques, mais elle ne peut pas transformer les sociétés dont les contradictions économiques et politiques sont à l’origine de la plus grande partie des souffrances qui rongent le cœur même de ce qui fait notre humanité. » Ce serait tomber dans un mirage qui nous ferait bientôt regretter le port d’attache que constitue l’urbain, l’habitat aggloméré, nous rendant nostalgique de cet air de la ville qui nous relie aux autres comme nulle autre institution humaine. Le séparatisme est la tare dont nous héritons de toute une tradition occidentale : séparatisme non seulement social, mais religieux, non seulement culturel mais idéologique et politique, séparatisme physique autant que spirituel ; séparatismes que le temps n’a fait que renforcer et la géographie cristalliser, conséquence d’une politique urbaine relevant d’une conception sélective de l’aménagement du territoire, pour ne pas dire ségrégative, tant au niveau national qu’européen – sachant que l’accession de la société à plus de justice dépendra à l’avenir du rapiéçage du tissu qui la constitue. Dans un entretien d’octobre 2019 sur RTL, le président Macron avait bien cerné le problème : « Dans certains endroits de notre République, il y a un séparatisme qui s’est installé, c’est-à-dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République. » De la “lutte contre le communautarisme” à la « guerre au séparatisme », le vocabulaire présidentiel avait évolué afin de contourner ce que la première expression pouvait avoir de stigmatisant pour les citoyens de confession musulmane. Hélas ! la loi du 24 août 2021 “confortant le respect des principes de la République”, pourtant dite “sur le séparatisme” ne traitait plus que de lutte contre certaines formes de communautarisme, évacuant la question du séparatisme urbain. Séparatisme des quartiers défavorisés, pourtant dits sensibles, d’avec la ville, mais aussi séparatisme social/urbain interne à la ville, autrement dit, dissociation de la composition urbaine, physique, d’avec l’esprit qui anime la société locale ; conception d’une ville uniformément imposée aux citadins, sans tenir compte de la variété des sensibilités exprimées ou dormantes. C’est pourtant l’enjeu humain d’une unité spatiale – agencement du bâti, des réseaux et des services liés – que de répondre aux attentes, d’assurer une répartition des catégories de population sur le territoire qui tende vers l’équilibre, de réaliser l’adéquation entre besoins et aspirations, d’une part, formes urbaines et équipements, d’autre part – tout le contraire d’une uniformisation ; soit, la recherche des conditions d’une consonance de la matérialité urbaine et du social à travers la promotion du paysage urbain dont l’hétérogénéité serait la clé. Bernard Lassus l’a montré à travers l’exemple de la ceinture verte de Francfort, laquelle lui fait dire36 : « L’hétérogénéité est plus accueillante que l’homogénéité. » Hétérogénéité paysagère, reflet de la diversité humaine, que l’on appréhende alors même que l’on déplore la baisse du niveau de biodiversité. Diversité par ailleurs brocardée quand elle est revendiquée pour compenser à peu de frais une carence de « vivre-ensemble », ou sollicitée comme contrepartie d’un défaut de considération, de l’indifférence envers ses semblables ou, encore, quand l’objectif inavoué est de masquer une discrimination sous-jacente dont l’éradication porterait atteinte à des privilèges. Pourtant, diversité inhérente à notre commune humanité à l’instar de ce qu’elle est dans la nature animale et végétale, diversité spécifique au genre Homo également. Symptomatique est, à cet égard, la plasticité de son régime alimentaire : si loin qu’ont pu remonter les préhistoriens, ses espèces auraient toujours été omnivores, privilège qu’elles partagent avec peu d’autres du règne animal, dont les grands singes comme le chimpanzé, plus proche cousin d’Homo sapiens. Le rapprochement entre diversité culturelle et alimentaire peut paraître grossier, il n’en a pas moins inspiré un matérialiste comme Ludwig Feuerbach37. Selon la même règle de proportionnalité : la pensée serait à l’esprit comme la nourriture est au corps. En remontant vers les origines de notre humanité, marquées du sceau de l’animisme, « le monde est une symbiose d’êtres différents par leur apparence extérieure mais semblables par leur nature » rappelle Jacques Deschamps38, à telle enseigne que « l’inné et l’acquis, le naturel et le culturel, ne sont pas séparés mais pris dans un entrelacs morphologique et fonctionnel qui varie selon les groupes zoologiques. » C’est ainsi qu’ « à la différence de l’animal, mieux équipé pour vivre que pour penser, l’homme est mieux disposé pour penser que pour vivre. » Universalité de la diversité, et de tout temps, ainsi que Darwin l’a exposé dans son œuvre39, fond sur lequel se détache notre humanité, indissociable de l’animalité sinon à la marge, pas n’importe que laquelle, celle de l’esprit. L’hybridité ne recoupe pas seulement la diversité dans l’espace, dans le temps aussi. Alain Testart40 en a apporté la démonstration : la sédentarisation liée à l’urbanisation ne l’a pas toujours été à l’agriculture et à l’élevage, comme on l’a cru longtemps, des chasseurs-cueilleurs ont connu des phases de sédentarisation ; d’autre part, au Moyen Orient notamment, des villes ont décliné pour céder la place à un mode de vie rurale. Enfin, « L’importance jouée par l’hétérogénéité et l’hybridité culturelle dans le processus de formation des civilisations » a également été soulignée par Shin’ishi Nakamura41. Culturelle ou naturelle ? En sociologie, on ne pourra manquer d’observer que la « gentrification » de quartiers populaires, encouragée par artifice, conduit à leur uniformisation par éviction insensible des catégories allogènes par la bourgeoisie nouvelle venue. La diversité ne s’improvise pas, c’est dans le « peuple » qu’elle réside et mute, originellement ; la bourgeoisie uniformise, tendanciellement. Ce n’est pas pour autant que le métissage, forme d’hybridation culturelle, conduit à terme à l’uniformisation comme le craint Victor Ségalen, parmi d’autres plus pervers ; plutôt à un renouvellement de la diversité dépendant du degré d’imbrication spatiale du local dans le global. Quand les mariages consanguins conduisent à la dégénérescence, le métissage s’enrichit des différences, dont l’abâtardissement n’est qu’un simulacre, une imitation honteuse. Étant toutefois précisé que le métissage ethnique n’est pas non plus la reproduction de l’hybridité biologique.
D’où l’intérêt, capital, du travail sur l’espace que la ville partage avec le rural, sur le temps qui les différencie, dont les rythmes scandent les existences : enjeux d’une politique urbaine confrontée à l’aménagement du territoire, cinq sens pour quatre points cardinaux, un sens surnuméraire, le goût, sens interne, et un sixième sens, bon sens parce que commun, intégrateur. Lassés de contourner les champs disséminés de nos campagnes, les chemins ne finissent-ils pas par converger vers la ville pour se démultiplier dans sa densité minérale ? Aussi, à rebours des avertissements alarmistes des collapsologues, n’y a-t-il rien de mieux à faire que de « prendre la mesure du réel » pour, avec Corine Pelluchon42, « passer de la sidération » dans laquelle nous plonge l’éventualité d’un effondrement de la planète à la « considération ». C’est que « dans la considération, la rationalité exerce son action sur l’infrarationnel sans le réprimer. […] L’ancrage du sujet dans la corporéité et le travail sur la matérialité de ses sensations lui permettent d’être à la fois plus lucide et créatif. » Or, où ce travail trouverait-il mieux les conditions de son accomplissement, si ce n’est dans le corps de la ville ? Une ville exonérée du travail de la terre, réduite à un sol support. Libéré de cette contrainte, le citadin redevient nomade, tandis que l’agriculteur, soulagé par la mécanisation et la numérisation n’en reste pas moins solidaire de sa terre. Une terre qui reste lui appartenir en propre, alors que le citadin est condamné à la partager. Il n’empêche, malgré ou à cause de ces spécificités, « la société entière devient urbaine » écrivait Henri Lefebvre dès 1972, avant les autres, dans Espace et politique.
L’occasion manquée : renversement de perspectives
Par la fenêtre de nos intérieurs confinés, la ville dégagée des pollutions sonores qui la submergeait, se révélait comme un décor figé que seuls venaient troubler le frémissement du feuillage des arbres et le pépiement des oiseaux. Déconfinés, nous avons refusé de voir qu’un autre confinement perdurait silencieusement – pour un temps indéfini – aux limites de l’urbain : celui des territoires négligés, délaissés, que sont, aux deux extrêmes d’une géographie fractionnée, les banlieues défavorisées et les campagnes désertées. Pourquoi détournons-nous les yeux de ces confins du monde urbain et rural, si ce n’est qu’ils nous révèlent par trop nos travers, les accusant comme un miroir grossissant et déformant. Isolement de la campagne opposé à la promiscuité de la banlieue, lieu de relégation où même la police censée y faire régner l’ordre, sinon le droit, répugne à intervenir. Police redoutée en centre-ville, quand elle n’est pas détestée, à laquelle on fait reproche de ne pas sévir quand il le faudrait en ses périphéries ou dans ces noyaux durs que sont les grands ensembles. Pourquoi ce rejet des marges, si ce n’est que les habitants de ces morceaux de ville, façonnés après-guerre en opposition au monde rural et en lisière de l’agglomération, se sont retrouvés isolés malgré eux, représentant « les autres », ceux que l’on repousse comme inassimilables au regard des standards de la société urbaine. Refus de la différence ethnique, économique, sociale, culturelle…, dont les marqueurs sont autant physiques que comportementaux. De sorte que la diversité humaine projetée sur l’espace éclate en une mosaïque dont les mille et une nuances, à force de se disperser, finissent par se heurter. Pas même besoin d’être confrontés à l’immigration pour se sentir « étranger », le qualificatif est extensible à volonté, les Américains d’aujourd’hui en font cruellement l’expérience avec Trump qui licencie à tour de bras ceux de ses compatriotes qui sont réfractaires à son idéologie et pratique le « dégagisme » à grande échelle dans le même temps, même si ce n’est pas dans les mêmes formes, où il pourchasse les migrants avec l’aide de l’ICE43, qui lui est entièrement dévoué.
Ainsi y va-t-il d’une société fragmentée : l’individu recherchant en vain son semblable, rêve d’une harmonie originelle qu’il ne pourrait retrouver que dans le cloisonnement de sa communauté d’appartenance et au prix de l’exclusion de l’« étranger ». Et si la promiscuité est tant redoutée, n’est-ce pas en raison de cette incapacité à ménager l’« écart » nécessaire à la reconnaissance de l’« Autre » compris dans sa concrétude, sa chair ? Irréductible écart à l’horizon d’une évolution sociale allant dans le sens d’une hybridation (phénomène naturel avant d’être artificiel) ou créolisation (son pendant culturel, revendiqué par Edouard Glissant44), antidote au « grand remplacement » ; créolisation indument récupérée par Jean-Luc Mélenchon, dont les revirements opportunistes et les dérives antisémites de son entourage sont avérés, même s’il s’en défend.
Nécessaire réenchantement après le désenchantement wébérien, retissage des liens entre citoyens et avec la terre nourricière. Alors que, dans L’Immoraliste d’André Gide, Ménalque pose la question désenchantée : « Savez-vous ce qui fait de la poésie aujourd’hui et de la philosophie surtout, lettres mortes ? » répond : « c’est qu’elles sont séparées de la vie », Poutine, de son côté, console une mère éplorée par la mort au combat de son fils en Ukraine en lui assénant que la vie ne vaut que par le « sens » qu’on lui donne, dont elle peut être fier. Lequel « sens » est pour lui indissociable de la Russie éternelle dans son espace « naturel », c’est-à-dire conquis par la force. « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » résumait Garine dans Les Conquérants de Malraux.
N’avons-nous pas présumé des pouvoirs de la dialectique censée surmonter les contradictions ? Revenus des illusions d’un avenir idyllique fondé sur leur dépassement, n’est-il pas temps de renouer avec une dialogique les assumant ainsi que nous y invite Edgar Morin à travers le concept de complexité45 : « Le principe dialogique nous permet de maintenir la dualité au sein de l’unité. Il associe deux termes à la fois complémentaires et antagonistes. » Complexité dont la politique est partie prenante – son sens en étant tributaire – mais que la tentation est d’évacuer. Le « trumpisme » ne s’en est pas privé, qui l’a réduite à sa portion congrue, à savoir un affairisme d’autant plus florissant que la paix sera imposée même au prix des plus grandes injustices. Politique de dupes, dont les européens sont les victimes consentantes, comme si, par un jeu de vases communicants, ils en adoptaient d’autant mieux les travers qu’ils vidaient leurs politiques de toute substance. Coupable passivité, sinon lâcheté malgré quelques voix discordantes, démission face aux problèmes cruciaux que posent l’existence social et les rapports de force internationaux.
Complexité que nous avions sous-estimée dans le passé, aveuglés que nous étions par un messianisme venu du fond des âges (messianisme juif), réactivé à la faveur du romantisme associé à l’historicisme (marxisme) dans l’espoir de vaincre la misère, même si ce devait être au prix d’une violence (révolution d’octobre) dont on ne soupçonnait pas alors qu’elle pourrait se concentrer, comme aujourd’hui, aux deux pôles de l’axe structurant la politique : sur sa droite et sur sa gauche, extrema qui tendent à converger dans le populisme en un apex vertigineux sur ses deux faces. Scandale que d’assister, impuissants, aux insanités et dérives langagières de politiques qui, confrontés à des massacres en masse, passent leur temps à discuter de leur qualification, crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocides, faute de savoir, ou de pouvoir, y mettre un terme. Qualifications juridiques sur lesquelles il appartiendrait à un juge unanimement reconnu par les nations – ce qui n’est pas encore le cas de la Cour Pénale Internationale (CPI) – de se prononcer, et non aux justiciables de la défense et de l’accusation, tentés d’y rechercher des circonstances atténuantes ou aggravantes. Un crime reste un crime malgré tout !
Nous en aurions oublié que les grands-parents et parents de la génération des milléniaux ont, en résistant au péril de leur vie pour les uns, en attentistes prudents pour les autres, vaincu le nazisme et le fascisme en 1945, avant de triompher – en spectateurs passifs, tous les uns autant que les autres – du communisme en 1989. Les nostalgiques de l’idéal communiste comme Alain Badiou se comptent aujourd’hui sur les doigts de la main, qui ont passé sous silence, quand ils n’ont pas cautionné, l’hécatombe des Khmers rouges. Ce n’est pas stigmatiser les baby-boomers que de reconnaître qu’ils ont été trop heureux de vivre après-guerre les Trente Glorieuses de leurs parents dans l’insouciance des lendemains, ceux qui ne chantent plus. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir été bien lotis par le sort (rapport à la grande loterie des naissances) : selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à peine 1 % des enfants nés en 2000 dans les pays à indice de développement humain (IDH) très élevé mourront avant 20 ans contre 17 % dans les pays à indice de développement faible, et plus de 50 % des jeunes de 20 ans des pays à IDH élevé font des études supérieures, contre 3 % seulement dans les pays à développement faible46. Mais nous, Occidentaux, ne connaissons pas notre bonheur et encore moins les atouts dont nous disposons pour l’élever à la hauteur d’une sagesse.
Avoir rêvé la révolution en mai 68 – dans le chambard, en jetant des pavés contre les forces d’un ordre honni – au lieu de la faire n’engageait à rien. Elle n’en révélait pas moins une réaction violente contre une éducation aussi moralisante que laxiste associée à la trahison d’idéaux qu’un christianisme authentique n’aurait pas reniés et dont une bourgeoisie rassise se réclamait contre toute pudeur. La révolution n’a pas eu lieu, mais le rêve a persisté, récupéré par les pouvoirs économiques – confondus dans le système, terminologie chère aux avant-gardes de gauche – qui n’ont dès lors eu de cesse de convaincre qu’en libéralisant à outrance, qu’en dérégulant à tout va et qu’en compensant les ratés d’une politique des revenus, censée réduire les inégalités, par des réformes plus sociétales que sociales (cf. le mandat de Giscard d’Estaing), les rêves de mai 68 se réaliseraient ou seraient oubliés. Face aux ravages inflationnistes d’une politique économique fondée sur la demande, il n’en fallait pas plus pour qu’en 2012 le président Hollande, annonçant son pacte de compétitivité, rallie une grande partie des socialistes à la politique de l’offre. C’était, dune part, reconnaître l’ambiguïté des notions d’offre et de demande : quand la droite prétend fonder l’économie sur l’offre et la gauche sur la demande, inversement, en matière culturelle, c’est la droite qui mise sur l’offre (cf. les Maisons de la culture) et la gauche sur la demande à laquelle il faut s’adapter (comme le font les Maisons des jeunes et de la culture) ; ce qu’une ministre pourtant de droite, Rachida Dati, à bien compris. C’était, d’autre part, reconnaître leur dépendance réciproque, à savoir qu’il ne saurait pas plus y avoir de débouchés sans consommateurs, que de consommateurs sans production de biens et de services. Si la loi de notre gloire nationale en économie, Jean-Baptiste Say, n’allait pas de soi, le keynésianisme, en mettant l’accent sur la demande, pourrait bien aussi fait son temps, dont l’économie est tributaire à l’instar de la politique. Tournant stratégique du parti socialiste, compromis une droite libérale et une gauche se réclamant d’un État fort, prise de conscience tardive des conséquences à long terme du choc pétrolier des années 1970, de la crise des subprimes en 2007-2008 et de l’enchainement des désordres internationaux qui se sont ensuivis : appauvrissement du « Sud global », victime du consensus de Washington des années 1990, extension du terrorisme sur le territoire national, guerres menées par procuration. Et pour couronner le tout : le soupçon jeté sur la démocratie, incapable de s’assurer la maîtrise de l’économie. Autant de désordres que le passage à un nouveau millénaire n’a pas interrompus, a peut-être même accentués par défaut d’anticipation. Retrait du politique au profit de la politique, dirait Marcel Gauchet47, mais au détriment de la démocratie.
Populisme versus démocratie
Faut-il désespérer de la gauche, sachant qu’elle ne peut prétendre ni au monopole de la justice ni à celui de la représentation populaire ? La démocratie, pour s’opposer au populisme des extrêmes, n’est-elle pas autant de gauche que de droite, se différenciant plus par l’économique et le social que par le politique. Ne se distinguerait-elle pas plutôt par une certaine manière d’articuler ses idéaux, relevant de l’universel, avec des intérêts particuliers ? Ainsi de la valeur travail – concept, économique à la base, hérité d’Adam Smith, fondateur de l’économie libérale au XVIIIe siècle, renié au profit de l’utilitarisme par le néoclassicisme et réapproprié par Marx au XIXe siècle – aujourd’hui réhabilitée économiquement par la droite, remise en cause politiquement par la gauche : s’opposer obstinément au recul de l’âge de la retraite, lors-même que les progrès de l’hygiène et de la médecine tendent à la prolongation de la vie, ne constitue-t-il pas une trahison des valeurs de gauche ? De même la gauche ne serait-elle pas plus fidèle à ses valeurs en accordant la priorité à l’amélioration des conditions de travail sur le temps de loisirs ; au XIXe siècle Paul Lafargue, le gendre de Marx, avait beau jeu de s’en prendre au droit du travail dans Le droit à la paresse, écrit en 1880, à une époque où le travail, compte tenu des conditions qui lui étaient faites, pouvait renvoyer à son étymologie – aujourd’hui contestée – d’instrument de torture (tripalium), le travail comme châtiment infligé par la bourgeoisie élue au peuple, entaché par le péché originel ! Encore faudrait-il se garder de mettre sur le même plan la question de l’âge de départ à la retraite avec celle de la durée hebdomadaire du travail, le parallèle étant trompeur, sachant que la réduction de la journée de travail peut être justifiée par des progrès de productivité. Pourquoi faudrait-il opposer le loisir au travail quand ils pourraient être considérés aussi nobles l’un que l’autre en tant qu’ « activités » également promues par la morale sociale et l’éducation ? Il n’y a pas de priorité qui tienne en la matière, seulement une question de remplissage d’un temps vide, et de sa qualité, que ce soit de travail ou de loisirs, dans le respect de la liberté que l’exigence d’égalité, requise par le siècle, autorise ; égalité toujours relative dans son contexte. Pourquoi, d’autre part, la revalorisation du travail devrait-elle passer par la dévalorisation de l’argent, la dévaluation de la richesse, qui en dépend (richesse financière mise à part, qui n’est qu’une pseudo-richesse fondée sur le prêt à intérêt) ? Sur le constat navrant, logiquement et moralement, que plus de la moitié des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu ne sont pas imposés alors qu’ils ne sont qu’un tiers à avoir un revenu inférieur au taux minimal d’imposition, la recherche d’une meilleure répartition de l’impôt, en ciblant les bénéfices non réinvestis et en supprimant les niches fiscales non justifiées, ne devrait-elle pas être préférée à la chasse aux riches ou aux oisifs comme on va à celle du gibier ? Objectif complexe que la fiscalité dans son articulation à l’économique et au social, on en conviendra, mais pas compliqué dans ses formulations au point de ne pouvoir être débattu sereinement avec des arguments prenant en compte la sensibilité dont chacun est porteur .
Incohérence ou lâcheté à gauche comme à droite : à gauche pour qui défendre les migrants n’empêche pas de préconiser un protectionnisme rassurant sinon douillet, à droite pour être réfractaire à tout effort fiscal et tenté par l’exil dans le même temps où on affiche un tropisme pour la nation, nationalisme déguisé en patriotisme pour la bonne cause. Contradictions insurmontables dans un univers de pensée enfermé dans un « binarisme » hostile à tout compromis. En témoigne piteusement l’Assemblée nationale sortie des urnes en 2024 où les débats budgétaires en sont réduits à opposer de manière simpliste la diminution des dépenses à l’augmentation des impôts, les services publics au respect des intérêts particuliers ; à cibler les riches contre les pauvres, à ignorer les catégories entre-deux. Et ce, au détriment de toute réflexion sur la structure d’un budget plombé par la dette, dont l’équité est un paramètre qui exigerait une répartition équilibrée des efforts à consentir par les entrepreneurs et les consommateurs, les actifs et les retraités, les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux ; tous citoyens, également acteurs sur la scène nationale. L’histoire ne nous enseigne-t-elle pas que si la collectivisation des moyens de production a fait la preuve de son incompatibilité avec l’initiative, motrice d’une économie progressiste, son échec appelle à renouer avec la privatisation tout en sachant que, vivant en collectivité, il nous faut composer avec le collectif. On ne passe pas impunément d’un régime à l’autre, de l’individuel au collectif et inversement ; Condorcet en avait apporté politiquement la preuve48, à sa suite Kenneth Arrow l’a théorisé sur le plan économique49.
Travail contre loisir, richesse contre pauvreté, service public contre initiative privée, trois exemples types de ces oppositions binaires stériles au service de rivalités intéressées qui brident les parlementaires. Tout s’opposerait à tout, sans nuances. « Binarisme » qui résume la politique, écartelée entre : – les priorités à accorder respectivement à l’argumentation de fond et à la stratégie ou à la tactique ; – le laisser-faire économique, jugé « naturel », et l’interventionnisme, pour sa fonction régulatrice ; – la compassion pour les « victimes » de la pauvreté, vouées à l’assistanat, et la considération pour les riches, taxables à volonté, et ce, jusqu’à en oublier le poids et la diversité de la classe dite moyenne, pourtant clientèle fourre-tout des politiques ; – le privilège conféré au sociétal, qui tend à faire consensus (au-delà des clivages religieux, de moins en moins prégnants), et celui attribué au social, qui divise, sachant que les questions de genre (féminisme, promotion du queer) peuvent prendre, dans le débat politique, des proportions faisant diversion ; – l’engagement pour l’écologie, sans égards aux impératifs d’équité qu’il implique, et les réserves qu’il peut susciter au motif de son incompatibilité avec la croissance ; – la défense de l’universalisme des valeurs de la République et la tentation de s’abriter derrière des questions identitaires pour traiter de problèmes transfrontaliers comme l’immigration ; – le protectionnisme et le libre-échange : doctrines contradictoirement mises en œuvre selon qu’il s’agisse de biens ou de personnes ; – le principe de souveraineté et le droit d’ingérence, l’importation sur le territoire national de conflits externes, comme celui opposant Israël aux Palestiniens, permettant de combler opportunément le déficit de politique à usage interne. Tout bien considéré, la pensée binaire conduirait à la trahison des valeurs de la démocratie, sacrifiées à la compétition avec les partis extrémistes, et ce, au nom de la défense des intérêts du peuple, instrumentalisé pour ce faire. De sujet de la lutte des classes le peuple est, ainsi, devenu objet de cette compétition, oublié par les partis de gouvernement, alors que l’enjeu commanderait de faire prévaloir des valeurs communes, sans préjudice de la diversité des intérêts, en vue de lui redonner une consistance, une chair, que la volonté générale, prônée par Rousseau, tend – abstraction oblige – à lui soustraire ?
Est-il, pour autant justifié de mettre sur un même plan extrême gauche et extrême droite confondus dans le populisme ? Stratégiquement, ce serait non seulement sous-estimer la dangerosité d’une extrême droite en pôle position sur le plan international, mais encore s’aveugler sur ce qui sépare une mouvance aux racines fascistes profondément ancrées – non sans qu’elle cherche à faire bonne figure – d’un mouvement dont les traditions démocratiques, qui remontent à Jaurès, ne peuvent lui être déniées malgré les dérives profondes qui ont entamé son crédit. Perversité des intentions des premiers contre noblesse ou naïveté de celles des seconds ? Rivalité héritée d’une droite la plus bête du monde (déclaration50 de Guy Mollet en 1957) et d’une gauche pas moins bête, à défaut d’être méchante (livre51 de Jean Dutour publié en 1992) ? Il n’empêche, sur le fond, le populisme est le dénominateur commun aux deux tendances : celui d’une « revendication politico-morale d’un monopole de la représentation » selon Jan-Werner Müller, politiste52, pour qui le populisme se distinguerait par un « anti-pluralisme farouche », que la gauche radicale ne serait, hélas ! pas loin de rejoindre. Gouverner une masse uniforme étant tellement plus facile que présider aux destinées d’une multiplicité diversifiée !
Périlleuse est alors la propension à réduire la politique à un « état d’esprit », en rupture avec les idéologies globalisantes du passé. Le risque est double. Celui, d’une part, de se servir de la politique comme exutoire de nos frustrations refoulées ; nos sympathies et nos inimitiés inavouables se parant opportunément des couleurs de la droite et de la gauche pour exploser à moindre frais. Celui, d’autre part, de délaisser les idées au profit de l’action impulsive, dont les affinités avec le nihilisme nietzschéen déboucheraient sur une surestimation du pouvoir des sens, de ces cinq sens que la modernité avait tenté d’étouffer dans l’abstraction et le calcul. La prégnance de la réalité sensible rendrait vaine la recherche de la vérité. À force de tomber d’un excès dans l’autre, de Charybde en Scylla, de la monotonie de la raison triomphante dans l’exubérance des sensations laissées à elles-mêmes, de la raideur des jardins à la française dans le faux fatras des jardins à l’anglaise, des formes « dures » du Mouvement moderne, celles des grands ensembles des années 1960, dans les formes « douces » de l’architecture postmoderne53, le temps qui court serait la préfiguration d’un apolitisme généralisé, fondé sur un libre-échange de valeurs numériques où tout se vaut, sans entraves, que Trump annonçait dès son premier mandat : personnalisation à outrance du politique sur fond de populisme dégradé, aplatissement du régime des valeurs sous un brouillamini de façade qui en masque l’uniformité, reniement de la diversité du monde par le bas, individualisme forcené en guerre contre ce qui fait société54. Aussi bien, le moindre des paradoxes du trumpisme est-il d’opposer binairement la Great America aux autres pays, à tous les autres, en faisant fi du multilatéralisme, alors qu’il a affaire à un monde polycentré dont il feint d’ignorer les différences (selon Deleuze) ou les écarts (selon Jullien), entrave à ses ambitions de domination commerciale. De sorte que le libertarisme confine chez lui avec l’illibéralisme : confusionnisme qui l’a amené à rechercher la proximité du Russe Poutine pour mieux s’opposer au Chinois Xi Jinping, lors même que le premier cherche à se rapprocher du second, et que les deux s’efforcent de séduire, le plus cyniquement du monde, un « Sud global » que l’Américain a tendance à sous-estimer, sinon à mépriser. Raison pour laquelle – les États-Unis donnant généralement le ton à l’Europe pour ce qui est de l’évolution des mœurs et de la politique55 et Trump, le libertarien, faisant le lit du despotisme poutinien – il serait aisé de pronostiquer que le continent européen pourrait devenir à terme le lieu de convergence des régimes politiques américain et russe, lieu de convergence de nature agonistique dont l’Europe ferait les frais, entraînant avec elle dans la décadence ou la chute d’un « Sud global » déjà bien fragilisé par la voracité des pays détenteurs de la puissance ou de la richesse. Clôture du binarisme qui s’annulerait de lui-même dans un totalitarisme unitaire glaçant !
L’hybridation : parade au « grand remplacement »
Alors, la prise de conscience de la complexité ne devrait-elle pas conduire à une sorte d’hybridation du rêve et de la réalité dans une « utopie » entrelaçant les idéaux de gauche avec un réalisme de droite, avec pour objectif : – de faire prévaloir la volonté constructive du politique sur la « main invisible » du marché ; – considérant que l’équilibre général des économistes classiques et néoclassiques est un mirage, de se saisir des opportunités que peuvent constituer les déséquilibres économiques, virtuellement riches de promesses d’innovation (cf. la théorie du déséquilibre d’Edmond Malinvaud, postkeynésien) ; – de desserrer la pression des marchés financiers en procédant aux ajustements économiques favorables à la production ; – de sortir d’une logique dispendieuse de redistribution, censée porter remède aux excès de l’initiative privée, pour assurer en amont l’égalité des chances à chacun ; – de réhabiliter la valeur travail parallèlement à la relativisation de celle du capital, dans la perspective d’un partage équitable (héritage de la voie médiane tracée par Léon XIII dans Rerum Novarum, première encyclique sociale, par G. K. Chesterton prônant le distributionnime ; reviviscence de l’association capital-travail du gaulliste René Capitant ?) ; – de promouvoir une justice visant moins l’égalité que la proportion, i. e. assurant l’équité, indissociable d’un souci de personnalisation procédurale ; – de fonder le marché sur la coopération plutôt que sur la compétition (coopétition) ; – d’être plus en quête de compromis, mêmes imparfaits, que de la poursuite d’un inaccessible idéal (nostalgie d’une pureté originelle !). Pourquoi l’État et les entreprises seraient-ils incapables de prévoir les suppressions de postes de travail que l’évolution d’une économie fondée sur le principe de destruction créatrice rend inévitable et de pourvoir à de nouveaux emplois que le progrès technique requiert en permanence ? Si ce n’est par manque d’outils sophistiqués de prévision ou de planification, surabondants, ce serait bien faute de volonté de compromis. De ces compromis susceptibles d’éviter l’affrontement avec des syndicats pouvant aller jusqu’à la grève, au mépris de l’usager.
En somme et à titre de synthèse : – sur le plan économique, pas de réindustrialisation sans diversité et hybridation, sur le modèle des districts industriels italiens étudiés par Alfred Marshall à la fin du XIXe siècle ou, plus récemment (fin du XXe), sur celui des clusters californiens vantés par Michael Porter, lesquels ont, tous deux à des degrés divers, inspiré les pôles de compétitivité à la française (cf. le rapport de Christian Blanc, député, en 2004) ; – sur le plan social, pas de mixité sociale sans diversification urbaine impliquant, d’une part, moins d’État et plus de recours à la promotion privée dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), d’autre part, et en contrepartie, plus d’État en dehors, pour accompagner la réalisation de logements sociaux dans les quartiers dits bourgeois.
Par ailleurs, délaissant l’économique et le social pour la politique, on conviendra que si l’hémicycle tend à redevenir une arène où l’absence de majorité polarise les extrêmes au détriment du centre, le positionnement de celui-ci pourrait opportunément permettre la mise en œuvre d’une coalition en débordant sur la gauche comme sur la droite – marais sans doute, mais à géométrie variable et sensible aux opportunités à saisir, tout le contraire d’un marécage dépourvu d’orientations. Le Parlement, au lieu de donner le spectacle de vains affrontements, en serait quitte pour se rappeler qu’en politique la parole, indissociable de l’action, qu’elle sert, nourrit le débat, à l’inverse des invectives, qui le polluent. Spectacle néanmoins inhérent à la démocratie, qui ne saurait être négligé pourvu qu’il soit donné dans les formes requises, non pas tant par la décence que par la sérénité qui s’impose à tout débat démocratique (cf. infra, la référence de Deleuze à la répétition théâtrale). Il n’est plus guère de médias qui, à satiété, ne le ressassent. Hélas ! l’agonistique héritée des Grecs l’emporte désormais sur la sagesse qui en compensait les effets mortifères.
Comment continuer de feindre d’ignorer que le système majoritaire a généralement pour conséquence d’exclure près de la moitié des électeurs. Qu’une majorité tend à écraser les minorités et qu’inversement des minorités sans majorité s’annulent. Les minorités sont toujours perdantes et les majorités ont toujours tort. Sauf à considérer avec Deleuze que « la majorité c’est personne, la minorité c’est tout le monde56 », il faudrait savoir à quel parti d’idées se rallier ? Et à quelles conditions ? Autrement dit, quelle coalition et quels compromis adopter pour faire échec à sa condition minoritaire sans se renier : coalition concertée sur des bases partagées, qui ne s’improvise pas à moins d’exploser à la première anicroche, comme le démontre maints exemples étrangers ; compromis constructifs qui prennent en compte les arguments d’autrui au lieu de les rejeter d’emblée. Entre un dissensus sans issue et une introuvable majorité n’y aurait-il pas place pour un consensus raisonné – évitant l’écueil du consensus mou – où les « auteurs » que sont les chercheurs, techniciens et experts, ne seraient plus pris en étau dans le triangle fonctionnel constitué par les « acteurs » sociaux, économiques et politiques, tel que l’a esquissé Guy Burgel57 ? Oui assurément, sous réserve de considérer qu’il n’est de coalition concertée, de consensus raisonné et de compromis constructifs que dans un processus toujours en mouvement, en recomposition, à l’écoute des majorités silencieuses comme des minorités tonitruantes et à l’affut des opportunités, dans un contexte jamais figé, évolutif. La pratique de conventions citoyennes pourrait être généralisée à condition d’en articuler la procédure et les conclusions avec les débats parlementaires, dont les décisions dépendent en dernier ressort : garantie de fonctionnement alliant la démocratie à l’efficacité. L’alternance de majorités ou de gouvernements n’en serait pas pour autant obsolète : la prise de conscience de la précarité est derrière elle et l’espoir qui motive est par devant. Elle s’inscrirait seulement dans un régime de la complexité à repenser au-delà du « binarisme » sommaire dans lequel les partis extrémistes voudraient enfermer les délibérations du Parlement. Un binarisme qui, aujourd’hui, n’oppose plus tant dans l’absolu une gauche et une droite sur un linéaire rectiligne, qu’un populisme et de droite et de gauche, extrêmes autour d’un centre macroniste flottant ; lequel se voudrait, a contrario, ni de droite ni de gauche. Vie politique en décomposition, prémices d’une recomposition, compte tenu que ledit centre serait voué à l’écrasement ? En toute hypothèse, la recherche d’un juste milieu, point d’équilibre dont l’instabilité serait assumée, devrait l’emporter sur un centrisme opportuniste. « Un devenir est toujours au milieu, on ne peut le prendre qu’au milieu », écrivent Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux. Justice, justesse,juste mesure : question ouverte, à débattre, à négocier – parce que problématique – dans une scène parlementaire en forme d’hémicycle, propice aux échanges. Jeux de langage politique, catharsis de la violence par les vertus du dialogue. Juste mesure, sociale ou politique, d’autant plus problématique qu’elle est indépendante de l’équilibre économique, même s’il en est la condition. Dans le dialogue du VIIe Livre de La République, Socrate s’adressant à Glaucon, son disciple, évoque en ces termes l’homme politiquement mûr : « il imitera celui qui consent à dialoguer et à envisager le vrai, plutôt que d’imiter celui qui, dans la controverse, joue un jeu pour le plaisir de jouer […] ». Jeu stérile à somme nulle : principe mortifère du plaisir. Nos politiques, habitués de longue date à la confrontation qu’ils ont pu cultiver dans un régime présidentialiste taillé à leur mesure, feraient bien de s’en garder.
Cependant, il ne suffit pas d’argumenter comme nous y invite Habermas. Distinguer l’agir communicationnel – qui repose sur l’argumentation – de l’agir stratégique, qui cherche à influer sur l’opinion, c’est bien. Affirmer que « l’irrationalité de la domination qui a pris maintenant les proportions d’un danger mortel collectif ne pourrait être surmontée que par la formation d’une volonté politique, liée au principe d’une discussion générale et exempte de domination58 », c’est encore mieux. Mais, nous dit Yves Citton dans un ouvrage éclairant59 qui démystifie le savoir scientifique et technique sans toutefois y renoncer, cela ne suffit pas. Le débat délibératif tel que le conçoit Habermas s’appuie sur une raison hégémonique qui rejette d’emblée toute considération qui s’écarterait des exigences d’une argumentation rationnelle et qui reste fondé sur le principe logique de non-contradiction, alors même que la contradiction est, en politique, au cœur des débats. C’est reconnaître qu’on ne viendra pas à bout de ces contradictions qui assaillent nos forteresses intellectuelles en restant dans le cadre étroit d’une rationalité d’experts, derrière laquelle les politiques, confrontés à des problèmes de plus en plus techniques, ont de plus en plus tendance à se réfugier. Aussi, sans rejeter les principes sur lesquels repose le débat délibératif, dont le cadre reste incontournable, Yves Citton préconise de recourir, en parallèle ou en complément, à l’interprétation littéraire susceptible de prendre en compte les intérêts particuliers des citoyens, êtres de raison et de chair, situés dans leur environnement social et territorial, dont la sensibilité et l’affectivité échappent aux raisonnements et calculs des scientifiques et des experts. Pour l’auteur, alors que le débat délibératif de type habermasien reste largement investi par les théoriciens, le débat interprétatif doit être mené tout au long de la chaîne qui relie les théoriciens aux praticiens. Les préoccupations de tendance universaliste des premiers ne doivent pas étouffer les revendications de la base confrontée aux problèmes pratiques de l’existence, ceux que pose la vie de tous les jours : « Plus on parvient à se rapprocher des pratiques concrètes à travers lesquelles nous bricolons au quotidien la trame de nos existences communes, mieux on évite les confrontations dogmatiques qui ne résultent souvent que d’abstractions leurrantes (sic)60. » Par ailleurs, la mondialisation oblige à prendre en compte le pluralisme culturel qui s’exprime sur le terrain avant même que les clercs puissent s’en approprier la matière pour les besoins de leur recherche ou de leur enseignement : « … ce n’est que par les comparaisons, confrontations et échanges avec d’autres cultures qu’on peut espérer comprendre les spécificités de sa culture d’origine61. » Trois principes devraient, en conséquence, être à la base du débat démocratique : 1°- le principe d’égalité des compétences pour aborder le débat (cf. Hannah Arendt supra.), indépendamment de l’expertise préalable à la délibération, nécessaire à la prise de décision ; 2°- le principe de pertinence, qui s’apprécie par rapport à la mise en pratique, dont les modalités seront déterminantes pour la réussite des projets ; 3°- l’articulation avec la prise de décision qui appartient aux politiques, si on veut éviter de fragiliser la démocratie en promouvant une gouvernance « molle ». Ce qui, sous cette dernière réserve, revient à prendre comme modèle de délibération le rhizome – circulation horizontale du sens porté par les données et informations à la base des décisions – que Deleuze et Guattari opposent à l’arborescence, hiérarchique. Partant, la recherche d’un accord, sinon d’un consensus conciliant les antagonismes, est privilégié à la confrontation. De sorte que l’enjeu du débat interprétatif est bien de s’inscrire dans une conception de la démocratie alliant la prise en compte de la diversité des intérêts en amont de toute décision à l’efficacité au stade de la mise en pratique. Contrairement à ce qu’avance Chantal Mouffe62 – pour qui la démocratie nécessiterait un « consensus conflictuel », c’est-à-dire un consensus sur les valeurs de base des institutions démocratiques et un dissensus sur l’interprétation de ces valeurs – c’est parce que la démocratie est capable de prendre en compte les passions qui animent la politique qu’elle peut triompher des antagonismes : dépassement des rapports agonistiques entre adversaires visant l’élimination de ceux que l’on considère comme des ennemis63 au profit de rapports de type dialogique64 entre partenaires aspirant à une solution faisant consensus parmi des possibles subjectivement légitimes. Car, si « penser » est affaire de volonté à la portée de tout un chacun selon Hannah Arendt, penser collectivement est d’un autre ordre : volonté de penser universelle confrontée à la diversité des sensibilités de la pluralité, défi politique à relever. Ce qui fait la force de la démocratie, la transparence des débats, fait sa faiblesse : l’instabilité. Inversement, ce qui fait la faiblesse des régimes autoritaires, l’opacité des débats, fait leur force : la stabilité. Argumentation à somme nulle serait-on tenté de conclure négligemment, si ce n’était faire fi de la complexité en politique.
Difficulté institutionnelle à dénouer : le parlement représenterait-il une plus grande diversité d’opinions que ce ne serait pas pour autant qu’elle serait plus représentative que celle du pays réel et, qu’en toute hypothèse la nation – censée représenter le peuple – serait mieux gouvernable, au contraire. Paradoxe qui témoigne, néanmoins, de l’impossibilité d’une représentation parlementaire autrement que théâtrale, c’est-à-dire dans la répétition (cf. supra, le débat parlementaire comme spectacle). Répétition de l’histoire politique, dont les débats parlementaires sont le miroir, mais répétition qui, loin de se fonder sur une hypothétique identité, reconnaîtrait une primauté à la différence sur la base du constat fait par Deleuze : « Le jeu du problématique et de l’impératif a remplacé celui de l’hypothétique et du catégorique ; le jeu de la différence et de la répétition a remplacé celui du Même et de la représentation65. » Ce que les débats politiques actuels, qui prétendraient à la rigueur du raisonnement, n’auraient pas encore intégré. N’en déplaise à Luc Ferry et Alain Renaud, leur interprétation de la pensée 6866 est rétrograde, la pensée de Deleuze, jointe à celle Michel Serres, anticipe ; les désordres auxquels nous expose l’actualité en porte témoignage : ce n’est pas tant la différence qui nous menace – laquelle s’impose quoiqu’on en ait – que la revendication identitaire. À tout un chacun d’en tirer les conséquences, pour soi et en soi, c’est-à-dire en humaniste lucide.
Cependant, pour l’extrême gauche il n’y a pas de limite à la réalisation de ce qu’elle considère comme juste, à savoir l’égalité, même au prix de la liberté. La logique binaire du tout ou rien – qui conduit, subconsciemment, à opposer l’égalité à la liberté – l’emporte en sacrifiant la prudence sur l’autel du radicalisme. Portées à leurs extrêmes, la liberté tue l’égalité et inversement. C’était pourtant au fronton du temple de Delphes qu’était inscrite la sentence « Rien de trop », reprise dans la fable éponyme de La Fontaine. Fi ! donc, la morale antique du juste milieu vantée par Aristote est, de nos jours, battue en brèche en politique comme dans les syndicats. Et ce n’est pas en changeant de mode de scrutin qu’on modifierait le comportement d’élus dont la culture est, historiquement, à la confrontation ; la représentation nationale n’en sortirait pas plus représentative par rapport à la situation issue des élections législatives de juin-juillet 2024 vu que l’on a plus affaire à une crise d’identité que de représentativité, même si près de trois quart des députés sont issus de couches sociales supérieures qui représentent moins du quart de la population. Crise d’identité dans la mesure où il ne s’agit pas tant de savoir qui on représente mais plutôt de quelles valeurs on se réclame. C’est pourquoi on ferait fausse route en recherchant à tout prix la stabilité à travers une majorité, si tant est que ce serait d’abord dans la diversité d’opinions reflétant des intérêts de classe négociables qu’elle devrait être dégagée. Aussi bien, suivant la méthode exposée par Deleuze, les débats faisant objet de la « répétition » – dont la source est dans la « différence » – pourraient-ils déboucher sur des compromis raisonnables ; martingale qui gagnerait néanmoins à être adossée à des conventions citoyennes, qui, elles, devraient être aussi représentatives que possible, mais pondérée par la force symbolique des groupes d’intérêts en question, laquelle ne se chiffre pas ; ainsi en est-il de celle du monde agricole, héritier de la paysannerie d’antan, qui est sans commune mesure avec le nombre de ses représentants. En s’enferrant dans des oppositions binaires, la démocratie se mue en « jeu ». Jeu statique à somme nulle éloigné du « réel ». De ce « réel », complexe de divers et de variation, qui est toujours dans un « entre-deux », ouvert à ses extrémités, accueillant la différence comme mise en mouvement d’une diversité donnée. « Différence » comme « écart », qui nous ramène à une identité, mais une identité à construire, flexible, processus en interaction avec l’environnement, lui-même changeant. Différence ou écart qui nous renvoie aux autres, lesquels, dans un jeu de miroir infini, nous renvoient à leur tour à une réalité partagée. À condition de ne pas céder à la séduction trompeuse des extrêmes : « Il est bon de suivre sa pente, disait André Gide, pourvu que ce soit en montant67. » Oui, si escarpée que soit la pente et si variées qu’en soient les bifurcations.
Un progressisme entre continuité et rupture
De quoi s’agit-il, en bref ? de soutenir un progressisme ne reniant pas la tradition du travail, source de richesse ; défi à l’idéologie des détenteurs de capital, enclins au conservatisme. Un progressisme conscient du prix du temps avec lequel il faudra composer pour venir à bout de l’exploitation économique, étant précisé que ce ne serait pas pour autant qu’on en aurait fini avec les discriminations, avec la domination, buts suprêmes, mais qui ne doivent pas occulter les déterminismes économiques. Le divers, plus que la diversité, l’hybridité, parties prenantes du progressisme, ne sont pas seulement spatiales, mais s’inscrivent aussi dans le temps, sachant que ce ne sont pas tant les leçons de l’histoire, dépendantes d’un contexte mouvant, qu’il faille retenir que celles des évènements, dans leur singularité. Progressisme qui trouve son sens dans l’avenir à l’encontre d’un conservatisme prisonnier du temps présent, plus attaché à consolider les acquis ayant fait leur preuve qu’à déconstruire ; ni décroissance économique, suicidaire, ni accélération technique adossée à l’intelligence artificielle, antihumaniste ; pas plus d’éloge de la lenteur, dont Kundera s’est fait le chantre, que de la vitesse, dénoncée par Virilio. À chacun son rythme entraînant les autres au plus près du vent de l’histoire, dont le sens ne demande qu’à être saisi. Le réalisme politique, à l’opposé du « en même temps » du macronisme, qui pourrait bien concourir à sa perte, c’est aussi compter avec le temps68, mais un temps historique, dont nous sommes plus des acteurs responsables que des agents, supports passifs du mouvement. Sont seulement admissibles, dans cette perspective, les délais que le présent peut supporter, compte tenu de l’état des mœurs. Conception d’un temps qui par définition passe et qui permet d’échapper à l’enfermement auquel nous condamne la logique classique, suivant laquelle les « contraires » s’excluraient. Dans Entre géométrie et architecture Philippe Boudon note : « C’est la temporalité qui permet de rendre intelligible que le « dehors » puisse être « un autre dedans » », sachant que « le dehors ne peut pas être en même temps un dedans ». Si, donc, dans un autre mode logique, hybridité il y a, elle ne peut être que temporelle. Et l’auteur d’ajouter qu’en ce sens l’« hybridité permet la vicariance », c’est-à-dire, par extension du raisonnement à la vie sociale, la possibilité de se mettre à la place des autres ; empathie qui évite la condescendance, péché mignon des intellectuels de gauche en mal de charité (chrétienne) ; mais, empathie qui maintient cet « écart » que requière François Jullien pour ce qu’il garantit de lucidité (cf. supra : « … pour “entrer”, il faut sortir… » à propos de la ségrégation spatiale).
Deleuze, de son côté, aurait opposé à l’univers de la pluralité équivoque dans lequel nous plongent Trump et ses acolytes, univers de l’équivocité de sens, un monde de l’univocité compatible avec la diversité69. Sauf à perdre le sens que nous masquent les sens, la diversité ne saurait, en effet, résider dans l’équivocité. « Tout phénomène, écrit Deleuze dans Différence et répétition, renvoie à une inégalité qui le conditionne. Toute diversité, tout changement renvoient à une différence qui en est la raison suffisante. Tout ce qui passe et apparaît est corrélatif d’ordres de différence : différence de niveau, de température, de pression, de tension, de potentiel, différence d’intensité. » C’est ainsi, nous dit l’égérie des soixante-huitards, qu’il y a une intensité du temps dont la fluidité le dispute au statisme de l’extension mais sans s’y opposer. Temps valorisé comme producteur de différences sur lesquelles se fonde la répétition, ainsi qu’au théâtre, et qui sous-tend une activité créatrice en opposition à l’imitation stérile à laquelle s’étaient, en théorie, tenus les Anciens, sans pour autant s’y plier comme en témoignent les chefs-d’œuvre de l’art antique. Temps de l’individuation également. Alors que la diversité est donnée, précise l’auteur, la différence se donne dans son dynamisme même : tension comme différence de potentiel, dont l’intensité est le produit et la puissance la mesure, puissance indissociable du passage à l’acte. L’intensité du temps, si intime soit-elle, n’en rejoint pas moins la profondeur de l’espace, différence dans la distance : complexe de l’espace-temps dans lequel la divisibilité du premier terme, l’étendue, est liée à l’intensité qualitative du second. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la qualité des espaces, différenciée selon que l’on a affaire au nomade ou au sédentaire : espace lisse dans le premier cas, point entre deux lignes, strié dans le second, ligne joignant deux points. S’agissant de distribution, c’est la distribution nomade sur le modèle du rhizome, transversale, que Deleuze privilégiera par rapport à la distribution sédentaire, arborescente à partir de déterminations fixes. Distribution nomade dans la durée sur un sol sans fondation dans le premier cas ; distribution sédentaire dans l’espace d’une terre partagée pour le travail, dans l’instant même, dans le second cas. Sur un plan épistémologique, la représentation, objective, territorialisée, dont le contenu s’impose au sujet par la mise à distance, est distinguée, sans s’y opposer, de l’expression, qui est déterritorialisée, dont le contenu est intériorisé avant d’être extériorisé. Apparence de la représentation-spectacle selon Debord, vérité de l’expression intérieure selon Giorgio Colli, manifestation de la réalité de la vie sous les faux-semblants70. À l’encontre de l’opinion courante, qui l’essentialise, l’identité est fondée sur la mobilité et la différence : la déterritorialisation se refermant sur la territorialisation pour s’ouvrir à nouveau dans une boucle déliée comme une ritournelle. Tout est en un, dans un continuum infini mais immanent. Tension créatrice, alliance de l’intelligence avec les sens, confrontation ultime de l’abstraction avec la réalité sensible. Accomplissement dans l’« affirmation de l’affirmation ». Défi lancé au binarisme : univocité qui ne renie pas le divers du pluralisme. Deleuze inspiré par Bergson, rejoint par Serres : l’intelligence émergeant de la matière indifférenciée, le divers, produit de l’hybridation. Reprise de l’injonction d’Héraclite : « Vivre de mort, mourir de vie. » De sorte que, si éternel retour il y a, c’est d’éternel retour de la différence qu’il s’agit, pouvant être figuré par la spirale. Freud71 voyait dans la répétition un réflexe de résistance suscité par l’angoisse de mort, Deleuze la conçoit au contraire comme affirmation de vie.
Et comme il n’est jamais deux sans trois – trinité, symbole de complétude, sinon de plénitude, dynamisme de l’impair – Gilles Deleuze et Michel Serres auraient pu se joindre rétrospectivement à Walter Benjamin pour promouvoir un temps historique inspiré du messianisme juif. L’historicisme des Modernes prônant le temps linéaire et continu du progrès, temps vide du chronos, quantitatif, celui des horloges, est supplantée par le temps plein, qualitatif du Kairos. Temps de l’opportunité entre un avant et un après, temps de l’éclair, éblouissement du cristal reflétant le tout de l’univers. Le passé y est rempli de moments subversifs, potentiellement explosifs. « Par abandon du modèle théologique occidental, on passe d’un temps de la nécessité à un temps des possibilités, un temps aléatoire ouvert à tout moment à l’irruption imprévisible du nouveau72. » Rien n’est définitif, tout est décisif entre le meilleur et le pire, problématique spécifierait Deleuze ; c’est-à-dire ne relevant ni de la déduction logique ni de la dialectique, mais d’un devenir univoque de différences, d’une continuité hétérogène. Ce que Deleuze perçoit devant lui, dans la répétition, Benjamin le perçoit dans un miroir : remémoration, rédemption, résurrection. La conception benjaminienne du temps et de l’histoire, discontinue, n’en est que plus problématique, justifiant le point de vue de l’agnostique pour lequel, rapport à la phrase écrite, un point d’interrogation, métaphore de l’incertitude, se dresse au terme de l’histoire humaine comme à celui d’une vie : transcendance en-deçà, avec l’art et la poésie qui déroule esthétiquement le temps, transcendance au-delà avec l’éternité en ligne de mire ? Qu’importe, l’alternative demeure ouverte, sans exclusive : profession de foi critique contre le dogmatisme du croyant et celui de l’athée, logés à la même enseigne. Point d’interrogation, point surmonté d’une crosse, symbole pastoral, ouvert à tous les possibles : sur terre et au présent, de même qu’au ciel dans un au-delà du temps ; dans tous les cas expression de notre liberté par-delà la fermeture de l’espace – environnement de notre « puissance » – et les limites du temps qui nous est imparti. « Dans la personne, l’immanence comme la transcendance, la nécessité comme la liberté sont des faits d’expérience », écrit Lewis Mumford73. Exaltation de vivre avec cette énigme au bout de la route, étoile noire, attraction irrésistible, toujours remise. Fausse symétrie entre un commencement dont on peut au moins supputer les suites et une fin dont on ne saura jamais rien ! Le commandement d’aimer un Dieu jaloux74 lui paraissant insupportable, l’agnostique n’a de cesse de s’en libérer comme d’une obligation le détournant du plaisir de vivre, de repousser toujours plus hors du genre humain l’emprise de la haine ; sachant que la perspective d’un au-delà de la vie temporelle, compte tenu des rémanences qu’elle charriera, risque d’être lourde à porter pour l’éternité. Aussi bien, la question de la transcendance, plutôt qu’un « pari », pourrait n’être qu’une question de priorité entre, d’une part, la jouissance immédiate des biens de ce monde dans toute leur variété avec Gilles Deleuze et Michel Serres – laquelle vouerait le croyant ascétique à l’enfer – et, d’autre part, la compassion envers les opprimés, l’empathie envers les laissés-pour-compte de la prospérité ; en bref la pratique de la charité – laquelle promet le ciel au croyant ou anticipe la révolution : rupture dans la violence, symbolique ou réelle, qui embraye sur un avenir enjoué avec Benjamin. Comme s’il y avait incompatibilité ! Retour différentiel du « même » dans le Paradis ou dans un futur mythique. L’aspiration à joindre l’intellect à l’éveil des sens chez Deleuze et Serres n’a d’égal que le souci d’accorder la réalité au mythe chez Benjamin. Tous trois partagent une même éthique sociale : en faveur des minorités abandonnées à leur sort par les politiques chez Deleuze, en faveur des vaincus de l’histoire, les opprimés, chez Benjamin ; l’optimisme que le premier partage avec Michel Serres n’ayant d’égal que le pessimisme du second. Même exigence de rupture : avec l’intellectualisme borné des élites et la culture de la nostalgie chez Serres, par la révolution chez Deleuze et Benjamin.
C’est ce dont l’écriture du Livre des passages – que la fin dramatique, volontaire, de l’auteur, conscient de l’impasse dans laquelle il s’était retrouvé à Portbou, a interrompu – témoigne. Témoignage d’une ironie implacable étant donné que le message de Benjamin, malgré son pessimisme, était un message d’espoir. Pour l’auteur, la ville est le symptôme de la modernité, et plus particulièrement ce Paris du XIXe siècle dont les passages couverts constituent un « entre-deux », sas d’entrée et de sortie ouvert sur la ville sans être fermé sur les intérieurs qui le bordent. Seuil aménagé, avec sa verrière en guise de couverture, pour mettre en communication l’espace public et l’espace privé, sans les séparer ni les confondre. Lieu, aussi, de toutes les contradictions de la ville : espace anonyme de rencontres potentielles, où le flâneur croise le boutiquier affairé. Environnement de fantasmagories autant que d’affairisme, où l’imaginaire côtoie l’économie, où le passé et l’avenir se télescopent pour un dénouement incertain, ambivalent.
Ainsi s’exprime Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle (1939), exposé de présentation du projet de Livre des passages :
« Notre enquête se propose de montrer comment par suite de cette représentation chosiste de la civilisation, les formes de vie nouvelle et les nouvelles créations à base économique et technique que nous devons au siècle dernier entrent dans l’univers d’une fantasmagorie […] Quant à la fantasmagorie de la civilisation elle-même, elle a trouvé son champion dans Haussmann lui-même, et son expression manifeste dans ses transformations de Paris. »
*****
Synthèse de l’espace-temps dans l’histoire globale75et la géopolitique, logos d’où surgit le sens comme événement, art quand le pli se fait accroche de l’événement : autant de perspectives qui élargissent l’horizon de nos limites. Confirmation, dans la compagnie de Nietzsche, que « la volonté de puissance est le monde scintillant des métamorphoses, des intensités communicantes, des différences de différences, des souffles, insinuations et expirations : monde d’intensives intentionnalités, mondes de simulacres ou de mystères76. » Vision pour le moins cosmopolitique, reflet de la vastitude, de la dynamique et de la complexion du cosmos. Le sédentaire n’est plus condamné à l’immobilité et le nomade au déplacement. Tous deux se doivent, de nos jours, d’articuler les possibilités que leur offre l’étendue de l’espace et les contraintes de l’écoulement du temps. La condition pour ce faire est de se dégager dans les affaires humaines du « binarisme » auquel nous condamnent les techniques relevant du numérique – dont les communications électroniques – et de regagner la maîtrise du temps que la fascination pour la vitesse nous a fait perdre ; ivres de vitesse nous sommes, comme de sensations fortes après avoir été hypnotisés par la Raison. Si l’espace est l’expression de notre puissance77, le temps est celui de notre intimité. L’espace nous sépare et nous réunit, le temps nous renferme sur nous-même dans un présent qui fuit et dans un passé qui nous éloigne d’autant plus de nos congénères que nous le reconstruisons, seuls avec nous-mêmes dans la nostalgie, ou le rejetons, aussi seuls, dans le ressentiment. Quant à la rencontre avec l’autre, si elle a toujours lieu dans le présent, c’est au futur qu’elle se concrétise, dans les projets que nous bâtissons en commun.
Le temps, c’est tout ce qui distingue l’éclectisme du syncrétisme. L’éclectisme disperse dans le temps ce que le syncrétisme condense dans le présent. Alors que l’éclectisme valorise les différences, sans pour autant les hiérarchiser, le syncrétisme les dissout, faisant obstacle à l’alternance pourtant revendiquée par Montherlant78. « Si la synthèse est décidément trop difficile, épuisons la vie par l’alternance » comme le préconise ce dernier, qui se reconnait dans le « besoin d’aimer et de vivre toute la diversité du monde et tous ses prétendus contraires [ …] ». Réhabilitation de Victor Cousin dont la « plate » philosophie était méprisée ? Éclectisme, syncrétisme, alternance… Alors que l’auteur des Jeunes Filles semble pencher pour le syncrétisme, véritable féerie, Cousin79 se reconnaitrait plutôt dans l’éclectisme, si l’habit dont on l’affublait ne lui paraissait pas trop étroit : « … l’éclectisme nous est bien cher, sans doute, car il est à nos yeux la lumière de l’histoire de la philosophie, mais le foyer de cette lumière est ailleurs. » Où le rechercher : « Notre vraie doctrine, notre vrai drapeau, écrit-il, est le spiritualisme », et de citer Socrate, Platon, l’Évangile pour commencer, sans oublier Descartes pour la France. Éclectisme sélectif qui se garde bien de comprendre le matérialisme et l’athéisme, voués aux gémonies. Tout le contraire d’un véritable éclectisme, d’un éclectisme vrai qui ne hiérarchise pas, celui cultivé par le collectionneur, passion des enfants selon Walter Benjamin, pour qui les choses collectionnées, décontextualisées, ont une valeur en soi, dépourvues de leur qualité d’usage. Le collectionneur est un flâneur qui collectionne les points de vue au cours de ses promenades dans les villes comme dans les livres, urbaphilie, bibliophilie ; rêve confinant à la manie – mais sans y succomber – mais sans y succomber – de rassembler toute la diversité du monde en « Un », concentré d’espace et de temps : divers sensible à la variation, à portée de marche et de mains. De retour chez lui, le flâneur couche sur le papier le fruit de sa cueillette, en forme de récit ou de citations. Possession sans appropriation. Appréhension par l’esprit, saisie par les sens. Phantasme de l’ubiquité et du « en même temps », dans le recueillement de la conscience ouverte au monde. Diversité dans la prolifération, dans l’excès qui déborde des limites de la raison, bien qu’elle doive rester dans la mesure, la juste mesure que nous propose le réel. Comme si la simplicité du rationnel ne suffisant pas à notre être sensible, la complexité devait s’imposer à lui, mais dans les bornes de la réalité.
Rêve, manie, peut-être, mais qui nous soutiennent. Il n’en faut pas moins se préserver de la tentation de ce que l’on appelle, en un vague raccourci, le mouvementisme, qui veut tout, tout de suite, mais sans garantie de pérennité, à l’instar d’une certaine gauche radicale, laquelle continue de puiser dans la tradition du syndicalisme révolutionnaire sa stratégie ; celle à laquelle recourait Georges Sorel en s’adossant au mythe de la grève générale pour que le « Grand Soir » advienne. Mais à quel prix ? Celui d’une violence, hubris, en contradiction avec les avantages décisifs du dialogue et une éthique qui ne saurait être limitée à la conscience privée.
Éthique et politique : la fin et les moyens
La complexité, c’est aussi le rejet d’une séparation radicale de la morale et de la politique qui débouche sur le même mot d’ordre que leur confusion, au nom duquel la fin justifierait les moyens. Dans une conférence de 1983 sur Éthique et politique80, Paul Ricœur avait bien distingué les sphères d’action de l’éthique, de l’économique et de la politique, tout en faisant observer qu’elles se chevauchaient ; sachant qu’on pourrait être tenté d’ajouter aujourd’hui une quatrième sphère : l’écologique. « Or l’éthique du politique, disait-il, ne consiste pas en autre chose que dans la création d’espaces de liberté », avant de préciser en italique que « l’État de droit est en ce sens l’effectuation de l’intention éthique dans la sphère du politique ». Il concluait en définissant, d’une part, l’État démocratique comme celui « qui ne se propose pas d’éliminer les conflits, mais d’inventer les procédures leur permettant de s’exprimer et de rester négociables », d’autre part, la démocratie comme étant « le régime dans lequel la participation à la décision est assurée à un nombre toujours plus grand de citoyens. C’est donc un régime dans lequel diminue l’écart entre le sujet et le souverain. »
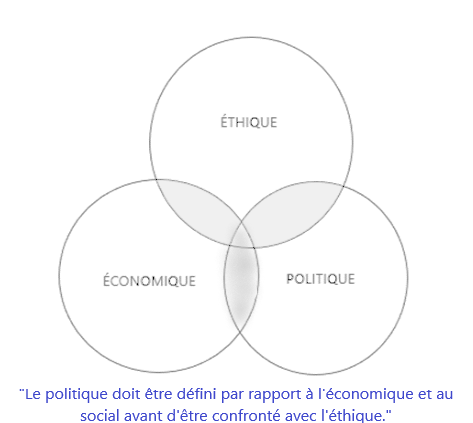
Dans Pourquoi les humanités sauveront la démocratie (2023), Enzo Di Nuoscio, philosophe italien, apporte la démonstration que si la démocratie implique la pluralité, c’est aux “humanités” qu’elle doit avoir recours pour s’imposer. “Humanités” prises au sens large du terme, englobant les sciences dites humaines aux côtés des lettres classiques et modernes. Forme d’hybridité assurant que la diversité est avant tout une somme de différences et non une pure sommation. Dynamisme, opposé au statisme de la simple addition des opinions, d’où émerge l’esprit critique garantissant qu’un relativisme opportuniste ne vienne pas noyer la vérité sous-jacente à toute prise de parole qui se respecte. C’est que, de nos jours, suivant Friedrich Hayek81, « la ressource qu’est la connaissance représente le principal facteur de création et d’amélioration de la valeur, la force productive la plus importante. » Culture humaniste garantissant la maîtrise de l’économique à travers l’interprétation correcte de ces signes que sont les prix et que nous délivre le marché. Interprétation correcte pour autant qu’elle s’étaye sur les leçons du passé afin de se projeter, mieux assuré, dans l’avenir. C’est que, anonymes par nature, les prix exigent d’être portés à hauteur de l’humain pour orienter la démocratie vers les fins qu’elle se donne, collectives, sans sacrifier l’individu. Loin de se laisser porter par l’économie, la démocratie doit d’autant plus se la subordonner qu’elle s’exerce dans un contexte d’incertitudes (voire d’ignorance, côté entrepreneurs, chez Hayek) où la probabilité maintient une marge de liberté propice, soit à la recherche d’un équilibre entre des intérêts contradictoires, selon Israël Kirzner82, soit à la traque d’opportunités de déséquilibre susceptibles enclencher un processus de destruction créatrice, selon Schumpeter83.
Et Enzo Di Nuoscio de conclure sur les ressources des humanités :
« En définitive, les humanités et les sciences sociales sont essentielles si l’on veut résoudre l’un des problèmes les plus difficiles auxquels la société ouverte est confrontée au troisième millénaire : renouveler son alliance avec la technologie, tout en empêchant cette dernière, sous la pression d’une concurrence mondiale impitoyable, d’exercer par rapport à la démocratie des poussées centrifuges. »
*****
C’est un paradoxe de constater que si au début du XXe siècle l’Église catholique dénonçait la séparation de l’Église et de l’État au nom d’une certaine idée qu’elle se faisait de la morale, aujourd’hui la tendance serait plutôt, chez ses fidèles, de se réfugier derrière une conception de l’État affranchie des principes éthiques par réalisme – réalisme de classe. Pourtant en 1963, Pacem in terris, l’encyclique de Jean XXIII, le proclame haut et fort, en droit interne d’abord : « L’ordre propre aux communautés humaines est d’essence morale », en droit international ensuite : « La même loi morale qui régit la vie des hommes doit régler aussi les rapports entre les États ». Dans une conception « ouverte », la laïcité, garantie de la neutralité de l’État en matière de religion, n’instituerait pas une cloison étanche entre les domaines de la morale et de la politique. Mieux, la perméabilité entre les deux serait un gage d’insertion dans la société, d’intégration de l’individu dans la communauté, opinion que récusent une droite et une gauche « dures », la première, catholique notamment, visant plus particulièrement l’islamisme, voire l’islam que la seconde cherche à ménager. Instrumentalisation de la laïcité dans les deux cas, à l’opposé de la porosité de la morale et de la politique qui – propension à confondre les deux ordres – n’évite pas toujours la moralisation, moraline de Nietzsche, laquelle humilie autant qu’elle exclut. L’homme politique peut-il, malgré tout, être honnête avec les autres ? On peut en douter, tellement sont fortes les contraintes qui pèsent sur lui. Ne lui resterait plus, alors, qu’à être fidèle à ses convictions et, surtout, cohérent avec lui-même dans leur expression.
Mais, ces distorsions ne relèveraient-elles pas également d’une question de maturité ? Si, avec l’âge, on temporise, c’est que le temps gagne en valeur ce qu’il perd en longévité ; raison pour laquelle la prudence prend le pas sur l’urgence à réformer ou à en découdre par la révolution. Et partant, les dérives de droite, qui seraient le propre des séniors, tendraient à l’emporter sur celles de gauche, auxquelles les teen-agers seraient plus sensibles. Il ne faudrait cependant pas que la morale de l’obligation en vienne avec l’âge à prendre le pas sur l’éthique, une constante de tous les temps. Précisons, en nous appuyant sur l’argumentation développée par Ricœur : la morale, surtout quand elle est assortie d’obligations, tranche dans l’absolu, entre le bien et le mal, suivant une logique binaire, au contraire de l’éthique, qui s’inscrit dans une « visée de la vie bonne » prenant en compte les circonstances dans lesquelles l’action est commise. Loin de la théorie, mais près du cœur pourrait-on résumer, conscients que dans le monde où nous vivons le bien et le mal sont imbriqués. La question demeure néanmoins de savoir si le vieillissement des sociétés est à l’avenant de celui des individus ? Les dernières manifestations de rues témoignent, après décompte des personnes arrêtées ou recensées, que les black blocs seraient en moyenne plus jeunes que les Gilets jaunes, appartiendraient plutôt à une classe supérieure, mais qu’ils seraient tous intégrés, les uns autant que les autres, ce qui pourrait les différencier des djihadistes, dont le degré d’insertion sociale ne préjuge pas du degré d’intégration culturel. Pourtant la justice vaut quel que soit l’âge et le niveau de richesse, et si l’éthique interfère avec l’économique et le politique, elle transgresse les clivages sociaux. Battu en brèche par le multiculturalisme, l’universalisme, dans sa version respectueuse des identités, résiste malgré tout aux assauts du wokisme. Les différences culturelles de surface n’affecteraient pas ce qui les fonde : une source mythique obscure, dont les religions, monothéistes ou polythéistes, révélées ou non, ne sont que les dérives violentes, parfois sanguinaires, mais d’où peut jaillir la lumière comme la clarté de l’aube succède à la nuit.
« Bâtir Habiter Penser »
« Être » est un bien trop grand mot pour être employé par un non-philosophe. N’est-ce pas Aristote qui le premier, du moins explicitement, en a, laborieusement d’ailleurs, dressé une analyse, justifiée par sa complexité. Et pourtant quoi de plus évident et immédiat que d’ « être » ? Si ce n’est que la question renvoie à celle de la pluralité et donc de la Diversité, dans l’Unité. Question cruciale qui n’a pas échappé à Ségalen et qui a hanté Gaugin, au point de la figurer vers la fin de sa vie dans une toile magistrale représentative de ce questionnement sans réponses, qui recoupe celui formulé par Leibniz84 : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Question évacuée par Wittgenstein, pour qui il y a bien autre chose que le monde : son sens, élément d’ordre mystique. Dans son Tractacus logico-philosophicus, il écrit : « Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive […] » (§ 6.41). Alors que le monde s’expose dans sa diversité foisonnante, le sens se dit. Et si « sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence » (§ final : 7), il ne reste plus qu’à montrer le monde avec ces moyens que nous avons en propre, esthétiques, si frustres soient-ils :

« D’où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous «
Autant d’interrogations, sans point final (titre de la toile dans le coin supérieur gauche, sur fond jaune, la signature étant à droite, en vis-à-vis, sur fond de même couleur). Ouverture à la plus grande diversité dans les plus vives des couleurs de la palette du peintre, reflet d’un « exotisme » intériorisé, expression du « divers » du monde, « synthétisme » qui ne se laisse pas plus borner par les limites de la matière que par celles que la vie nous assigne. Revanche de la couleur sur ces mêmes limites, dont la vivacité fait qu’elles semblent déborder de tout cadre, en extension comme en profondeur. Transcendance dans l’immanence, au-delà de toute mesure, figuration sublimée par le contraste des tons chauds, dans les jaunes-orangés, des corps nus sur le fond bleu de la mer et vert de la nature, plutôt froid. Asymétrie du commencement (nouveau-né sur la droite) et de la fin (ombre incarnée de la mort sur la gauche), inversés par rapport à l’ordre syntaxique. Comme si tout commençait avec l’évocation de la mort. Il faut dire que cette toile a été conçue comme un testament, précédant une tentative de suicide, alors que son auteur traversait une période dépressive. Au second plan, vers la gauche, une idole, bras levés, représente l’au-delà. Gageons que le personnage du centre ne cueille pas le fruit défendu mais celui qui condense, dans la fleur de l’âge, les promesses de la vie. Allégorie inspirée par l’exubérance des îles du Pacific-Est, loin de la ville natale du peintre (Paris) et de ses terres d’élection de Bretagne (Pont-Aven et Le Pouldu) qui l’ont confirmé dans sa vocation. La description qu’il en a faite dans une lettre de février 1898 à Georges-Daniel de Monfreid (père d’Henry de Monfreid) est éloquente, malgré sa sécheresse, et mérite d’être citée :
« À droite et en bas, un bébé endormi, puis trois femmes accroupies. Deux figures habillées de pourpre se confient leurs réflexions ; une figure énorme volontairement et malgré la perspective, accroupie, lève les bras en l’air et regarde, étonnée, ces deux personnages qui osent penser à leur destinée. Une figure du milieu cueille un fruit. Deux chats près d’un enfant. Une chèvre blanche. L’idole, les deux bras levés mystérieusement et avec rythme semble indiquer l’au-delà. Figure accroupie semble écouter l’idole ; puis enfin une vieille près de la mort semble accepter, se résigner à ce qu’elle pense et termine la légende ; à ses pieds, un étrange oiseau blanc, tenant en sa patte un lézard, représentant l’inutilité des vaines paroles. Tout se passe au bord d’un ruisseau sous bois. »
Gauguin ne pouvait mieux exprimer ce qui l’habitait dans ces îles excentrées, et, par l’emploi du verbe « ressemble » à plusieurs reprises, ce qui dans l’œuvre peinte lui échappe et le dépasse. Transcendance de l’expression artistique que Heidegger dans un texte séminal85 – conférence prononcée à Darmstadt en 1951 devant des architectes et ingénieurs confrontés à la crise du logement d’après-guerre en Allemagne – a condensé sous forme de trois mots, disjoints mais sans virgules, qui peuvent être mis en correspondance avec les trois expressions du titre que Gauguin a donné à sa peinture et avec les éléments figurés sur sa toile, soit : « Bâtir Habiter Penser » ; trois mots qui embrassent dans la même expression tout le « divers » de l’ « Être » dans les différents « temps » de sa plénitude et les « lieux » de son espace ; trois temps pour deux lieux respectivement habités par les dieux et les hommes :
« Les Quatre : la terre et le ciel, les divins et les mortels, forment un tout à partir d’une Unité originelle.
La terre est celle qui porte et qui sert, elle fleurit et fructifie, étendue comme roche et comme eau, s’ouvrant comme plante et comme animal. Lorsque nous disons « la terre », nous pensons déjà les trois autres avec elle, pourtant nous ne considérons pas la simplicité des Quatre. »
C’est que, en philosophe, Heidegger conteste, devant ses auditeurs, architectes et ingénieurs, qu’il y ait une crise du logement pour les Allemands au sortir de la guerre. C’est bien plutôt, qu’affecté par l’« oubli de l’être » au profit des « étants » depuis Platon et Aristote, l’homme a, depuis, négligé l’aménagement de ces lieux de l’espace qui constituent, par le « bâtir », son « habiter » :
« Le rapport de l’homme à des lieux et, par des lieux, à des espaces réside dans l’habitation. La relation de l’homme et de l’espace n’est rien d’autre que l’habitation pensée dans son être. »
Temps de l’être confronté à la mort : le passé du « bâtir », l’ « habiter » au présent, la « pensée » pour l’avenir.
Il y va de notre être au monde, sans préjuger d’un au-delà qui ne devrait pas faire obstacle à la jouissance de ce qui est ; luxuriance de l’Être dans sa plénitude, qu’une raison régulatrice ne saurait altérer. Diversité dans l’espace, alternance dans le temps, jeu des contradictions surmontées. « Joie » s’écriait Michel Serres, d’un seul jet, sur les traces de Spinoza. Luxuriance du paysage qui enveloppe nos habitats, exultation des sens réunis. Le « lieu » ne précède pas le bâti, pour la raison que c’est le bâti qui constitue le lieu, terre ou ciel, que l’être habite, homme ou dieu. En foi de quoi, Heidegger récuse la notion d’aménagement, applicable aux « lieux », pour lui substituer, s’agissant du « bâtir » et de l’ « habiter » celle de ménagement. Autrement dit, si crise il y a, elle est plus fondamentale et bien antérieure à celle du logement que connaîtraient les Allemands au sortir de la guerre. Elle concerne l’homme qui, en tant qu’oublieux de son être, submergé par la spéculation métaphysique et la technique des temps modernes, a négligé de prendre « soin », comme son « être » le lui aurait prescrit, de son habitat que le Style international a réduit à une simple fonction. La pensée de l’être de l’homme solidaire de son habitat amènera l’auteur de Être et temps à paraphraser Hölderlin en énonçant que « L’homme habite en poète ». Esthétique au service du recouvrement de l’ »être » ; accès au sublime par l’art quand l’habitat, à l’instar de la Cité, embrasse les choses, les vivants et les hommes dans une même communauté de destin ; Bibliothèque de Babel, Livre de sable.
D’une guerre à l’autre
La ville, dans son infinie variété, est la métaphore de la société, dont le confinement prescrit pour lutter contre la contagion de l’épidémie de Covid a révélé toute l’ambivalence : Eutopia, ville idéal, ou Babylone, ville déchue ? Ni l’une ni l’autre bien sûr, mais une ville vibrion où se croisent sédentaires et nomades. Ville prolifique de la concentration et de la dispersion, à la fois, où « … grâce aux télétechnologies de l’information, le sédentaire demeure partout chez lui et le nomade nulle part […] » écrit Paul Virilio dans la catalogue de l’exposition Terre natale, Ailleurs commence ici86. Existe-t-il des villes-modèles, des patterns de ville comme Christopher Alexander en parle en matière d’architecture ? Historiquement peut-être, en pensant à Trieste, l’irrédentiste, ancienne ville libre et port franc, dont la fontaine des Quatre Continents, Piazza Unità d’Italia, symbolise la vocation métropolistique, de carrefour entre Europe centrale, Balkans et monde méditerranéen. À l’origine, la diversité des langues – italien, allemand, slovène, croate, sans compter les dialectes comme ceux dérivés de la langue frioulane – n’avait d’égal que la variété des styles architecturaux, du baroque à l’art nouveau en passant par le style néoclassique et empire. À ce pluralisme linguistique et urbain s’oppose le dualisme démographique de l’ancienne Dantzig (Gdansk), Cité-État, dont la population majoritairement allemande avant la deuxième guerre mondiale a été supplantée par une majorité polonaise, et celui de Königsberg (Kaliningrad), ancienne capitale de la Prusse, aujourd’hui peuplée essentiellement de russophones. En France, on pourrait citer Marseille, la cité phocéenne, qui détonne par son exubérance comparée aux quatre grandes métropoles avec lesquelles elle peut se mesurer par la taille : Paris, Lyon, Bordeaux et Lille ; mais ville de l’ambiguïté, qui, pour Benjamin, nous salue d’une tête de mort, celle d’un phoque gravé sur une obole grecque, symbolisant le port avec en arrière-plan « La pression de mille atmosphères sous laquelle se comprime, se dresse, s’empile ici ce monde d’images87. » Foisonnement dans l’ambivalence !

La ville, revers de la campagne, c’est aussi une distanciation d’avec la nature et la terre, la construction d’un monde artificialisé pour les besoins d’une économie reposant sur la densité humaine, impliquant concentration de l’habitat, des équipements, des infrastructures de communication, et la proximité des lieux de travail. Grand écart de l’urbain par rapport au rural, source de conflits qui tiennent aux limites de l’espace et qui fait que villes et campagnes se chevauchent au détriment de ces dernières, sans que les premières y gagnent nécessairement. Séduction des villes, nostalgie des campagnes. Irrépressible attirance pour le futur, dont la ville est la promesse, insensibilité au monde rural, marqué comme rétrograde en dépit de la mécanisation et automatisation du travail agricole. Ambivalence toujours, non exempte de préjugés indéracinables qui font des urbains de dédaigneux nomades et des ruraux d’incurables attardés.
Pour Benjamin : « habiter signifie laisser des traces88. » Dans ses Portraits de villes, il distinguait celles auxquelles on se rendait en remontant le temps – les villes natales, comme Berlin pour l’auteur, ville prometteuse qui a succombé à la flétrissure du nazisme – de celles auxquelles, étrangers, on accédait en se déplaçant – les autres, comme Paris, dont les passages couverts de leur verrière symbolisaient au XIXe siècle la transition industrielle : « ambiguïté complète des passages : rue et maison à la fois89 ».
La vitesse a rétréci la surface du monde, mais a étendu le réseau des relations humaines. La ville contemporaine, tourbillonnante, est un lieu de contradictions où l’identité des habitants est menacée par le phénomène migratoire. Déterritorialisation forcée des urbains entraînés malgré eux dans le flux des communications électroniques, avant leur reterritorialisation dans la cité du futur ? En attendant, pollution et nuisances continuent de gâter la vie, en dépit d’une prise de conscience tardive, et la guerre menace à nos portes sans que les leçons du confinement aient été tirées : sensibilité neutralisée, conséquence d’un excès de sollicitation des sens recouvrés, favorisée par la déferlante du trumpisme ambiant. Les sens contre le sens. Mais, nous dit Benjamin : « chaque époque ne rêve pas seulement la suivante : en rêvant, elle tend aussi vers le réveil90 ».
Ce qu’aucun peuple, dit civilisé, n’est encore parvenu à faire pour sortir du maelström politique et de la léthargie sociale ambiante, à savoir une prise de conscience suivie d’un ultime sursaut, un virus – à rebours de ce que le Covid-19 avait provoqué – le pourrait-il ? C’est-à-dire un renversement de tendances entérinant une rupture entre un avant et un après au profit d’un monde meilleur pour le bien de tous. Virus providentiel en somme ! Mais, s’en remettre ainsi à ce qui constituait la Providence, en marche arrière, ne reviendrait-il pas à s’abuser, à reconnaître son impuissance et à abdiquer ? Alors quelle autorité – et par quel processus – pourrait prévenir le « retour du même » à défaut d’intervention providentielle91 ? Comme si, une fois l’épidémie maîtrisée, les habitudes passées devaient reprendre le dessus et que la lutte contre le Covid, qualifiée de « guerre » par le président de la République dans son allocution de mars 2020, n’avait fait, le temps de confinements à répétition, que : – masquer les effets dévastateurs du libéralisme économique et du délitement démocratique, pire, les avait accentués ; – différer la solution de problèmes politiques intérieurs, extinction de la dette entre autres ; – retarder l’explosion de conflits extérieurs, invasion russe de l’Ukraine, attaque terroriste du Hamas au Proche-Orient, qui de toutes façons seraient advenues. Ces derniers conflits pas moins ravageurs que l’épidémie, peut-être même plus, pour l’avenir géopolitique de l’Europe et du monde, sachant que la dissuasion nucléaire – l’enchaînement des guerres actuelles en Europe-même et au Moyen-Orient le démontre suffisamment – ne nous garantit plus d’une « montée aux extrêmes » théorisée par Clausewitz dans De la guerre92. Le dérèglement climatique attribué aux excès de la productivité industrielle et agricole, avec ses conséquences sur l’extinction des espèces, n’aura donc pas suffi à nous réveiller de la torpeur dans laquelle nous avait précipité la modernité. Et, à peine avions-nous pris conscience des limites des ressources de la terre et des périls auxquels nous exposait leur exploitation démesurée, que nous nous aveuglions sur les prouesses de l’intelligence artificielle, dont le plus grand phantasme ne serait pas tant de croire qu’elle serait susceptible de renforcer nos capacités intellectuelles que d’imaginer qu’elle pourrait s’associer des affects non moins artificiels : intelligence, sens et sentiments liés dans la machine à même de remplacer le travail servile de l’homme. Tout phantasme mis à part, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, l’impact de l’intelligence artificielle, générative, sur les progrès de l’humanité, sur l’évolution économique et social, sur la course aux armements et l’efficacité de la dissuasion, dont dépend l’avenir géopolitique de la planète, en un mot sur l’Histoire, nous échappe encore, et risque de nous échapper à jamais faute de réaction à la mesure des enjeux.
« Montée aux extrêmes », généralisable à la compétition économique, à la lutte sociale pour les places (après celle des classes, Michel Lussault dixit93), à la rivalité pour la domination des forces de la nature, à la concurrence dans le domaine des communications, à la maîtrise du cyberespace… Ainsi, l’état de guerre constituerait la norme de nos sociétés, révélateur de leur vulnérabilité. Et ce n’est pas parce que nous n’y sommes pas directement impliqués, pour l’heure, que nous échapperons à la menace d’une conflagration, qu’elle soit humaine ou naturelle. Menace se défiant autant des frontières que du temps, et que la technique, dans une course effrénée aux innovations (drones, robots tueurs, cyberguerre…), ne fait qu’accroître. Avons-nous jamais été en paix ? En état de « non-guerre » – selon le mot de Bertrand Badie – oui, mais en paix non. « Homo homini lupus est » prétend l’adage latin, dont Plaute94 serait à l’origine, repris par Hobbes95 au XVIIe siècle, siècle des révolutions anglaises ; malédiction du genre Homo, si l’on en croit Ivan Karamazov, le plus rationaliste des trois frères, athée de surcroit : « On compare parfois la cruauté de l’homme à celle des fauves, c’est faire injure à ces derniers. Les fauves n’atteignent jamais aux raffinements de l’homme. » Ferait-il exception dans le règne animal ? La question de la violence intraspécifique fait débat chez les zoologues. Si, faute de certitude, nous nous en tenons à l’opinion d’Ivan, ce dont nous n’aurons pas de mal vu les horreurs de la guerre, le propre de l’homme ne serait pas tant de disposer de raison et d’éprouver des sentiments compensant une moindre sensibilité organique que de trahir son animalité, en se montrant inhumain. Il semble qu’il soit d’autant plus violent, cruel même, qu’il raisonne, sa raison lui donnant des arguments pour céder à son agressivité. Si on admet que pour l’animal il s’agit d’une question de survie relevant de l’instinct, il n’en est rien pour les humains qui mettent d’autant plus d’acharnement à s’entretuer qu’ils ont de bonnes raisons, dont les bêtes sont censées être dépourvues96. Ce qui pose la question de la violence fondatrice, à l’origine du Droit, telle que la concevait Benjamin97, violence qui serait aussi liée à la rupture entre la nature et la culture concomitante à la sédentarisation ; thèse défendue par Jacques Deschamps98 pour qui l’homme s’est désolidarisée au Néolithique du monde animal avec lequel il partageait une empathie naturelle ; il aurait alors gagné en haine de l’autre ce qu’il avait perdu en empathie ; substitution de la domination, masculine notamment, à l’hybridité originaire homme-animal : « … la civilisation, au sens occidental du terme, est le produit historique d’une lutte incessante contre la violence endémique des hommes produite comme réaction à la rupture entre l’espèce humaine et les autres espèces animales qui lui étaient le plus proches. » Violence d’autant plus dangereuse qu’elle serait plus rationnelle, nous dit Michel Foucault99, qu’elle domine la sensibilité et que, de nos jours, elle ne discrimine même plus entre les adversaires : « La machine de guerre ne nécessite plus la désignation d’un ennemi qualifié, mais tend à s’exercer contre l’ennemi quelconque de l’intérieur comme de l’extérieur, individu ou groupe, classe, peuple, voire le monde tout entier », analyse Deschamps après avoir fait le constat de l’extension de conflits asymétriques de par le monde. Guerre potentiellement totale, désabusant les plus naïfs des aménageurs de territoires, qui ont pu croire que le temps des guerres arriverait à son terme et que l’« aménagement », poursuivant un quête d’insertion sociale sur une terre commune et dans la paix retrouvée, prendrait le relais.
En tant qu’héritiers des Grecs, « tout se fait de l’intérieur du jeu des forces qui font le monde », rappelle François Jullien100. À la différence de la pensée chinoise qui est harmonie dans l’esprit du Tao, du messianisme juif qui est en quête de salut, la mentalité grecque, dont nous sommes toujours imprégnés, est de nature agonistique. Elle ne s’est jamais vraiment dégagée d’un dualisme qui oppose l’être au devenir, dont l’issue est dans le conflit qui se résout par la victoire d’un des adversaires. Alors que la pensée chinoise neutralise les oppositions – yin et yang, contraires tout en étant complémentaires, en transformation et mutation constantes – la pensée grecque les exacerbe (v. l’« agonistisme » de la populiste de gauche Chantal Mouffe).
Cependant, d’une guerre à l’autre – et à la guerre au sens propre, il faut ajouter non seulement celle que l’on mène contre les épidémies, mais également l’engagement contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur la biodiversité – il n’y a peut-être pas de solution de continuité, mais certainement pas non plus de fatalité. Encore faudrait-il trouver le « chemin de l’altérité », nous dit François Jullien101, et pour ce faire promouvoir « la vertu de l’écart générant de l’autre » en se gardant de le mythologiser, mais sans non plus se priver de sa ressource. Dans un récent ouvrage qui est le pendant idéaliste du très réaliste Paix et Guerre entre les nations de Raymond Aron, Sundeep Waslekar, chercheur indien en relations internationales, rejoint la pensée de Hannah Arendt (supra) lorsqu’il écrit à regret dans son ouvrage, Entre guerre et paix102 : « Bien qu’elle soit plusieurs fois centenaire, la tradition consistant à produire du savoir ensemble n’est que rarement évoquée comme une entreprise collaborative mondiale visant à générer des idées pour améliorer notre sort. » Qu’on se le tienne pour dit !
Osons, donc, se projeter dans un avenir possible à défaut de posséder les séductions de l’utopie. L’Ukraine, avec la Biélorussie (Russie blanche), n’aurait-elle pas vocation à constituer ce « milieu », transition entre une Europe de l’Ouest, autrefois victime des barbares, et une Russie géographiquement rattachée à elle et spirituellement tournée vers elle, au moins depuis le XVIIIe siècle avec Pierre le Grand ? Et ce, malgré les protestations sporadiques de nationalisme, dont Dostoïevski ne fut pas le dernier représentant, et l’intermède communiste. L’Ukraine, enjeu de l’avenir de l’Europe, continent pris en tenaille entre une Amérique complexée par son passé d’immigrants et une Russie nostalgique de l’empire ? Mais, au-delà, enjeu de l’avenir de la démocratie dans le monde ? Si ce n’est que l’Europe, son avant-garde depuis les dérives démocratiques du pouvoir américain, lestée de son passé colonial, peine à convaincre et s’imposer. Entre le rapport de force commercial incarné par l’Amérique et le rapport de force militaire incarné par la Russie, de quels atouts dispose encore l’Europe pour faire prévaloir le Droit ? De quel poids pèse le soft power face à l’équilibre entretenu par la terreur et le chantage ? Le retour du rapport de force dans un monde sevré de diplomatie molle, nécessiterait un renversement stratégique donnant la priorité à l’affirmation des identités nationales, en dehors de tout réflexe nationaliste, sur la recherche d’ennemis auxquels se confronter ; plutôt que se forger une identité en s’opposant, au besoin par la force – comme Poutine le fait avec l’Ukraine – chercher d’abord à nous réarmer mentalement, pour mieux se mesurer à ceux qui nous sont hostiles103. La leçon vaut pour l’UE, embryon de fédération d’identités nationales, d’autant plus fragile qu’elle est une innovation institutionnelle relativement récente, fragilisée par la dérégulation mondiale en cours d’accélération.
Élargissant notre projection dans un avenir possible au Proche- et Moyen-Orient, les pays du Levant ne sont-ils pas au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, qu’ils pourraient contribuer à rapprocher en s’appuyant sur le legs d’Israël, pour autant que les peuples du Croissant fertile, peuple juif inclus, y consentent ? Tout autre était la position de Claude Lévi-Strauss, qui estimait dans Tristes tropiques que le monde musulman avait empêché l’Occident de se joindre au sous-continent indien, berceau de l’indouisme et du bouddhisme. Et de se demander : « Que serait aujourd’hui l’Occident si la tentative d’union entre le monde méditerranéen et l’Inde avait réussi de façon durable ? Le christianisme, l’Islam, auraient-ils exister ? » Pour Augustin Berque, « Le milieu dans lequel nous vivons, celui où se forge notre identité, c’est toujours, et à toute échelle, le milieu du monde.104 » Et, s’il en est ainsi c’est bien parce que le « milieu », défi au dualisme des Modernes, est propice au processus d’hybridation, inéluctable à terme, sauf aux peuples des cinq continents à renier leur humanité ; sachant que, géopolitique oblige, « l’humain et son milieu forment un tout indissociable »105. Mais la géographie, l’espace n’est pas seul en cause. Le temps a sa part dans le surgissement, la maturation et la cessation des conflits : poids du passé, attraction de l’avenir se croisent dans le présent, « juste milieu » insaisissable, fuite en avant éperdue de nos espoirs. État d’équilibre précaire qui ne pardonne pas. Irréversibilité du temps qui ne nous laisse que des traces : nostalgie d’âge d’or, regrets, remords, repentirs… Aussi bien, cruciale est, par ces temps d’intense perplexité, la saisie des opportunités (kairos des Grecs) quand elles se présentent. D’autant que, par la grâce de Trump, avec la complicité de Poutine, le multilatéralisme préconisé par le Droit ne compense plus la polycentalité fondée sur la force106. Complexification là encore, mais périlleuse. À qui revient de saisir ces opportunités ? Aux États représentés par leurs gouvernements, bien sûr, tout en sachant que derrière les États il y a les peuples, dont le droit à disposer d’eux-mêmes (autodétermination) est inscrit dans la Charte des Nations Unis (art. 1), à charge pour eux de composer avec le principe, contradictoire dans l’absolu, d’intangibilité des frontières reconnu par la jurisprudence. Fonder les relations internationales sur l’identité nationale est un oxymore, source d’antagonismes. Le Droit international gagnerait en cohérence à s’adosser sur l’intérêt « communautaire » qui relie les États entre eux en fonction de leur positionnement géographique, des particularités de leur démographie, de la nature de leurs ressources… Multilatéralisme différentiel, à la carte, tempérant l’universalisme des institutions internationales actuelles.
Le confinement nous avait séparé de l’espace urbain, le déconfinement nous a-t-il permis d’en prendre toute la mesure, celle d’une harmonie entre une société, diverse à plus d’un titre, et son cadre urbain, qui en serait le reflet ? À voir le piétinement actuel de la Politique dite de la Ville, victime d’autres priorités dans un contexte d’austérité économique annoncée, le séparatisme qui perdure au mépris de la continuité urbaine et sociale de la ville et de ses banlieues défavorisées, on pourrait en douter. Seul le travail des femmes et des hommes de terrain, soutenus par les élus locaux, permet d’espérer encore. Mais la volonté, sans l’État, n’y suffira pas, il y faudra un réinvestissement sur l’urbain de nature à permettre son appropriation par l’habitant quel que soit son statut social et son niveau de vie. Si les conditions économiques sont à l’origine de disparités sociales, c’est l’espace qui a séparé les groupes sociaux et c’est par l’espace, dans sa matérialité, qu’ils seront réunis, sans préjudice de leur diversité. Et c’est encore l’espace qui a séparé les nations jusqu’à leur entrée en guerre pour certaines, et, défi aux empires, c’est par l’espace qu’elles retrouveront le chemin de la paix, sans perdre leur identité. Les émeutes urbaines de 2005 et 2023, pour prendre celles qui ont le plus marqué les esprits depuis le nouveau millénaire, ne sont certes pas assimilables à une guerre, mais portent témoignage des extrémités auxquelles un séparatisme peut conduire. Séparation physique et social d’avec la ville, au sens plein du terme que revêtait la cité grecque, auquel se superpose un séparatisme social/urbain, produit d’une conception de l’urbain non seulement en discontinuité avec le reste de l’agglomération mais également en dysharmonie avec la société qu’il est censé accueillir : forme urbaine reposant sur la séparation des fonctions (résidence, travail, loisirs et transport)107 au détriment de leur intégration dans un paysage urbain enveloppant. Opposition du « dur » des formes urbaines au « doux » du paysage (cf. Michel Serres, supra.). Recouvrement nécessaire du sens par les sens, que permet le déploiement du paysage. Recouvrement parallèle de relations sociales entravées par une maîtrise abusive de l’espace, qui a la prétention de remettre chacun à sa place en fonction de son statut et sur la base de sa condition. Quand on habite une zone réputée de non-droit, reste la confrontation pour imposer la justice et affirmer une identité. Faute d’alternatives. La référence à la Tendenza d’Aldo Rossi108, ranimée par Cristiana Mazzoni, architecte, s’impose ici : « La ville contemporaine peut ainsi être interprétée à la lumière d’un réseau dense de relations et de nouveaux équilibres en mouvement, non plus comme un lieu figé ou de compétition, de confrontation ou de hiérarchies entre les parties, mais comme une coopération vaste et illimitée d’éléments. » Città analoga , telle que donnée en exemple par Aldo Rossi et Cie à la Biennale de Venise de 1976, réinterprétée par Cristina Mazzoni109, non sans effleurer la mécanique quantique : « La ville analogue est à la fois celle que nous vivons et percevons avec nos sens et celle qui agit de façon plus subtile sur notre imaginaire et nos émotions. Elle est à la fois matérielle et immatérielle, à la fois unitaire et composée d’un faisceau de lignes qui agissent dans leur singularité ». Analogie de proportionnalité : le vivant est à la nature ce que l’humain est à la ville ; l’imaginaire y rencontre le réel, le passé ressurgit dans le présent en une saine confrontation ; la société s’inscrit dans l’urbain, en consonance.
Écoutons Aldo Rossi parler de L’Architecture de la ville :
« Je considère l’architecture dans une vision positive, comme une création inséparable de la vie des citoyens et de la société où elle se produit ; elle est, par sa nature collective. »
« Création d’un environnement plus propice à la vie et intention esthétique sont les caractères stables de l’architecture. Toute recherche positive fait apparaître ces aspects, qui éclairent la ville comme création humaine.
Mais, parce qu’elle donne une forme concrète à la société et qu’elle est intimement liée à celle-ci et à la nature, l’architecture se différencie d’une manière originale de tous les autres arts et de toutes les autres sciences. »
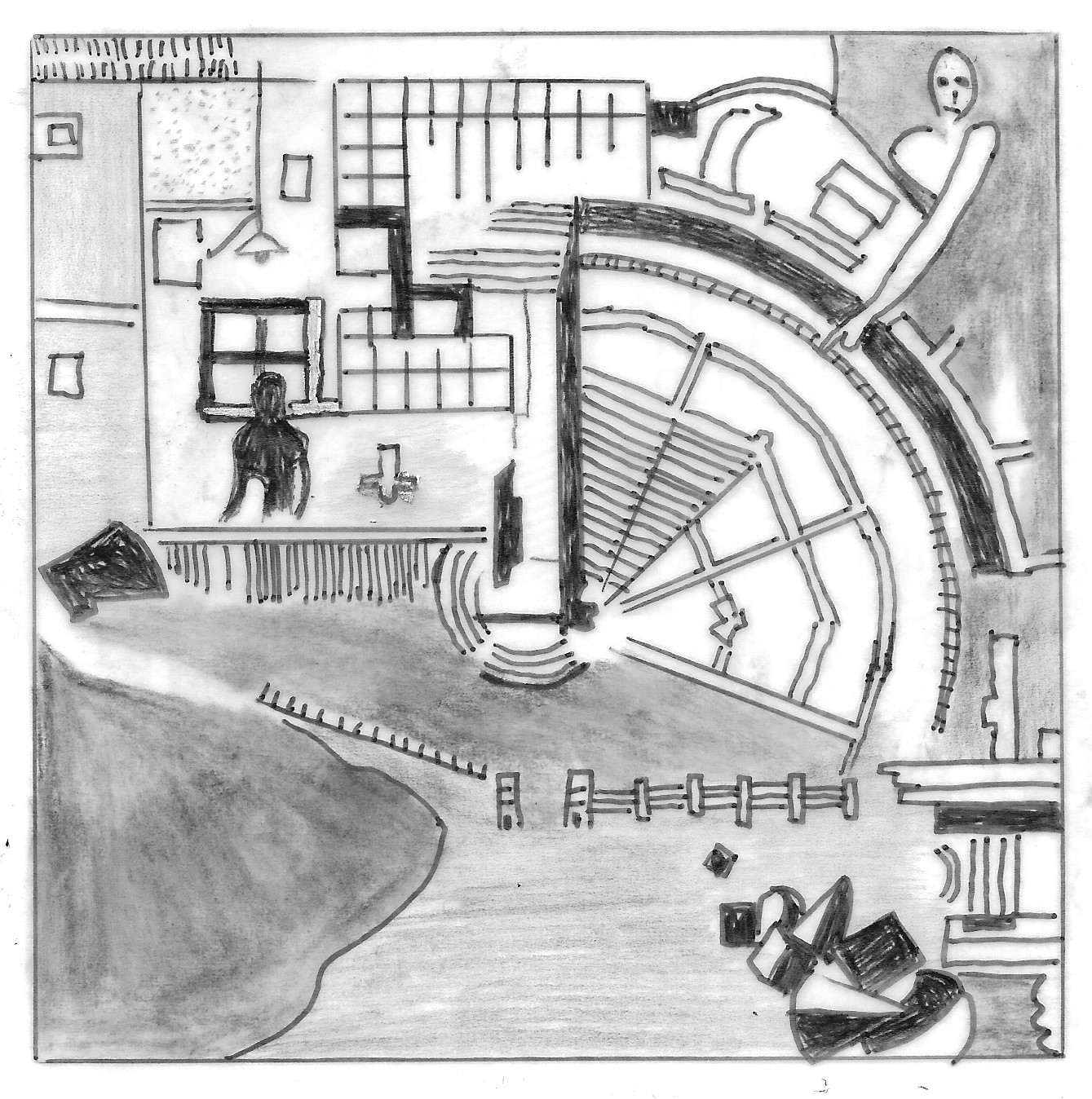
On retrouve Philippe Boudon à point nommé pour affirmer, entre esprit de géométrie et esprit de finesse ou entre géométrie et architecture que « la mesure est en effet une fonction incontournable du travail de l’architecte, lequel ne saurait déterminer les objets qu’il conçoit sans leur conférer des mesures110». Et de préciser, in fine, qu’« à cet égard l’échelle est ouverture qualitative relativement à la proportion qui, elle, est close sur le calculable. » On ne peut mieux faire la différence entre mesurer et calculer, avec ce que les deux opérations impliquent respectivement de qualitatif et de quantitatif, et donc faire ressortir le rapport de l’échelle au réel.
Passant du plan de l’architecture à celui de l’aménagement urbain, on retrouve aussi Guy Burgel, qui en appelle à un renouvellement de notre perception et de notre action sur l’urbain avec le concept d’altermétropolisation, formé à partir celui d’altermondialisation, pour désigner « des formes de métropolisation, qui conserveraient l’accumulation économique, sans les désavantages des inégalités sociales111 ».
On ne peut mieux nous rappeler au « principe de réalité », sans rien lâcher sur la poursuite d’idéaux alliant le rationnel au sensible ; ce dont les confinements répétés, après la rupture que constitua l’épidémie de Covid-19, auraient dû nous faire prendre conscience en nous privant, temporairement, de sortie dans le monde. Au lieu de quoi, ils nous ont, en réaction, plus que jamais plongés dans un déchainement des sens, hors de contrôle, encouragé par les réseaux sociaux sur lesquels les confinés se sont repliés dans l’intimité forcée de leurs foyers. Vague exploitée par Trump et ses acolytes outre atlantique avant que son déferlement sur les côtes européennes ne prenne des allures de chaos.
« Le devenir-urbain des territoires et des humains n’est pas inscrit une fois pour toute, il peut connaître des bifurcations, des arrêts, des ruptures », écrit Thierry Paquot112. Si le Covid-19 a introduit une rupture – marquée par son millésime qui pourrait bien nous en promettre d’autres avec leur hécatombe – ce ne fut pas au sens où l’entendait Walter Benjamin, une rupture ouvrant sur des possibilités inédites offertes à l’exercice de la liberté humaine, mais une rupture temporaire, pseudo-rupture, effacement d’une tranche d’histoire. Sans conséquences, cela reste à voir ? Quand bien même, sur le moment la rupture fut bien ressentie, et même violemment. Mais, qu’en est-il du confinement ? C’est un paradoxe : s’il a freiné l’épidémie, il n’a peut-être que conforter, en encourageant le repliement sur les réseaux sociaux par écrans interposés, des tendances sous-jacentes, souterraines, rampantes, conduisant au dévoiement de sens débridés, déconnectés du réel, réduit à un décor extérieur. Séparation social/urbain, séparation ville/campagne, séparation centre/périphérie, séparation des grands ensembles du reste de l’agglomération : séparatisme, même combat ! Séparatisme, faute de diversité reconnue et assumée, contrepartie de la tendance à l’uniformisation que l’on trouve dans la mode, sur laquelle s’aligne la consommation, et que l’on retrouve dans le langage, dans le formatage idéologique, dans nos comportements…, jusque dans l’architecture. Quand l’homogénéité est recherchée pour les besoins d’une économie standardisée, fondée sur la production en série, la diversité se mue en cloisonnement d’espaces uniformes à l’intérieur desquels le divers n’est plus que de surface, réduit à un système de signes113 : Société du spectacle débranchée de la réalité, « processus extensif et intensif de banalisation » écrivait Guy Debord en 1967 dans son livre éponyme, ajoutant, rapport à la performance de nos moyens de communication : « Cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance, en tant que séparation spectaculaire. » Représentation-séparation, lourd héritage du dualisme cartésien, que ni l’expressionnisme de Spinoza ni celui de Leibniz n’ont aboli, expressionnisme que Deleuze se réappropria dans un élan de générosité qu’il partagea avec Félix Guattari pour notre bonheur de lecteur et de militant de la vie bonne.
Le Covid a alarmé sur les périls auxquels nous ont exposés « la maîtrise et la possession de la nature », le confinement aura alerté en vain sur leurs conséquences : la déperdition de diversité sous l’artificialisation de l’activité que la numérisation a accéléré à l’époque contemporaine ; conséquences grosses de menaces qui pèsent sur la démocratie, expression politique de la diversité humaine. Le Covid a mis provisoirement la science, confrontée à la mort, sur le devant de la scène, l’après-Covid y aura substitué la politique, confrontée à l’anomie sociale. Déjà oubliée cinq ans après, la pandémie n’en a pas moins laissé des traces, dommages collatéraux, séquelles de douleur physique et souvenirs de souffrance morale cumulés, infléchissant le cours des évènements, inconsciemment peut-être, en tous cas non dits, affectant les « survivants » d’une terre commune, dont l’intégrité était déjà bien entamée par les atteintes portées au milieu naturel et les désordres internationaux qui ont culminé dans le libre-échange économique et des guerres fratricides. La défense des droits de la nature et d’une vie saine a concurrencé celle des droits de l’homme, jusqu’à venir les supplanter. Avant et après la pandémie, si incongru que puisse paraître le rapprochement, le terrorisme se superposant aux conséquences du dérèglement climatique et aux dégradations subies par l’environnement, a meurtri des chairs irrémédiablement. Défaite de la raison, tyrannique, et des sens, assoupis, sur laquelle le confinement aurait dû nous instruire, nous alerter pour faire prendre conscience de l’urgence d’un décloisonnement entre celle-là, si inflexible, si indomptable soit-elle, et ceux-ci, trop malléables, influençables. Préalable avant que de faire jouer les interdépendances, la solidarité : rectification des déviations de la raison parallèlement au réveil de la sensibilité, anémiée à force d’excitation, d’exacerbation, d’exaltation des sens. Sens entremêlés, embrouillés, dans le même temps où la raison instrumentalisée leur était soumise.
Les réseaux sociaux, sur lesquels s’étaient repliés les confinés du Covid et qui ont pris le relai des idéologies, véritables fantasmagories sociales dont Hannah Arendt a dénoncé les conséquences politiques114, ne s’en trouvent-ils pas confortés, entérinant l’émergence de mondes parallèles, virtuels, déconnectés, réinterprétant l’espace rhizomatique de Deleuze et Guattari, dont les lignes de fuite se retrouvent isolées, au point de devoir renoncer à toute direction, d’en perdre toute orientation et d’abandonner toute velléité de prise sur le réel ? Lequel réel serait, alors, irrémédiablement livré aux fabulateurs, manipulateurs et autres imposteurs, dans les styles contrastés d’un Trump ou d’un Poutine. Pour un peu, ce serait Deleuze et Guattari qui se trouveraient dépassés par leurs contempteurs, Luc Ferry et Alain Renaud, auteurs de La Pensée 68. Comme quoi nous sommes toujours tributaires de ce qui forme la trame des évènements que nous vivons, il n’y a pas de philosophie perennis, de philosophie éternelle115, sauf, peut-être celle émanant des mythes premiers. On peut bien préjuger de l’avenir que nous réserve Poutine, constant dans la mise en œuvre de sa stratégie impérialiste, mais que résultera-t-il à terme du Trumpisme, autrement versatile, d’un excès de « divers », dépourvu de bornes pour s’orienter : un nouveau totalitarisme, un anarchisme de style new age, un effondrement, ou bien une ultime bifurcation de la démocratie ? Quoi qu’il en soit, même si l’Amérique redressait le tir, il en restera toujours des traces.
Tendances lourdes de menaces, mais, entre nos mains d’anonymes, dont le réveil perdrait à se faire trop attendre, ne pourraient-elles pas être allégées d’espoir. Nulle « main invisible » ne saurait, en effet, entraver leur dextérité « naturelle ». Sauf à en supputer quelque encouragement, il n’est pas nécessaire de « croire », la volonté devrait y suffire, individuellement et collectivement, pourvu que la pensée, dont chacun est également pourvu, accompagne l’action, à bon escient, avec sapience.
Si les problématiques soulevées par Michel Serres sont encore d’actualité, si la raison bute toujours sur la réalité et si la dispersion des sens menace notre identité, les temps ont changé et l’environnement avec. En publiant Les cinq sens en 1985, il ne pouvait prévoir les bouleversements auxquels Internet et les réseaux sociaux allaient précipiter le monde ? Les avait-il pas pressentis ? Dénonçant l’assoupissement des sens sous le langage, commencé avec l’imprimerie et l’informatique, poursuivi avec l’instrumentalisation du langage par les sciences, il n’eut de cesse que d’espérer de ce même langage – dégagé de son carcan de scientificité, ouvert au monde sensible – qu’il décuple ses potentialités pour libérer les sens de la domination de l’abstraction dans laquelle il avait fini par les faire sombrer : la culture rejoignant les mythes par-delà la science. Hélas ! qui aurait pu prédire que le passage du Nord-Ouest serait libéré des glaces avant que les sciences « dures » ne se brisent sous la poussée des sciences « douces », dites humaines. Combien de temps faudra-t-il encore pour que celles-ci s’infiltrent dans le bloc inébranlable de ces sciences que l’on dit aussi « exactes », afin de révéler au monde la puissance de la diversité sensible sous la raideur de la raison spéculative ? Mariage des sens et de la raison pratique, dont la droiture contient les excès ; valorisation du sens du toucher que la vision relaye ; « visite » du monde environnant guidée par l’intellect ; un monde mis à distance pour les besoins de l’objectivité. Extériorisation compensée par l’enveloppement du sens de l’ouïe ; libération de l’odorat et du goût, sens internes, qui sont au corps ce que l’intuition est à l’esprit.
Défaite la raison. Sa chute, brutale, a précipité le déchainement des sens dans un mouvement brownien éperdu, à la recherche de bouées auxquelles s’accrocher ; agitation qu’aucun démon de Maxwell n’est venu réguler ; spectacle de désolation que nous renvoient les réseaux sociaux. Les « Corps mêlés » de Michel Serres ne sont, dorénavant, que corps embrouillés n’ayant plus rien d’une balance de poids et contrepoids, d’une esthétique sensible, au sens kantien du terme, rejoignant l’art, de corps solidaires des âmes : « … nous ne pouvons faire vivre une culture, une pensée, qu’en la nourrissant de ce qui n’est pas elle. La langue se ferme côté langue, close sur son exactitude, précision, rigueur, ses qualités, elle s’ouvre côté monde, inchoative et inexacte, hésitante et féconde là. » Si le coronavirus a introduit une rupture dans notre histoire, pseudo-rupture occultée, le confinement n’a peut-être que contribué à parfaire le lit d’un courant rampant d’exacerbation des sens sous la domination d’une raison instrumentalisée sur laquelle Trump a surfé. D’un excès de raison totalitaire sur des sens éclatés, émoussés, on sera passé à une exaltation des sens sur une raison annihilée à force d’être instrumentalisée. Passage du Nord-Ouest libéré dans l’anarchie de sens exacerbés jusqu’au non-sens. Revanche des sens, opprimés par la souveraine Raison des Lumières ?
*****
En 1992, Francis Fukuyama prédisait La fin de l’Histoire ; quatre ans plus tard, en 1996, Samuel P. Huntington, contredisant la fin annoncée, anticipait Le Choc des civilisations. Gageons que les temps qui courent, parce que nous sommes le dos au mur, sont les prémices d’un sursaut qu’on voudrait salutaire. Non pas qu’il faille se perdre en illusions, mais simplement admettre que, si imparfait, si limité que soit le monde habitable, c’est de cette incomplétude même, jamais épuisée, que se dégage du mieux à défaut de meilleur. Toujours, donc, s’en rapporter au « Principe Espérance » comme le préconisait Ernst Bloch116. Un principe qui, après tout, peut bien se nourrir d’utopie pour se donner de l’élan, à condition que le désir qui le porte – à l’exemple de celui de La Dame à la Licorne, dont le « toucher », osé, est la pierre angulaire – reste ancré dans le réel : « En conjuguant le courage et le savoir, l’homme empêche que l’avenir ne s’abatte sur lui comme une fatalité, il le conquiert et y pénètre avec tout ce qui est sien. Le savoir, dont ont besoin le courage et surtout la décision, ne peut ici rester tel qu’il a toujours été : simplement contemplatif. » Savoir, courage, engagement hors des arcanes de l’abstraction promise par l’intelligence artificielle, dite générative, c’est bien le moins que l’on puisse souhaiter à la génération qui monte… pour qu’un beau matin soit une renaissance, une résurrection disait aussi Michel Serres avant de mettre le point final aux Cinq Sens117. Peut-être moins un nouveau commencement dans la rupture qu’auraient pu concevoir Benjamin et Deleuze qu’un recommencement dans l’harmonie selon la sagesse chinoise ? Soit : plutôt qu’un retour du même dans la différence qu’avait entrevu Deleuze, un nouveau commencement dans la rupture qu’aurait pu concevoir Benjamin ou, encore mieux, un recommencement dans l’harmonie selon la sagesse chinoise ?
Il ne tient qu’à la conscience humaine de retenir les maléfices dans la boite de Pandore et d’en libérer l’espoir, avec ou sans l’aide ciel. Dieu que beaucoup laissent indifférents ; Dieu des juifs, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans ; Dieu incarné pour les uns – Christ de la parousie que le « Grand Inquisiteur » en viendrait à persécuter pour avoir apporté à l’Homme une liberté qu’il ne méritait pas118 –, Dieu en gloire pour les autres, ou spectre qui hante les damnés de la terre ? Dieu ou Satan, Antéchrist, Antichrist, c’est selon ; en son nom, mal et bien confondus, on a tué et on continue de tuer en l’invoquant ; trou noir de la transcendance, redouté autant qu’irrésistible, redouté parce qu’irrésistible ; exutoire des maux dont la société déborde dans son impuissance à les combattre, les reléguant dans les marges – marges de l’humanité, marges de la société, marges urbaines… – où ils macèrent avant de diffuser subrepticement, surprenant les meilleurs des bien-pensants et les plus vigilants des défenseurs de l’ordre. Ruptures prédominant dans la continuité historique ou discontinuités dans la permanence du temps ?
Michel serres, François Jullien, Gilles Deleuze, Walter Benjamin : l’éloge de la diversité, la poursuite de l’harmonie, la traque des différences dans l’univocité, la convergence du messianisme avec la révolution sociale, autant d’auteurs, de philosophies, de théories dont se détacher après s’en être inspiré pour mieux sentir le monde et y laisser une empreinte à la mesure des dispositions que nous cultivons en propre. Mais en restant à l’écart des débats actuels sur les rapports entre la nature et culture, qui nous renvoient tantôt à un dualisme sommaire, héritage de la logique classique, tantôt à un relativisme qui nous plonge dans la confusion avec Philippe Descola et Bruno Latour. Si, comme l’écrit Baptiste Morizot119, « la crise de nos relations au vivant est une crise de la sensibilité », alors, les concepts d’hybridité et d’hybridation, pour autant qu’on en dévoile les ressorts, – dynamique de la mise en relation dans l’espace et dans le temps (v. supra) – pourraient nous fournir les bases d’une sortie de crise que l’on aurait pu pressentir dans l’expérience du confinement, lequel nous a momentanément privé de l’accès au dehors et aux autres, condition sensible de notre présence au monde ? Culture contre nature120 ou culture avec nature : opposition qui résume toutes les autres ou distinction dont on se perd à définir les limites, à rechercher un fondement ; opposition ou distinction théoriques, sujet de vaines spéculations, dont les implications dépassent et l’entendement et la sensibilité, qui nous mènent dans des impasses, quels que soient les auteurs qui s’en réclament pour en défendre la pertinence ou la contester. Revanche de la nature recouverte par la culture, Montherlant l’avait pressenti dans l’entre-deux guerres, qui écrivait : « Être à la fois, ou plutôt faire alterner en soi, la Bête et l’Ange, la vie corporelle et charnelle et la vie intellectuelle et morale, que l’homme le veuille ou non, la nature l’y forcera qui est toute alternances, qui est toute contractions et détentes121. » Nature bienveillante en somme, la prédiction mérite d’être retenue par les temps qui courent de catastrophes naturelles. Nature resurgie des décombres de la Modernité, non pas contre la culture mais à ses côtés. Les théories nous tiennent à distance des faits pour les besoins de l’analyse ; la sensibilité et les émotions nous rapprochent du terrain pour agir en connaissance de causes et intuition des fins. Entre les deux il reste à concevoir des solutions aux travers et aux maux qui nous accablent : en raison, dialogiquement et toute sensibilité en éveil. « Entre analyse et décision se loge de facto un troisième terme : la conception, notion qui sort ordinairement du balisage courant de la connaissance » écrit Philippe Boudon, faisant ressortir implicitement, au-delà de l’architecturologie, sa spécialité, l’infirmité de nos débats parlementaires dans l’ordre de la politique, de l’économique et du social. « La décision est affaire d’action visant un but, la conception affaire d’opérations alternatives entre lesquelles choisir pour atteindre le but. Une distinction entre action et opération serait de nature à soutenir la distinction entre décision et conception », précise-t-il un peu plus loin122.
Sidérés et abattus par la vague terroriste, par les émeutes urbaines, par la proximité de la guerre, par les catastrophes naturelles – « principe de réalité » dépassé par Thanatos, « instinct de mort », Eiréné débordé par Arès – il ne manquait que le choc du confinement pour nous réveiller. C’est, hélas ! désormais au narcotrafic – Dionysos triomphant d’Apollon – qu’on risque de le devoir, faute d’avoir pris la mesure de ce que les trafiquants devaient à l’explosion de la consommation. Et, c’est bien en vain que l’on recherche des responsabilités : à gauche, côté compassion, restauration ; à droite : côté répression, rétribution ; quand il faudrait incriminer – plutôt que d’imputer la religion, le déséquilibre mental, l’immigration, le défaut d’intégration sociale ou le laxisme libéral – la banalisation du mal à la charnière de l’individu, de la société, de la nature ; soit l’éducation, à la rescousse du sens perdu de la vie dans le marigot des réseaux numérisés, dont les ravages sont en voie d’être dépassés par la drogue et son trafic. « Banalité du mal » dont les racines ramifiées, le rhizome, menacent les fondements sur lesquels l’humanité a jusque-là bâti son œuvre, entre passé irréversible et avenir irrésolu : présent de transition, rédemption, salut, ouverture sur la liberté, libération ?
L’exhortation de Sade dans La Philosophie dans le boudoir (1795) :
« FRANÇAIS,
Encore un effort si vous voulez être républicain »,
au centre des turpitudes qui font l’objet de sept dialogues libertins, renverrait-elle à notre siècle désemparé, 230 ans après (magie des chiffres ronds, toujours, comme un éternel retour) ? Téméraire le rapprochement, voire scandaleux ? Le pamphlet philosophique et politique mis au même niveau que les orgies qui l’encadrent, pourrait nous en persuader. Si ce n’est que notre temps n’est avare ni de polémiques ni de turpitudes. Caricature alors ? Qui ne souscrirait à ce principe constitutionnel : « … un gouvernement, dont le seul devoir consiste à conserver, par tel moyen que ce puisse être, la forme essentiel à son maintien ; voilà l’unique morale d’un gouvernement républicain […] » ? Ou à ce précepte : « … c’est une injustice effrayante que d’exiger que des hommes de caractères inégaux se plient à des lois égales […] » ? Il ne faudrait pas chercher bien loin ! Et qui ne serait pas tenté de conclure avec le divin Marquis se référant aux législateurs de la Grèce antique : « … je demande comment on parviendra à démontrer que, dans un état immoral par ses obligations, il soit essentiel que les individus soient moraux » ? Avant d’ajouter, perfide : « je dis plus, il est bon qu’ils ne le soient pas […] » Pour Donatien Alphonse François de Sade, libertarien avant l’heure, qu’est-ce que la République, sinon la Nature dans ce qu’elle a de plus jouissif et de plus cruel, à laquelle un bon républicain ne peut que se soumettre, avec les autres mais chacun pour soi, dans une frénésie de débauches où le sexe côtoie le crime dans l’allégresse. L’adresse n’en reste pas moins valable dans la forme, sous réserve de pouvoir dire ce qu’est « être républicain » aujourd’hui, dans un contexte institutionnel pour le moins instable, dont la légitimité est remise en cause, et à condition, aussi, d’être un peu moins « français » qu’il n’y paraît.
Le boudoir, symptôme des débordements d’un monde en déliquescence, refuge désormais ouvert à tous vents des libertins philosophes en quête d’une société réduite à un état de nature débridée, où l’individu-roi exerce sa tyrannie décomplexée. Éden béni par les nouveaux évangélistes ? À l’heure où la société se liquéfie, où la politique se délite, où la diplomatie semble perdre pied face aux menaces qui s’accumulent, où le multilatéralisme cède devant les antagonismes de puissance, ne sommes-nous pas tout près d’un point de rupture, de bascule selon un terme galvaudé, que le Covid aurait préfiguré, comme pour nous donner un avant-gout de ce à quoi on pouvait s’attendre, que le confinement n’aura pas réfréné : point de rupture sous forme de retour archaïque du religieux ou de visée identitaire ? Plus cela va, plus le choix se rétrécit entre les deux. Dans tous les cas, on se trouve confrontés à un point de rupture radical où l’exigence d’objectivité prend eau de toutes parts, où la neutralité n’est plus permise, si elle l’a jamais été, et où, par conséquent, on ne pourra se passer de prendre parti, le risque avec. « L’amour est fort comme la mort » proclame la Sulamite du Cantique des cantiques. Reste à savoir qui de l’amour ou de la mort vaincra l’autre ? Qui du Cantique des cantiques ou de l’Apocalypse l’emportera ?
- Transformations de l’homme, cité par Thierry Paquot dans sa présentation de l’Histoire naturelle de l’urbanisation du même auteur. ↩︎
- De Nîmes à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Saint-Étienne, l’Ile de France, la Lorraine, la Corse, la Réunion, Mayotte, les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon, Budapest, carrière riche en projets marquants, mais aussi, parfois, en déceptions quant aux espoirs qu’ils avaient faits naître. À titre d’exemples : l’aménagement des Rives de l’Étang de Berre, sujet d’un projet de thèse, abandonné faute de ressources financières ; le redressement financier de la Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP) de Pissevin à Nîmes, Xavier Arsène-Henry, architecte en chef, occasion manquée de mettre en révision un plan rigide de grand ensemble moderniste des années 60 ; la réhabilitation de la ZUP de Montreynaud à Saint-Étienne avec Christian Devillers, architecte, et Michel Corajoud, paysagiste (projet d’ensemble de maisons de ville en rupture avec l’urbanisme de tours et de barres de Raymond Martin, architecte en chef, laissé en rade après le renversement de la municipalité à majorité communiste) ; l’étude de la faisabilité d’une société d’économie mixte (SEM) en vue de la reconversion des vallées de la Fensch et de l’Orne, désolation des friches sidérurgiques de Lorraine, projet pourtant non abouti ; la Tour de la Terre (Nicolas Normier, architecte), 200 m de hauteur, en bois, en bordure du canal de l’Ourcq dans le parc départemental de la Bergère à Bobigny, dédiée aux quatre éléments naturels exposés en parallèle avec leur symbolique, magistralement décrite par Gaston Bachelard dans son œuvre ; le Grand Projet de Ville (GPV) de Champigny, expérience d’intégration de deux grands ensembles dans le tissu urbain existant, avortée bien à regret ; le regroupement des quatre communes urbaines du Grand-Nouméa dans un syndicat intercommunal à vocation multiple (participation à la cohabitation pacifique entre Caldoches et Kanak, dans un ensemble mi-urbain mi-rural, dont le destin est aujourd’hui suspendu à la mise en œuvre négociée de l’accord de Bougival) ; la rénovation du VIIIe arrondissement de la périphérie de Budapest, contribution à la transition libérale (et capitalistique), opérée par la Hongrie, au début des années 1990 (avec hélas ! des suites politiques à contre-courant) ; sans oublier la Corse, l‘ « Île sans rivage », la « Renfermée », de Marie Susini, dont l’équipement est un soutien ou un défi à son aspiration à l’autonomie (cf. le rôle de la CORSAM, société d’économie mixte d’aménagement) ; … ↩︎
- « Le livre de sable » dans l’ouvrage éponyme. ↩︎
- « La bibliothèque de Babel » dans le recueil Fictions. ↩︎
- Idem. ↩︎
- In Critique de la violence, article de 1921. ↩︎
- Cf. La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, ouvrage d’Yves Lacoste (1976). Ne surtout pas sous-estimer l’emploi de la locution adverbiale « d’abord » pour comprendre toutes les implications du titre. ↩︎
- V. Le nœud démocratique sous-titré Aux origines de la crise néolibérale de Marcel Gauchet (2024). Interprétation édifiante de la crise de la démocratie. ↩︎
- Cf. la Charte d’Athènes de 1933 rédigée par Le Corbusier. ↩︎
- Cf. Charles Jenks, architecte, aux États-Unis, Aldo Rossi, également architecte, en Italie, Jean-François Lyotard, philosophe, en France. ↩︎
- Cf. Martin Heidegger, philosophe, en Allemagne, Jacques Derrida, philosophe, en France, Frank Gehry, architecte aux Etats-Unis, Rem Koolhaas, également architecte, aux Pays-Bas. Déconstructivisme comme envers du Constructivisme soviétique (Vladimir Tatline) et du Futurisme italien (Filippo Tommaso Marinetti) de l’entre-deux guerre. ↩︎
- Si le grain ne meurt. ↩︎
- Notre animalité perdue sous-titrée Vivre avec nos violences (2025). ↩︎
- Cf. Antoine Bevort : Le paradigme de Protagoras (Socio-logos, 2/2007). ↩︎
- Justine (premier des quatre romans composant l’œuvre). ↩︎
- Concernant la question de la survenue rare d’évènements graves, imprévisibles ou peu prévisibles, voir respectivement : Le cygne noir : la puissance de l’imprévisible de Nassim Nicholas Taleb et The gray rhino : How to recognize and act on the obvious dangers we ignore de Michele Wucker. ↩︎
- « Qu’est-ce que la déconstruction ? » dans la revue Commentaire n° 108 (4e trimestre 2004). ↩︎
- Transfert opéré par le psychologue Cyrulnic dans Le murmure des fantômes (2003). ↩︎
- Guy Burgel, Raymond Ghirardi, Maxime Schirrer et Pierre-Régis Burgel : « Le coronavirus dans le Grand Paris – Démographie et société » in Guy Burgel (Dir.), Ville et Covid : un mariage de raison (2021). ↩︎
- Cf. Les grandes villes et la vie de l’esprit extrait de Philosophie de la modernité (1903). ↩︎
- Entrer dans une pensée – Des possibles de l’esprit (2012). ↩︎
- « La religion de l’Autre » in Le Débat, 40 ans, Mai-Août 2020. ↩︎
- Internationale situationniste n° 2 (1958). Il s’agit d’une errance de nature psychogéographique par laquelle « une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent ». ↩︎
- Cf. Entrer dans une pensée – Des possibles de l’esprit (2012). ↩︎
- V. l’exposition « Banlieues chéries » au Musée de l’histoire de l’immigration (avril-août 2025). ↩︎
- Cf. Essai sur l’exotisme sous-titré Une esthétique du divers de Victor Ségalen (1921, ébauche posthume d’un projet de livre que la mort prématurée de l’auteur, atteint d’une « neurasthénie aiguë », a empêché de mener à terme). ↩︎
- Cf. Freud : Une difficulté de la psychanalyse, article de 1917, extrait de Essais de psychanalyse appliquée (1933). C’est sans compter avec la révolution philosophique de Kant, dite copernicienne, et la révolution énergétique de James Watt (machine à vapeur), puis après les premières ébauches de la théorie psychanalytique, la révolution de la relativité d’Einstein et la révolution quantique en physique (Max Planck, entre autres). ↩︎
- Totalité et infini – Essai sur l’extériorité (1971). ↩︎
- Notre animalité perdue, op. cit. ↩︎
- Les grandes villes et la vie de l’esprit (op. cit.). ↩︎
- Cf. La “nature” de la ville – Esquisse d’une philosophie du phénomène urbain de Stéphane Gruet (2017). ↩︎
- Aristote, La politique (Livre I). ↩︎
- Stéphane Gruet, op. cit. ↩︎
- Op. cit. ↩︎
- Notre animalité perdue, op. cit. ↩︎
- « Une mutation de l’arbre taillé : la ceinture verte de Francfort » (Villes en parallèle 49-50 : Matériaux pour la ville de demain – 2020). ↩︎
- C’est Feuerbach qui a titré un de ses ouvrages : L’homme est ce qu’il mange : Le mystère du sacrifice, et qu’il a pu affirmer en bon matérialiste que : « La nourriture de l’homme est la base de la culture et de l’esprit de l’homme ». ↩︎
- Notre animalité perdue, op. cit. ↩︎
- Voir notamment : La vie et la correspondance de Charles Darwin publiée par son fils Francis en 1888. ↩︎
- Les chasseurs cueilleurs ou l’origine des inégalités (1982). ↩︎
- Le riz, le jade et la ville. Évolution des sociétés néolithiques du Yangzi (2005), cité par Thierry Paquot dans son commentaire de l’Histoire naturelle de l’urbanisation de Lewis Mumford (1956). ↩︎
- Les Lumières à l’âge du vivant (Seuil, 2021). ↩︎
- United States Immigration and Customs Enforcement. Voir le témoignage de Richard Ford, écrivain américain, dans Le Monde daté des 25 et 26 janvier 2026. ↩︎
- Cf. Le discours antillais (1981). ↩︎
- Cf. Introduction à la pensée complexe (1990). ↩︎
- Chiffres repris par Guillaume Devin : Notre système international sous-titré Une approche politique des relations internationales (2025). ↩︎
- Le nœud démocratique, op. cit. ↩︎
- Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix (1785) : paradoxe illustrant l’intransitivité des préférences individuelles par rapport à la majorité. ↩︎
- Social choice and individual values (1951) : théorème d’impossibilité généralisant et démontrant mathématiquement le paradoxe de Condorcet. ↩︎
- Discours de Béthune du secrétaire général de la S.F.I.O. au sujet de la politique économique de la droite responsable de la limitation du pouvoir d’achat. ↩︎
- La gauche la plus bête du monde. ↩︎
- Qu’est-ce que le populisme ? sous-titré Définir enfin la menace (2025). ↩︎
- Cf. Aldo Rossi : L’architecture de la ville (2001). ↩︎
- Cf. Jacques Donzelot : Faire société sous-titré La politique de la ville aux États-Unis et en France (2003). ↩︎
- Culture d’importation, la culture américaine n’a eu aucun mal à dépasser la culture européenne, dont la progression a été interrompue par deux guerres mondiales gagnées avec l’aide des États-Unis. ↩︎
- Extrait de l’entretien avec Claire Parnet dans l’Abécédaire de Gilles Deleuze (1988). Et le philosophe d’ajouter : “C’est ça être de gauche […]” ↩︎
- Dans Géographie urbaine coécrit avec Alexandre Grondeau (2015, réédité en 2020). ↩︎
- La technique et la science comme « idéologie » (1973). ↩︎
- Pour une interprétation littéraire des controverses scientifiques (2013). ↩︎
- Yves Citton, op. cit. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Cf. L’illusion du consensus : 2005 (traduction française : 2016). ↩︎
- Cf. Carl Schmitt : La notion de politique (1932). ↩︎
- Cf. Edgar Morin : Introduction à la pensée complexe (1990). ↩︎
- Cf. Différence et répétition, op. cit. ↩︎
- V. La pensée 68, sous-titrée Essai sur l’antihumanisme contemporain (1988). ↩︎
- Les faux-monnayeurs. ↩︎
- Rappel de la formule que le président Mitterrand avait tiré du Don Quichotte de Cervantès (Livre II) : « Il faut donner du temps au temps ». ↩︎
- Cf. Différence et répétition, thèse soutenue en 1968 par l’auteur. ↩︎
- Cf. La société du spectacle de Guy Debord : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annoncent comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation. » Et La philosophie de l’expression de Giorgio Colli : « Chaque chose du monde exprime une autre chose, et chaque chose qui est exprimée par une autre, à son atour en exprime une autre encore. En sondant la nature des choses nous parcourons le chemin de l’expression, recherchant à chaque fois quelque chose qui se tient derrière et qui est exprimé. Dans cette voie vers les profondeurs nous parvenons souvent à un point qu’il est impossible de dépasser. Des expressions se révèlent et nous ne savons pas ce qu’elles expriment : celles-ci aussi renvoient à autre chose, mais nous
ne pouvons pas dire à quoi. » (In Philosophie du contact du même auteur) C’est dire, l’énigme dans laquelle nous plonge le miroir de l’expression, qui renvoie à l’infini, contrairement à la représentation, toujours limitée. ↩︎ - In Au-delà du principe du plaisir. ↩︎
- Michael Löwy dans Walter Benjamin : avertissement d’incendie sous-titré Une lecture des thèses « Sur le concept d’histoire » (2018). ↩︎
- In Les transformations de l’homme, op. cit. ↩︎
- Référence au Deutéronome, 6 : 5 et à l’Évangile selon saint Matthieu, 22 : 37. Un Dieu non seulement jaloux, mais que l’on devait craindre avant qu’il ne soit exigé de l’aimer. Commandement divin dont l’esprit est encore loin de celui, humain, de la Règle d’or et de l’amour du prochain prôné par les Évangiles. ↩︎
- Voir l’Histoire mondiale de la France sous la direction de Patrick Boucheron : 2017 (nouvelle édition augmentée en 2025). ↩︎
- Différence et répétition, op. cit. ↩︎
- Cf. Jules Lagneau : « L’étendue est la marque de ma puissance. Le temps est la marque de mon impuissance. » (Cours sur la perception in Célèbres leçons). ↩︎
- Syncrétisme et alternance (1926) in Aux fontaines du désir, recueil de textes publiés en 1927. ↩︎
- Du vrai, du Beau et du Bien (1853). Formulation de l’éclectisme de l’auteur, exposée dans le résumé de l’ouvrage, objet du dernier chapitre : « Le sentiment est attaché intimement à la raison ; il en est la forme sensible. » Voilà pourquoi « nous croyons l’homme tout aussi grand par le cœur que par la raison », conclut-il. ↩︎
- In « Autres Temps », Les cahiers du christianisme social (1985). ↩︎
- Cf.La constitution de la liberté (édition originale en Anglais : 1960). ↩︎
- Cf. Concurrence et esprit d’entreprise (2005). ↩︎
- Cf. Capitalisme, socialisme et démocratie (1942). ↩︎
- Question à laquelle il est répondu par le principe de raison suffisante dans : Principes de la nature et de la grâce. ↩︎
- Essais et conférences (Gallimard, 1958). ↩︎
- Fondation Cartier pour l’art contemporain (2008). ↩︎
- Texte sur Marseille (1929) extrait de Portraits de villes. ↩︎
- Paris, capitale du XIXe siècle, introduction au Livre des passages, dont la rédaction fut interrompue par la mort de l’auteur et dont seuls des fragments nous sont parvenus. ↩︎
- Fragment du Livre des passages. ↩︎
- Paris, capitale du XIXe siècle (op. cit.). ↩︎
- signalons tout de même la solution proposée par Jean Rémy dans son ouvrage : L’espace, un objet central de la sociologie (2015). Partant du constat que, entre contingence et nécessité, aspiration à la liberté et revendication de l’égalité, sédentarité et mobilité, le monde dans lequel nous vivons au quotidien relève plutôt des modalités du possible, il introduit la notion de « transaction », démarche volontariste s’insérant à la fois dans des « trajectoires individuelles » et des «processus collectifs » permettant de venir à bout d’« exigences contraires, entre lesquelles il faut trouver une composition adéquate » ou « un moyen terme acceptable entre des objectifs différents ». Conception dynamique des relations sociales dont les bases matérielles ménagent un espace de liberté (cf. supra la recherche de compromis de nature à débloquer les impasses dans lesquelles nous ont enfermé les logiques majoritaires). ↩︎
- Encore faudrait-il s’entendre sur ce que recouvre le terme de « guerre » : guerre entre humains (classique ou nucléaire), guerre contre les vivants, guerre contre la nature (réchauffement climatique) ? Et quels sont ces « extrêmes » : civilisation parvenue à son terme, extermination de l’humanité, fin du monde ? Est-il même besoin d’une guerre pour parvenir à ces fins ? Et après… Quel destin nous réserve la folie des hommes, étant donné que si le pire venait à affecter notre planète, l’univers n’en serait pas moins sauf, dont on ignore tout du devenir. Univers loin de dire son dernier mot, si jamais il le dira ! ↩︎
- De la lutte des classes à la lutte des places (2009). ↩︎
- In La comédie des Ânes ou l’Asinaire. ↩︎
- In De Cive. ↩︎
- On notera en passant que si la raison ne cesse pas pour autant d’être un privilège de l’homme en ce qu’il en abuse pour tourmenter, torturer, tuer ses semblables, c’est tout autant pour se nourrir de la chair des autres espèces, en tant qu’omnivore (v. supra). Loup pour lui-même, l’homme n’en reste pas moins prédateur au dépend des autres espèces. Pour Mauriac, relayant Albert Schweitzer, la propension des espèces du règne animal à s’entredévorer pourrait constituer un argument de poids contre l’existence de Dieu, si ce n’est que les voies du divin, à l’égal de celles de la nature, sont impénétrables. Et que dire du penchant des humains pour la guerre, quand, de plus, c’est au nom de Dieu qu’ils la font. Entre les adeptes des différentes religions, qui croire ? Ou, plutôt, que croire ? ↩︎
- Cf. Critique de la violence, op. cit. ↩︎
- In Notre animalité perdue (pour les deux citations qui suivent). La thèse de Deschamps devrait, toutefois, être modulée pour prendre en compte les recherches les plus récents des préhistoriens, croisées avec celles des ethnologues, démontrant que sédentarisation et nomadisme pouvaient se chevaucher, que des chasseurs-cueilleurs pouvaient pratiquer des formes d’agriculture et d’élevage, comme le rappelle Thierry Paquot dans son commentaire de l’article de Mumford sur l’Histoire naturelle de l’urbanisation. Il n’y a pas toujours eu synchronisme au Néolithique. (V. supra sur l’universalité de la diversité, en tout temps .) ↩︎
- « Le plus dangereux, dans la violence, est sa rationalité » (Entretien avec M. Dillon : « Foucault étudie la raison d’État » in Dits et écrits II). ↩︎
- Entrée dans une pensée (2012). ↩︎
- L’Écart et l’Entre (2012). ↩︎
- Sous-titré Histoire et politique des conflits dans le monde (2022). ↩︎
- Cf. « Dialectique ami-ennemi : mieux nous définir pour mieux définir l’ennemi » d’Amaury de Pillot de Coligny dans Revue Défense nationale, n° 806, 2018. ↩︎
- Milieu et identité humaine – Note pour un dépassement de la modernité (2010). ↩︎
- Ibid. On notera qu’en extrayant ces deux citations d’Augustin Berque de leur contexte, on se permet d’en outrepasser quelque peu le sens : le « milieu » devant être strictement compris chez lui comme « relation entre une société et son environnement. » C’est par extension qu’on se tient au milieu, mais sans que celui-ci soit détaché de l’environnement, ce qui serait réintroduire une dualité. ↩︎
- V. Notre système international, op. cit. ↩︎
- Charte d’Athènes, op. cit. ↩︎
- Cf. L’ Architecture de la ville (1966). ↩︎
- V. « Nouveaux regards sur l’architecture de la ville » in Villes en parallèles n° 51-52 (2023) : Ville d’avant ville d’après. Référence Persée : https://www.persee.fr/issue/vilpa_0242-2794_2023_num_51_1. ↩︎
- Entre géométrie et architecture (op. cit.). ↩︎
- Géographie urbaine (op. cit.). ↩︎
- Commentaire à l’Histoire naturelle de l’urbanisation de Lewis Mumford, op. cit. ↩︎
- Cf. La société de consommation (1970). ↩︎
- Cf. Les origines du totalitarisme (trois volumes : L’ Antisémitisme, L’Impérialisme et Le Totalitarisme). ↩︎
- Titre et sous-titre de l’œuvre éponyme d’Aldous Huxley. ↩︎
- Le Principe espérance (trois volumes : 1954, 1955, 1959) faisant suite à L’Esprit de l’utopie (1923). ↩︎
- Double référence : à l’Histoire (de l’art notamment) et aux Évangiles ! ↩︎
- Parabole du « Grand Inquisiteur » de Dostoïevski dans Les frères Karamasov. ↩︎
- In Manières d’être vivant (2020). ↩︎
- À cet égard, le titre de l’ouvrage de Serge Moscovici, La société contre nature (1972) ne doit pas tromper, s’agissant d’explorer les conditions de la transition entre nature et culture dans l’évolution, laquelle est marquée par la conquête de l’homme sur la nature. « L’enjeu constant, écrit Moscovici, est moins de conquérir la nature que de faire l’homme. » Et d’ajouter in fine : « Instante est certes la recherche d’un retour, non pas retour à la nature, mais retour dans la nature. » ↩︎
- Syncrétisme et alternance in Aux fontaines du désir, op. cit. ↩︎
- Voir, « Conception entre analyse et décision » in Ville et Covid : un mariage de raisons sous la direction de Guy Burgel (2021). ↩︎
Bibliographie (outre les ouvrages référés en notes de bas de page) : Tous centaures ! Éloge de l’hybridation de Gabrielle Halpern (2020).
Contact : jeanfran.serre@gmail.com.
Remerciements
Un grand merci à Philippe Boudon et Guy Burgel pour leurs précieuses remarques sur ce qui n’était encore qu’une ébauche.
